06/01/2009
_Ultimate island : On the nature of british science fiction_
Ultimate island : On the nature of british science fiction : Nicholas RUDDICK : Greenwood Press : 1993 : 202 pages (y compris bibliographie & index) : ISBN 0-313-27373-1 : en occase pour quelques dizaines d'euros, en neuf pour une centaine; le tout pour un HC (sans jaquette).

Cet ouvrage a pour but de cerner les spécificités de la SF britannique, dans la mesure où elle existe, principalement en la mettant en opposition aux autres SF (et dans celles-ci, essentiellement la SF US).
Il est divisé en quatre chapitres principaux :
- "Critical assumptions : The idea of british science fiction" : Ruddick trace dans les divers ouvrages consacrés à ce sujet, l'évolution de la pensée théorique sur ce qui "fait" la SF britannique, à la fois par rapport à la SF 'en général' (lire US) et par rapport à la littérature britannique mainstream. Au final, le résultat de ses réflexions est le constat que la SF UK est, plus que d'autres, plutôt bien intégrée à la littérature générale de son pays. La preuve en est donnée par le nombre important d'ouvrages ou d'auteurs SF qui font partie du canon littéraire (Wells, Lewis, Orwell, Huxley, Amis...).
Cette partie est la plus difficile de toutes, non qu'elle ne soit pas claire mais elle nécessite une certaine connaissance à la fois de l'histoire de la SF britannique et surtout des diverses théories et approches de la SF UK qui sont abordées par Ruddick. En effet, l'auteur ne va pas très loin dans les détails des diverses thèses en présence, ce qui est normal sur 200 pages.
Il vaut donc mieux avoir lu Aldiss (Billion year spree), Grifiths (Three tomorows), Ketterer (New worlds for old), Greenland (The entropy exhibition), Stableford (pas lu) ou Clarke (Voices prophesying war 1763-1984) pour pouvoir suivre dans ce chapitre assez dense.

- "The island of Mr Wells" : pose l'île comme motif principal de la SF UK, en traçant sa présence, sous forme littérale ou métaphorique dans une suite continue de textes majeurs (de Shakespeare & More à Ballard en passant par Wells ou Golding) qui forment, pour Ruddick, la colonne vertébrale de la SF UK. En ce qui me concerne, j'ai trouvé que le motif de l'île, tel qu'utilisé par Ruddick, est tellement malléable qu'il peut s'appliquer à n'importe quel ouvrage (The inheritors de Golding, The star de Wells). Cette partie aurait gagnée à être approfondie avec plus d'exemples parce que, intuitivement, on sent bien que l'insularité et sa revendication est une caractéristique britannique très forte, qui n'est certainement pas sans influence sur la SF qui y est écrite, mais cet a priori aurant gangé à être plus étayé avec des exemples où la notion d'insularité est centrale.
- "Peopling the ruins" & "The nature of the catastrophe" : sont deux chapitres qui traitent de la spécificité de la SF UK dans sa thématique de la catastrophe (qu'elle soit cosy ou pas). C'est la partie la plus classique (au sens de proche de l'analyse standard) du livre. Un discours que l'on a pu lire de nombreuses fois (sous la plume d'Aldiss par exemple), qui va de Shelley à Ballard en passant par Wells, Wyndham ou Christopher. Ballard est d'ailleurs particulièrement envahissant puisqu'une grande partie du chapitre lui est consacrée, alors que le rapport entre la pornographie de Crash et la catastrophe (au sens habituel du terme) n'est pas si évident.
Ruddick conclut par sa définition de la SF UK, à savoir une suite de textes qui partagent le motif de l'île comme scène d'une lutte darwiniste, reliés entre eux et reliés au reste de la littérature britannique, le tout sous l'influence (ou en réaction à) de Wells.
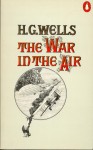
La thése de Ruddick est donc intéressante et bien argumentée. C'est un ouvrage qui atteint son objectif, à savoir de faire réfléchir à sa propre définition de la SF UK et qui donne irrésistiblement envie de discuter (même à distance comme je le fais) avec l'auteur sur le sujet. C'est là le plaisir principal de ce type d'ouvrage de référence.
Personnellement, je ne souscris pas à sa méthodologie, à savoir qu'il ME (sans plus de valeur que cela) donne l'impression d'avoir fait les choses à l'envers. Au lieu de chercher à déterminer des critères discriminants applicables à un ensemble de textes, il semble être parti du résultat, un ensemble de textes canoniques représentant pour lui la SF UK et en avoir dérivé un jeu de critères permettant de les isoler. Du coup, tout ce qui ne rentre pas dans les oeuvres pré-sélectionnées par Ruddick est classé dans la catégorie SF US et se trouve donc, d'une façon parfois un peu trop pratique/rapide, poussé hors de champ de l'étude. L'auteur donne d'alleurs des explications, assez alambiquées dans la conclusion où il finit par mentionner plus ou moins pour la première fois des auteurs aussi "britanniques" que Clarke, Brunner, Shaw, Watson, Roberts (Keith), Stableford ou Moorcock et en les évacuant immédiatement manu-militari du "champ" de la SF UK (qui n'est, pour Ruddick, pas un "genre").

Bien sûr, les pinailleurs dans mon genre tiqueront sur des affirmations du genre "That Lewis was not totally unsympathetic to american pulp science fiction can be established by the fact that he published a story in The magazine of fantasy and science fiction...", qui ne prouve justement rien puisque F&SF n'est typiquement pas un pulp et s'est toujours distingué de ces derniers ou de leurs héritiers; ou sur des tautologies comme "Rather, an island is a land that [...] seems insular to its inhabitants [...]" ("une île est un lieu qui semble insulaire à ses habitants", ce qui paraît assez normal). Mais comment ne pas apprécier un théoricien de la SF qui affirme que l'expression "American Science Fiction" est un pléonasme.
Au bémol près d'une première partie assez technique, c'est un ouvrage riche en analyse et surtout une vraie base de réflexion sur l'existence même ou la matérialisation d'une éventuelle spécificité nationale dans la SF.
Note GHOR : 3 étoiles
14:00 | 14:00 | Ouvrages thématiques | Ouvrages thématiques | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : anglais, 3 étoiles | Tags : anglais, 3 étoiles
31/12/2008
_Science fiction master index of names_
Science fiction master index of names : Keith L. JUSTICE : McFarland : 1986 : ISBN-10 0-89950-183-4 : 394 pages : une grosse vingtaine d'Euros pour un HC (sans jaquette sur mon exemplaire, je ne sais pas s'il y en a une).

A l'époque, j'avais acheté ce livre sur la foi du nom de l'auteur (qui a aussi écrit l'indispensable Science fiction, fantasy and horror reference) sans vraiment savoir de quoi il parlait (j'imaginais un sorte de dictionnaire, à la Prucher).
Cet ouvrage est en fait d'un type très particulier puisqu'il s'agit d'une sorte d'index général des ouvrages de référence "standards" au moment de sa conception.
Son principe en est donc simple, c'est la concaténation des index par auteur de 132 ouvrages avec un système de codification permettant de savoir dans quel ouvrage et à quelles page(s) est traité l'auteur X.
De plus, l'auteur a assuré lui-même l'indexation des livres de sa sélection qui en étaient dépourvus. Sont dans ce cas, entre autres, les courts ouvrages de Starmont ou de Borgo (généralement des monographies sur un auteur) ou certaines autobiographies (le Pohl par exemple).
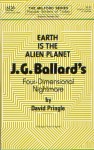
Les 132 livres traités formaient la base de toute collection sur la SFF dans les années 1980. Cela va des grandes encyclopédies classiques (Tuck, Ash) aux monographies évoquées plus haut en passant par les recueils d'interviews (la série SF voices) et les ouvrages théoriques (Suvin) et les guides de lectures. Cela correspond plus ou moins au fond nécessaire à un outil de travail solide sur le genre (à titre indicatif, je dois en posséder un peu plus d'une centaine sur l'ensemble).
Tout d'abord, je vous laisse imaginer la quantité de travail qu'a pu représenter la confection de cet ouvrage, réalisé sur des fiches bristol, à une époque où l'ordinateur domestique était quasi-inconnu et pas forcément capable de réaliser ce genre de travail. On se souviendra que les index informatiques existants contemporains (les NESFA ou le Strauss) étaient réalisés sur des mainframes.

Après, on peut s'interroger sur l'intérêt d'un tel méta-index. Justice répond à cette question en donnant une double raison.
- il peut servir à sélectionner des ouvrages que l'on ne possède pas (pour un achat ou un emprunt inter-bibliothèque) en ayant une vision sur les auteurs traités.
- il est surtout indispensable quand on veut optimiser l'exploitation de sa propre bibliothèque de référence. Au delà d'un certain volume, on ne se rappelle pas forcément où est mentionné tel ou tel auteur et il devient impossible de parcourir plusieurs centaines d'index.
Par exemple, si je cherche des informations sur Doris Piserchia ou son oeuvre, je saurais que je peux déjà sortir de mes étagères les livres suivants : Aliens and linguists, Alternate worlds, Anatomy of wonder, etc...; alors que je n'aurais pas forcément immédiatement pensé à certains (le premier par exemple).

On pourra bien sûr regretter certaines choses : une non-indexation des titres (mais alors 2000 pages de plus) ou des thèmes (un travail de titan); l'absence de séparation des index crées par Justice ou la non-inclusion de tel ou tel ouvrage.
Le souci principal est, comme souvent sur des projets de ce type, que leur pertinence décroît au fil des années, soit par l'apparition de nouveaux ouvrages incontournables soit par les rééditions augmentées (cf. Anatony of wonder qui en est à sa 5ème incarnation) qui rendent caduc ou inutilisable le travail sur les versions antérieures.
C'est en tout cas une somme de travail admirable, et un outil très utile à la condition d'avoir (ou d'avoir accès à) une fraction significative des ouvrages traités (et en plus dans la "bonne" version ou le "bon" format).
D'où un note GHOR qui peut varier de 0 (un tel index peut ne servir strictement à rien pour certains) à 3 étoiles (en ce qui me concerne).
Donc, note GHOR = 3 étoiles
10:54 | 10:54 | Index, dictionnaires & bibliographies | Index, dictionnaires & bibliographies | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : anglais, 3 étoiles, 0 étoile | Tags : anglais, 3 étoiles, 0 étoile
26/12/2008
_Robert A. Heinlein : America as science fiction_
Robert A. Heinlein : America as science fiction: H. Bruce FRANKLIN : Oxford University Press : 1980 : ISBN 0-19-5027-46-9 : Couverture Frank Kelly FREAS : 232 pages (y compris index et bibliographie primaire & secondaire) : quelques dizaines d'euros pour un HC.

Ce livre est une étude de l'oeuvre de RAH, publiée en 1980. Cette relative ancienneté n'a pas permis à l'auteur de bénéficier de toutes les recherches menées sur RAH après sa mort (sur sa première femme par exemple) mais a par contre permis à Franklin d'avoir une longue (1 journée) d'interview avec Heinlein, chose que peu de commentateurs de son oeuvre ont eu la loisir d'obtenir.
La structure du livre est simple. Il s'agit d'une division en six chapitres parmi lesquels l'oeuvre de RAH est répartie en quatre périodes disctinctes :
- The early fiction (1938-1941) : l'histoire du futur & Astounding
- New frontiers (1947-1959) ; les slicks et les juveniles
- A voice of the 1960s : les Hugos
- The private worlds of the 1970s : les romans controversés
Au sein de chaque chapitre les oeuvres sont abordées dans l'ordre chronologique et sont présentés en conjonction avec les éléments contextuels jugés pertinents, qu'ils fassent partie du domaine de la SF ou de celui des évolutions de la société américaine dans sa globalité.
En ce qui concerne l'approche critique choisie, le principe utilisé par Franklin a l'avantage d'être limpide : "le texte, tout le texte et rien que le
texte".
Ce qui veut dire que, sans tenter de deviner les intentions de RAH pour écrire telle ou telle chose, Franklin utilise de larges extraits des romans ou des nouvelles de RAH et appuie son analyse sur ce matériau que l'on a tendance à parfois négliger au profit d'envolées lyriques sur les supposées intentions de certains auteurs.
Ceci donne une analyse extrêmement percutante (et pertinente) où les arguments présentés sont toujours appuyés par des citations tirées directement des oeuvres de RAH, ce qui reste quand même la seule chose non sujette à interprétation.
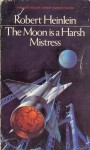
Chose plutôt rafraîchissante pour un ouvrage américain, Franklin est un théoricien proche des idées marxistes. Son analyse est donc à la fois très critique des idées entrepreneuriales défendues par RAH mais aussi très documentée en ce qui concerne le fameux complexe militaro-industriel dont RAH s'est parfois fait le porte-parole (dans le futur de ce livre par exemple, où Heinlein apportera plus ou moins sa caution à l'administration Reagan). Cette connaissance est de première main puisque Franklin a été (lui aussi) un vrai militaire d'active, officier au SAC (Strategic Air Command) et a même volé au dessus de l'URSS dans des bombardiers nucléaires.
Les jugements de Franklin sur RAH et la société américaine de son époque sont donc à prendre avec le recul nécessaire. Eric Picholle (spécialiste français de RAH et co-auteur de Solutions non satisfaisantes) a parlé ici même (sur fras) de 'livre partisan' (IIRC), propos que je nuancerais en parlant de livre militant mais objectif. De plus, cet ouvrage est factuellement est difficile à attaquer et, à la différence du livre de Bellagamba & Picholle, est le fait d'un citoyen et militaire US pétri de la culture de ce pays.

En tout cas, c'est le meilleur livre sur RAH que j'ai pu lire. Un ouvrage d'une longueur suffisante pour assurer le développement d'une approche critique argumentée. Sans fioritures excessives, mais surtout exempt des sentiments excessifs (haine féroce ou admiration béate) ou des messages politiques envahissants que l'on peut trouver dans d'autres ouvrages consacrés à cet auteur qui déchaîne immanquablement les passions. Son attitude "back to basics" (ici les textes de la main même de RAH) est indiscutablement un plus.
Note GHOR : 3 étoiles
15:34 | 15:34 | Etudes mono-auteur | Etudes mono-auteur | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (1) | Commentaires (1) | Tags : 3 étoiles, anglais, heinlein | Tags : 3 étoiles, anglais, heinlein
10/12/2008
_The seven beauties of science fiction_
The seven beauties of science fiction : Istvan CSICSERY-RONAY Jr. : Wesleyan University Press : 2008 : ISBN-13 978-0-8195-6889-2 : 323 pages (y compris bibliographies, index et notes) : une grosse vingtaine d'Euros en neuf pour un HC avec jaquette.

Ce livre est du à la plume d'un des spécialistes reconnus dans le domaine de l'analyse du genre. Son objectif est, en quelque sorte, de lister les effets ou techniques caractéristiques ou spécifiques de la SF. Ces "effets", au nombre de sept, sont pour l'auteur les élements essentiels des récits SF en ce sens que leur présence est à la fois la marque d'appartenance d'un texte au genre mais aussi que leur existence même est la raison de l'attrait que peut exercer la SF.
Comme sont titre l'indique, il est divisé en sept chapitres principaux correspondant à une des "merveilles" du genre :
- "Fictive neology" : c'est l'étude de toute la partie néologistique de la SF, proche des théories habituelles sur les protocoles de lecture propres au genre.
- "Fictive novums" : traite du concept de novum (cf. Suvin et autres) et de sa place centrale dans le corpus.
- "Future history" : déroule la thématique de la projection dans le futur et de son ancrage dans le présent.
- "Imaginary science" : sur les relations (troubles) entre la SF et la science, les deux se répondant souvent et la seconde étant la caution de la première.
- "Science Fiction sublime" : se penche sur un des effets spécifiques générés par les (bons) textes de SF, le sublime. En gros, c'est le sense-of-wonder ou le conceptual breakthrough.
- "Science Fiction grotesque" : reconnait le fait que la SF essaie certes de générer une impression de sublime mais vise aussi parfois à obtenir un sentiment de monstruosité, particulièrement dans fusions d'éléments différents (homme-machine, esprit-matière...).
- "The Technologiade" : étudie l'intégration par la SF de structures narratives comme celles du roman d'aventure ou de la romance dans un cadre technoscientifique.
Le livre se termine par un courte conclusion soulignant la convergence de chacune des sept beautés de la SF vers le concept de singularité.
Suivent plusieurs pages de notes et une bibliographie primaire et secondaire, cette dernière étant fort riche (une quinzaine de pages) et pertinente (que du lourd).
L'approche de la SF par le biais non pas de sa définition formelle mais des ses résultats (les effets produits via les techniques employées) est non seulement très intéressante mais aussi novatrice.
Cela donne un ouvrage dense, avec des parties théoriques assez pointues qui nécessitent une certaine familiarité avec les concepts developpés pour analyser et rendre compte du genre (novum, sense of wonder, future history...). L'usage du jargon de la théorie littéraire et d'un vaste corpus de référence implique d'ailleurs (AMHA) une lecture plutôt fractionnée sous peine de mal au crâne.

L'auteur emprunte beaucoup à d'autres acteurs de la réflexion sur la SF, notamment aux marxistes comme Suvin ou Jameson, mais réussit une oeuvre personnelle qui mêle rigueur technique et affection affichée pour le genre.
Conformément à l'usage actuel, les exemples sont issus de la plupart des modes d'expression de la SF (cinéma, textes, TV et BD). On pourra juste regretter le choix (assumé et expliqué) de l'auteur de se restreindre aux oeuvres "canoniques", ce qui nous vaut la n-ième discussion autour de Le Guin, Dune (encore !) ou Blade runner.
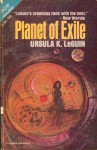
Un ouvrage érudit et roboratif, qui fait preuve d'une approche originale. Une acquisition de choix pour toute bibliothèque consacrée à la partie théorique du genre.
Note GHOR : 3 étoiles
11:11 | 11:11 | Ouvrages généraux sur la SF | Ouvrages généraux sur la SF | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : sf, science-fiction, référence, csicsery-ronay, anglais, 3 étoiles | Tags : sf, science-fiction, référence, csicsery-ronay, anglais, 3 étoiles
26/11/2008
_Orphée aux étoiles : Les voyages de Poul Anderson_
Orphée aux étoiles : Les voyages de Poul Anderson: Jean-Daniel BREQUE : Les Moutons Electriques : 2007 : Couverture Patrick Imbert : 174 pages (y compris index et bibliographie commentée) : ISBN 7745668212 : 30 Euros (en souscription) pour un HC avec jaquette

Comme le précise l'introduction, ce livre n'est pas une étude universitaire ou une biographie sur Poul Anderson, mais plutôt "un guide de lecture", le seul existant en VF et un des rares sur cet auteur après celui de Miesel (Against time's arrow : The high crusade of Poul Anderson, critiqué sur fras).
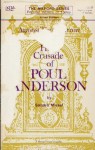
Il se compose de trois parties textuelles (par opposition aux parties bibliographiques pures) :
1) "Un homme qui compte" (50 pages) : qui mêle biographie de l'auteur et analyse des oeuvres standalones (romans et nouvelles) dans un ordre vaguement chronologique.
2) "Seigneur de mille soleils" (50 pages) : se concentre sur les grandes séries de l'auteur (Flandry/Van Rijn, Fireball, Hokas, etc...).
3) "Le dernier viking" (20 pages) : étudie les oeuvres de Anderson plutôt rattachées à la fantasy (Trois coeurs, trois lions, Ys) ou aux romans historiques.
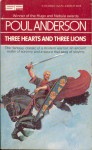
A cela s'ajoute une bibliographie sommaire (premières éditions, VT & révisions seulement, parfois US & GB + VF) qui ne couvre que les parutions en volume (+ les éventuels doubles, choix que l'on trouve aussi chez GCP mais qui m'a toujours paru discutable). Cette bibliographie est parfois commentée (longueur et contenu variable) ou renvoie au chapitre correspondant des parties précédentes.
Disons le tout de suite, cet ouvrage, en lui-même, est une réussite.
L'organisation choisie, une des seules possibles avec une oeuvre d'une telle volumétrie (300 nouvelles et + de 120 ouvrages), se révèle être assez lisible et relativement pertinente en évitant les doubles discussions que l'on trouve dans le RAH (on m'excusera de la comparaison avec cet ouvrage, mais elle est légitime s'agissant de deux ouvrages de la même collection).
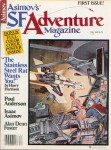
J'ajouterais quelques points de détail :
- les images de couvertures reproduites ne sont pas très nettes (papier ayant un peu bavé), pas légendées (c'est quelle édition ? Quelle année ?) et surtout ne mentionnent jamais le nom de l'illustrateur (pratique que l'on retrouve dans le RAH), ce qui ne rend pas hommage au travail de ces derniers. Pour le premier point (et AMHA) en restant en N&B (pour un problème de coût) un changement de qualité de papier sous forme de cahier aurait pu être envisageable.
- un changement de police bizarre page 35, qui indique un manque de soin dans les vérifications du produit fini.
- l'abus, surtout dans la première partie, du terme "chef d'oeuvre" (AMHA).
- un nombre de page "blanches" que je trouve trop élevé pour un ouvrage aussi court. Ceci créé indiscutablement une impression d'aération qui rend certes la lecture agréable mais qui, pour un ouvrage de moins de 200 pages TTC, pourrait parfois faire penser à du remplissage à peu de frais.
- je trouve la couverture certes moins laide que "L'anus de robot" du RAH mais, manquant d'imagination, je ne vois pas le rapport entre une boule d'écume sur une plage et Poul Anderson et/ou la SF. C'est sûrement de l'art photographique mais c'est un peu trop distancé du genre pour que l'on n'y voie pas une mauvaise conscience à l'oeuvre alors que chez le même éditeur, la couverture du James Bond est assez parlante). De plus, la jaquette (et le titre) sont à la limite de l'illisible.
Mon souci est plus avec la finalité d'une partie de cet ouvrage et son positionnement.
En gros, je trouve que la bibliographie proposée occupe une place qui est :
- soit trop importante (si on considère qu'elle reprend celle du Belial) et que les acheteurs de ce livre l'ont très probablement déjà (sous cette forme ou celle de GCP ou celle du Grand Temple),. Du coup, elle aurait être réduite à quelques pages (comme cela se pratique habituellement dans les ouvrages d'analyse d'un auteur) au profit d'une augmentation du texte consacré à Anderson.
- soit pas assez importante, en ce sens qu'il existe (chez Underwood ou Borgo) des ouvrages sur certains auteurs qui ne sont constitués que d'une bibliographie detaillée et complète. Dans ce cas, elle est richement commentée et répond ainsi à la demande d'analyse des lecteurs.
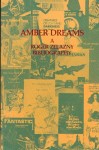
Dans la pratique, la solution hybride retenue (partie analyse + bibliographie étoffée) rend l'ouvrage inutilisable pour des recherches bibliographiques un tant soit peu pointues mais a visiblement réduit l'espace reservé aux commentaires sur l'oeuvre de l'auteur au profit d'une masse d'informations (sommaire de recueils, dates de parutions, VT) disponibles sous une forme plus complète ailleurs.
Du coup, j'ai parfois un peu le sentiment que les 30 euros demandés sont un peu excessifs pour les parties originales de l'ouvrage et qu'il aurait été préférable de faire soit un ouvrage à 45 Euros comme le RAH (soit avec plus de texte, soit avec une biblio complète), soit de ne garder que les trois premières parties et d'ajuster le prix en conséquence pour se rapprocher d'un ouvrage plus dans l'esprit du Miesel se concentrant sur l'auteur et ne fournissant qu'une biblio sommaire, à charge au lecteur intéressé d'utiliser une autre source d'information (comme les GCP) pour connaître tous les détails de publication.

Mais bon, tout ceci n'est que chipotage de ma part et ne doit pas faire oublier la qualité du livre et "l'indispensabilité" de la démarche qui consiste à proposer des études en VF sur des auteurs un peu moins "à la mode".
Note GHOR : 3 étoiles.
10:55 | 10:55 | Etudes mono-auteur | Etudes mono-auteur | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : sf, science-fiction, référence, poul anderson, français, 3 étoiles | Tags : sf, science-fiction, référence, poul anderson, français, 3 étoiles


