18/11/2015
_Le guide Howard_
Le guide Howard : Patrice LOUINET : 2015 : ActuSF (collection "Les 3 Souhaits") : ISBN-13 978-2-917689-84-4 (la fiche ISFDB du titre) : 280 pages : coûte 10€ pour un petit format non illustré, disponible chez l'éditeur (là).

Dans la série des petits (bien que celui-ci soit un peu plus grands que les autres) guides proposés par ActuSF, ce dernier opus est consacré à Robert E. Howard, l'auteur américain surtout connu pour avoir créeé le personnage de Conan. C'est Patrice Louinet, (re)traducteur de Howard et spécialiste de l'auteur qui prend ici la plume pour évoquer l'écrivain et ses (plus nombreuses qu'on ne le pense) autres créations littéraires. Cette démarche semble d'ailleurs s'inscrire dans une n-ième vague (après Titres-SF et Néo) de remise à disposition des textes d'Howard avec une quasi-intégrale chez Bragelonne.
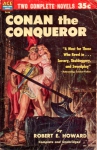
La structure de l'ouvrage fait montre d'une certaine originalité (à défaut d'en faciliter la lecture). Divisé en une douzaine de parties de taille variable, il présente en détail (mais sur une longueur adaptée à l'importance du texte selon Louinet) une cinquantaine d'oeuvres d'Howard. Ces séquences sont entrecoupées de parties diverses (biographie, relations avec Lovecraft, Conan) traitant de sujets divers. Le tout est généralement présenté sous la forme de questions-réponses, typées FAQ (par exemple "Collectionner Howard" ou "Arnold ou Jason?"). A noter l'absence de bibliographie structurée et d'index.

Même si Louinet connaît parfaitement son sujet, l'organisation de son ouvrage choisie par l'auteur saute parfois un peu trop du coq à l'âne tant au niveau des chapitres qu'à l'intérieur de ceux-ci. Ceci rend la lecture un peu disjointe et rend la recherche d'éléments précis assez complexe (d'autant plus que la table des matières est particulièrement pauvre et ne liste par exemple pas le contenu des chapitres). D'ailleurs, la partie la plus intéressante est la biographie de REH, celle qui est logiquement la plus construite.
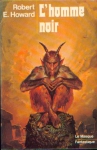
On pourra aussi regretter l'habituel jeu de massacre entre thuriféraires qui apparait systématiquement après la mort d'auteurs cultes (on pensera à HPL ou RAH). Ici, il est visible que Louinet n'aime pas De Camp à la fois personnellement (celui-ci apparaît comme un margoulin avide) et professionnellement (c'est un mauvais imitateur et un mauvais écrivain), mais aussi pas plus Milius (le réalisateur du premier film sur Conan). Ces querelles de gardiens autoproclamés du temple sont juste lassantes et n'avancent guère un débat qui pourrait être parfois très intéressant, comme de montrer comment que ce sont surtout des calculs économiques (mais pas que) qui ont lancé la Fantasy (surtout la S&S) aux USA (et après dans le monde) dans les années 60 (et non pas les intrinsèques qualités d'écrivain de REH). Au final un livre riche et instructif mais parfois trop partial et pas forcément simple à exploiter.
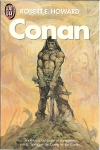
Note GHOR : 2 étoiles
12:06 | 12:06 | Ouvrages thématiques | Ouvrages thématiques | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : français, howard, 2 étoiles | Tags : français, howard, 2 étoiles
28/08/2015
_L'enseignement du français par la science fiction_
L'enseignement du français par la science fiction : Pierre FERRAN (editor) : 1979 : Les Editions ESF (collection "Sciences de l'éducation") : ISBN-10 2-7101-0199-8 (la fiche ISFDB du titre) : 155 pages (y compris index et bibliographie) : semble avoir coûté 55 FRF pour un tp non illustré pas forcément très fréquent.
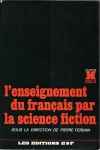
La science-fiction a parfois été présentée par certains amateurs aux enseignants de tous niveaux comme une éventuelle solution pour intéresser des élèves de moins en moins attirés par la lecture (ou tout autre matière scolaire). Basé sur le principe que l'on peut "enrober" une matière dans un sujet que l'on pense apprécié des jeunes, cette approche ressurgit périodiquement des deux côtés de l'Atlantique. Elle a donné naissance à un certain nombre d'ouvrages (peu nombreux mais apparaissant régulièrement, de Grenier à Picholle & Blanquet en VF et de Tymn à Sawyer & Wright en anglais) à vocation pédagogique et à destination principalement des enseignants.

Sous la direction de Pierre Ferran (à qui l'on doit aussi quelques nouvelles) cet ouvrage rassemble plusieurs enseignants/amateurs du genre dont bizarrement, les contributions ne sont pas identifiées. Après une déclaration d'intention, l'ouvrage se poursuit par un recensement des attitudes habituelles face à la science-fiction (ainsi que l'habituel jeu de la définition). Suivent les trois parties principales qui retranscrivent des approches pédagogiques effectivement réalisées et ce suivant les niveaux scolaires (primaire, premier cycle, deuxième cycle). Juste avant la courte conclusion, un dernier chapitre synthétise les forces du genre pour l'enseignement. Quelques annexes sont proposées : une bibliographie commentée, une enquête sur les lecteurs, une sorte de quizz et un index.

N'étant pas enseignant, mon bref avis est bien évidemment à prendre avec toutes les réserves d'usage. J'ai trouvé cet ouvrage plutôt décevant. La réflexion sur la SF est très convenue et est surtout délivrée avec un ton vaguement ironique qui dessert probablement les objectifs de cette entreprise. Les récits d'expérience sur le terrain sont potentiellement intéressants (malgré une forme qui les rend parfois presque illisibles) mais soit trop peu travaillés soit "disqualifiés" par le fait de n'avoir pas pu être menés à leur terme. A mon niveau, cet ouvrage n'offre donc strictement aucun intérêt et je ne vois pas comment l'ensemble est transposable par d'autres enseignants. Au final, ce livre part d'une intention louable mais souffre d'une réalisation déficiente et d'une organisation trop bâclée.
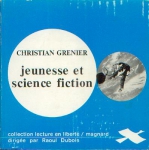
Note GHOR : 1 étoile (et encore).
11:36 | 11:36 | Ouvrages thématiques | Ouvrages thématiques | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : français, 1 étoile | Tags : français, 1 étoile
07/05/2015
_Science-Fiction_ (Ackerman)
Science-Fiction : Forrest J. ACKERMAN : 1998 : Evergreen : ISBN-10 3-8228-7324-1 (fiche ISFDB) : 240 pages (y compris index) : coûtait 135 FF pour un hc avec jaquette très largement illustré en couleurs.
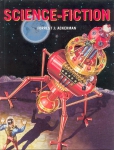
Je vais passer assez rapidement sur cet ouvrage de Forrest J. Ackerman (l'autoproclamé "Mr Science Fiction", immense collectionneur et grand spécialiste du cinéma SF). Publié par une filiale de Taschen, cet ouvrage est bien dans la lignée des productions de cet éditeur : une débauche d'images entourée d'un texte minimal. Traduction d'un titre américain, ce livre est l'exemple type du "coffee table book" ces ouvrages destinés essentiellement à être feuilletés et que l'on pose négligemment sur sa table basse.
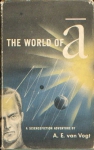
Le livre est divisé en cinq parties principales : Frankenstein sous toutes ses formes, un dictionnaire de quelques auteurs (dont certains : Serviss, Coblentz ou Olsen ne diront pas grand-chose aux lecteurs soit francophones soit d'un âge non canonique), les pulps, la SF au cinéma, la SF à la télévision. Un texte très personnel (c'est plus "Les souvenirs SF de 4E" qu'une vision synthétique du genre) sert de liant à une galerie d'images en couleurs et grand format (mais rarement clairement identifiées ou légendées) sans doute tirées des collections de l'auteur. Le tout forme une iconographie superbe et très proprement traitée qui est clairement l'attrait principal de l'ouvrage. Un livre superbe à feuilleter mais qui ne servira à rien d'autre pour un amateur un tant soit peu éclairé.

Note GHOR : 1 étoile (pour les images)
11:00 | 11:00 | Ouvrages généraux sur la SF | Ouvrages généraux sur la SF | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : français, 1 étoile | Tags : français, 1 étoile
29/01/2015
_Les dieux cachés de la science-fiction française et francophone (1950-2010)_
Les dieux cachés de la science-fiction française et francophone (1950-2010) : Natacha VAS-DEYRES & Patrick BERGERON & Patrick GUAY & Florence PLET-NICOLAS & Danièle ANDRE (editors) : 2014 : Presses Universitaires de Bordeaux (#111 de la revue Eidôlon) : ISBN-13 979-10-91052-11-5 : 314 pages (y compris bibliographie et index) : coûte 23€ pour un tp non illustré disponible en neuf via le site de l'éditeur ici.

Deuxième numéro de la revue Eidôlon à être consacré de façon claire à la SF, après le décevant numéro 91, cet ouvrage profite de la relative vogue des études sur la science-fiction française (voir par exemple les récents ouvrages importants de Bréan et Vas-Deyres, des auteurs qui figurent d'ailleurs au sommaire de ce numéro). Il s'agit ici du résultat d'un travail collectif entre deux universités canadiennes et le CLARE, une unité de recherche de l'université de Bordeaux, travail qui porte sur la SF d'expression française depuis ses débuts puisqu'il sera suivi en 2015 par un autre volet consacré à la période 1890-1950. Dans le droit fil d'une célèbre enfilade sur un forum de discussion, ce recueil d'essais cherche à découvrir quels sont les principales forces (les "dieux cachés" du titre : politique, métaphysique, religion...) qui ont influencé l'évolution de la SFF.
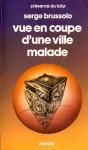
Après un avant-propos qui détaille le projet et une préface de Gérard Klein qui vise à découpler historiquement la SFF de la SFUS, l'ouvrage s'organise en cinq parties comportant un nombre variable d'essais (eux-mêmes de taille très variable, de moins de 10 à plus de 25 pages) qui semblent inédits. La première partie rassemble trois essais autour de l'angle politique (Andrevon, le Cyberpunk et Pelot), elle est suivi par cinq textes sur les "marges et singularités" (Brussolo, Bordage, Houellebecq, une expo de SF en 1967-68 et une comparaison entre deux films français de SF). On trouve ensuite quatre essais autour de la disharmonie (divers films, le post-apocalyptique francophone). La quatrième partie explore la spiritualité et la religion (avec six articles entre autre sur Vonarburg -et sa réponse-, Bordage et Henneberg). Enfin, la dernière section aborde le domaine de la bande dessinée (4 essais sur la SF jeunesse, Valérian, Bilal et Jacobs). Une bibliographie générale et deux index (noms et oeuvres) clôturent l'ensemble.
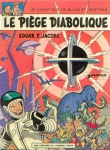
Par rapport au numéro précédent de cette revue, on constate une nette hausse du niveau des articles (qui va peut-être de pair avec un certain renouvellement, même si l'on rencontre des signatures connues dans le domaine de l'étude francophone du genre). On peut dire que ce recueil est largement du niveau de ses homologues anglo-saxons du type de ceux publiés par Greenwood Press par exemple. Du coup, on y retrouve le même manque de focalisation qui se traduit par un côte un peu hétéroclite des thèmes abordés dont le lien avec le projet de l'ouvrage semble parfois bien ténu, comme le texte sur l'exposition "Science-Fiction" au musée des arts modernes (au catalogue célèbre) qui relève soit de l'anecdote, soit de la mission impossible (évoquer une exposition sans en monter une seule image) soit de la mégalomanie (la conclusion suggère vaguement que l'apparition de nombreuses collections spécialisées en est la conséquence). On y trouve aussi ce penchant caractéristique pour des sujets "acceptables" comme l'article sur Houellebecq qui n'est certainement pas le premier nom auquel on penserait pour évoquer les "dieux" de la SF mais plus une classique tentative de trouver une caution littéraire.
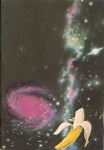
Malgré quelques scories au niveau des essais dans leur ensemble (la préface de Klein qui se tire dans le pied tout seul, certains qui semblent mal construits comme celui sur le CP qui comporte plus de notes que de texte ou d'autres qui ne sont que des listes comme celui sur les fictions post-apocalyptiques) ou sur des points de détails (des étonnantes fautes d'orthographe, des raccourcis dans les présentations de l'histoire éditoriale du genre ou des affirmations un peu hâtives par exemple sur l'imagerie Cyberpunk), le résultat est intéressant avec la plus-value pour le lecteur francophone d'aborder des auteurs d'expression française (donc peu étudiés) avec des articles d'une longueur significative (Andrevon, Pelot, Bordage, Brussolo malgré l'excès d'emphase) même si elle peut parfois sembler trop courte. Tout n'est pas forcément d'une originalité folle (les articles sur Besson et Jacobs donnent particulièrement une impression de déjà-vu tellement on a pu écrire sur ces créateurs et leurs univers) mais l'ensemble vaut largement le coup et confirme les progrès des ouvrages de référence en VF.

Note GHOR : 2 étoiles
10:59 | 10:59 | Ouvrages de référence divers | Ouvrages de référence divers | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (2) | Commentaires (2) | Tags : français, 2 étoiles | Tags : français, 2 étoiles
08/05/2014
_Planètes pilleuses et autres thématiques de la science-fiction_
Planètes pilleuses et autres thématiques de la science-fiction : Jean-Pierre LAIGLE : 2013 : L'oeil du Sphinx #44 (collection "Les études du Dr Armitage" #1) : ISBN-13 979-10-91506-07-6 : 247 pages + cahier central couleur (pas d'index mais pas mal de publicités à la fin du livre) : coûte 19 Euros en neuf pour un TP illustré de quelques photos en N&B et couleurs, disponible chez l'éditeur.

Cet ouvrage est dû à la plume de Jean-Pierre Laigle, qui est à la fois (sous un autre nom) la personne derrière les éditions Antarès (une maison spécialisée dans la SF soit ancienne, soit de provenance originale) et aussi le Rémi Maure auteur (entre autres) d'une célèbre étude sur les arches stellaires. Il est publié par les éditions de l'œil du Sphinx dont le domaine de prédilection est plutôt l'étrange ou le paranormal mais qui a dans son catalogue quelques titres d'études sur la SF déjà évoqués ici comme celui-ci ou celui-là. En terme de typologie, il s'agit d'un recueil d'essais par un même auteur sur des thèmes variés, assez proche de certains tomes proposés par Greenwood ou Borgo.

Ce livre rassemble donc cinq essais de taille variable (de plus de soixante pages pour les plus longs à moins d'une trentaine pour le plus court) dont deux ne semblent pas être complètement inédits, ayant déjà été publiés sous des formes moins complètes soit en français soit dans d'autres langues. Après une courte préface de Stableford, le premier essai proposé (qui donne d'ailleurs son titre au recueil) concerne les planètes pilleuses, des astres qui s'approchent de la Terre pour voler diverses ressources. Le deuxième est une recension des "suites" (ou textes parallèles) au roman de H. G. Wells The Time Machine. Il est suivi par le plus court texte de l'ensemble qui s'intéresse aux fictions où l'Europe est re-colonisée par ses anciennes dépendances. On trouve ensuite un long essai sur les autres Lunes de la Terre puis enfin le dernier sur des "enclaves" d'origine météorique qui pourraient se trouver sur notre globe. Chacun des essais adopte une structure identique avec une courte introduction, une longue recension chronologique des textes (voire des films ou des bandes dessinés) traitant du thèmes, une conclusion qui évalue et place l'ensemble en perspective et se termine par une bibliographie détaillée. A noter que l'ouvrage ne comporte pas d'index mais est illustré en N&B dans le corps du texte et propose aussi un cahier couleur central de douze pages.

Dans cet ouvrage, la démarche de Jean-Pierre Laigle est assez proche de celle d'un Sam Moskowitz à savoir l'exploration historique d'un thème en essayant de tracer son évolution via des textes presque inconnus et par le biais de jeux d'influence littéraires supposés dont la réalité est parfois sujette à caution. On ne peut en tout cas qu'être admiratif devant la masse de matière rassemblée par l'auteur qui met à la fois à contribution des traditions science-fictives (espagnole, indienne, etc.) peu fréquemment exploitées (et/ou simplement connues) et qui a su dénicher de rares textes de proto-SF française. Les thèmes abordés sont en plus d'une grande originalité même si leur côté plutôt pointu nécessite une certaine connaissance du genre.
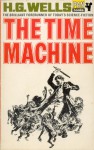
Les seuls reproches que l'on pourra faire à cet ensemble sont à la fois d'ordre physique (le livre est d'une solidité assez moyenne au vu de son prix) et portent sur des points de détails : le choix d'une capitalisation (d'ailleurs variable) plutôt anglo-saxonne (avec profusion de majuscules) pour des titres en français, une stratégie bibliographie dont on ne sait si elle est complète, partielle ou sélective (on comparera par exemple la bibliographie fournie par Laigle pour The Star Mouse avec ceci); un style qui rend parfois les propos de l'auteur peu clairs (un artefact de rétro-traduction ?). Ce sont plutôt les parties d'inspiration "Moskowitzienne" évoquées plus haut qui peuvent être contestées, le manque de justification étant parfois patent. En tout cas ce recueil est fort intéressant à lire et l'on espère que la série des études du Dr. Armitage comportera d'autres items.
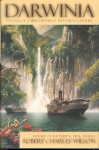
Note GHOR : 2 étoiles
12:30 | 12:30 | Ouvrages de référence divers | Ouvrages de référence divers | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (1) | Commentaires (1) | Tags : français, 2 étoiles | Tags : français, 2 étoiles


