01/07/2013
_Science-Fiction et psychanalyse_
Science-Fiction et psychanalyse : L'imaginaire social de la SF : Marcel THAON & Gérard KLEIN & Jacques GOIMARD & Tobie NATHAN & Ednita BARNABEU : 1986 : Dunod (collection "Inconscient & Culture") : ISBN-10 2-04-016475-8 : vi+243 pages (y compris index) : coûtait quelques dizaines de Francs pour un tp non illustré trouvable d'occasion.
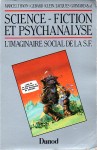
Publié par un éditeur universitaire et paru dans une collection de titres consacrés à la psychanalyse, cet ouvrage n'a pas forcément bénéficié d'une grande visibilité dans le milieu de la SF. Pourtant, les auteurs mentionnés sur la couverture ainsi que le dessin de Mezières l'ancrent nettement dans le champ des réflexions sur le genre. La SF a en effet parfois intéressé les "psys" de tous bords, soit comme objet d'étude où l'imagination et/ou la fantasme prend une part importante ou comme vivier de cas cliniques tant chez les auteurs que chez les lecteurs. On se souviendra par exemple du fameux texte The Jet-propelled Couch (aisément disponible dans The Fifty Minute Hour) de Lidner qui met en scène un écrivain de SF qui croit vraiment aux mondes qu'il décrit (une anecdote à la base de la BD Souvenirs de l'empire de l'atome).
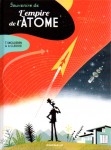
L'ouvrage rassemble sept essais de taille très variable et inédits en VF. Le premier (Thaon) est une très courte introduction centrée sur la problématique posée par le nom même de Science-Fiction. Il est suivi par un autre texte d'une trentaine de pages du même auteur qui nous conte l'histoire du genre sous l'angle psychanalytique. Trames et moirés est le plus long texte de l'ouvrage (une centaine de pages), il s'agit d'un essai de Klein qui a été récemment réédité (et complété) aux éditions du Somnium et qui est l'extension d'un article de 1967, son sujet en est le concept des "Subjectivités Collectives". On trouve ensuite Goimard sur le cinéma de SF puis deux études consacrées à des auteurs précis (Nathan sur Van Vogt, Thaon sur PKD). L'ouvrage se termine par la traduction d'un court article général de Bernabeu qui date de 1957. Une liste de références bibliographiques est fournie mais il n'y a pas d'index.
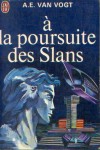
Tout d'abord, on notera l'extrême faiblesse de la qualité "technique" du livre : couverture fragile, reliure faiblarde, nombreux changements de taille de police sans raison apparente, lignes manquantes ou lignes dupliquées, absence d'index. De la part d'un éditeur aussi réputé, tout cela fait peu sérieux. une fois ces critiques sur la forme faites, le fond n'est pas beaucoup plus convaincant. L'essai de Klein, pièce maîtresse de l'ouvrage, peine à convaincre de l'intérêt de ses "SC" (on se croirait chez Banks). Outre la modestie habituelle de l'auteur, le texte tourne plutôt à vide en se regardant parfois écrire et ne commence à évoquer la SF (et encore presque uniquement avec Lovecraft) qu'à partir d'une cinquantaine de pages. Alors que c'est normalement l'une des forces de Klein, l'analyse sociale promise dans le sous-titre de l'ouvrage n'est ici que peu apparente et utilisée.

Le reste des articles est soit de facture honnête (Thaon avec une histoire de la SF d'un classicisme impressionnant pour l'époque et une réflexion sur PKD qui mériterait visiblement plus d'espace, Nathan sur Van Vogt qui souffre du même défaut), soit sans aucun intérêt (Goimard peu inspiré par le cinéma et Barnabeu qui répète joyeusement tous les clichés sur la SF et ses lecteurs). Le fait que la plupart des textes sont visiblement bâtis sur un principe de "sandwich" similaire (une couche de théorie psychanalytique puis une couche de SF sans grand rapport entre elles et on recommence...) permet certes à l'amateur de l'une ou l'autre des disciplines de sauter des pans entiers de texte mais ne rend pas la lecture très intéressante ni le discours très argumenté. Au final le tout forme un ensemble largement dispensable.
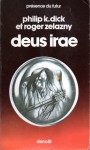
Note GHOR : 1 étoile
12:23 | 12:23 | Ouvrages thématiques | Ouvrages thématiques | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : français, 1 étoile | Tags : français, 1 étoile
08/05/2013
_Ces Français qui ont écrit demain_
Ces Français qui ont écrit demain : Utopie, anticipation et science-fiction au XXe siècle : Natacha VAS-DEYRES : Honoré Champion (série "Bibliothèque de littérature générale et comparée #103) : 2013 : ISBN-13 978-2-7453-2371-2 : 525 pages (y compris index et bibliographies) : coûte 110 Euros pour un HC non illustré et sans jaquette (disponible chez l'éditeur, http://www.champion.ch/), à noter qu'il semble exister une version plus récente et moins chère (49 Euros).

Sous la plume d'une agrégée de Lettres Modernes et familière des ouvrages sur le genre en français (on la retrouvera par exemple dans diverses publications récentes comme celles-là : http://ghor.hautetfort.com/archive/2013/02/23/l-imaginair...), cet ouvrage fait partie d'une collection consacrée à la littérature générale. Ce point est intéressant parce qu'il semble indiquer que, après la parution de l'ouvrage de Simon Bréan (et en attendant la mythique encyclopédie de l'Atalante dont des extraits sont d'ailleurs cités par l'auteur en avant-première), le paysage éditorial français semble pouvoir accueillir des ouvrages ambitieux sur le genre. Cette évolution (peut-être initiée par Bragelonne avec sa série "essais), si elle se confirme serait une excellente nouvelle pour l'étude de la SF dans notre pays. Comme son sous-titre l'indique, cet ouvrage porte sur les auteurs de SF français du siècle précédent (même si elle débute au XIXème siècle), abordés avec le fil directeur de l'utopie (ou plus tard de la dystopie) ou plus précisément des diverses approches utopiques qui se sont succédées au fil du temps (Natacha Vas-Deyres en distingue trois différentes).
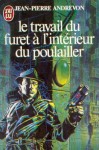
Pour débuter, l'ouvrage nous offre deux courts avant-propos (Bozzetto & Lehman) puis une longue introduction de l'auteur. Il adopte ensuite une structure chronologique qui va étudier ainsi les trois stratégies utopistes découvertes par l'essayiste. La première partie va donc traiter la période 1890-1910 et les utopies dynamiques et plutôt positives (Verne, Zola) même si certaines peurs se font jour (verne encore, Rosny, Daudet). Après le choc traumatique de la première guerre mondiale, la deuxième partie étudie les années entre 1920 et 1970 où le ton est sombre et la fin inévitable (Barjavel, Messac). La dernière partie (1970-2004) voit l'inspiration utopique s'intégrer de plus en plus à la SF "normale" et les auteurs (Andrevon, Jeury) proposer des solutions alternatives (éventuellement par le biais de l'informatique ou de l'éccologie) et critiques du monde dans le quel ils vivent. Une courte conclusion, une bibliographie copieuse et un index terminent un ouvrage dont il est à noter que certaines parties ont déjà été publiées antérieurement dans divers supports.

Comme il sied à un ouvrage de ce niveau, la quantité de travail et de recherches fournie par l'auteur est indiscutable et impressionnante, la bibliographie de plus de quarante pages en témoigne d'ailleurs largement. Le propos est clair et la division des récits utopiques en trois mouvements successifs est largement démontrée avec exemples à l'appui. Les romans (il n'y a que quelques nouvelles) sélectionnés par Natacha Vas-Deyres sont à la fois résumés, disséqués, cités mais aussi mis en perspective dans la carrière de leurs auteurs. De plus, les arcanes des grandes phases des débats entre courants utopistes sont bien expliqués et peuvent ainsi être (vaguement) compris par des novices comme moi.

Du côté négatif, on me permettra tout d'abord d'être bassement matérialiste mais je dois avouer que le prix de l'ouvrage (110 Euros, je le rappelle pour un ensemble qui n'est pas complètement inédit) peut quand même faire tiquer, surtout comparé à d'autres produits d'ambition similaire. Ensuite, le projet même du livre, de se baser sur l'angle utopique exclusivement, me semble devenir de moins en moins pertinent au fur et à mesure que cette tradition littéraire (certes noble et respectable) s'est dans la pratique complètement dissoute dans la SF jusqu'à l'inexistence. C'est certes sûrement plus acceptable de parler d'utopie dans les cercles littéraires, mais rattacher à ce genre des oeuvres comme Le travail du furet, Le spectre du hasard ou La compagnie des glaces me paraît être une annexion sans grande logique hormis celle de fournir du matériau sur lequel écrire. Sur un autre point, la technique de constitution de l'ouvrage (l'auteur a sélectionné une soixantaine d'ouvrages comme indiqué ici : http://dissidences.hypotheses.org/2799) donne un résultat que l'on pourrait qualifier de "pointilliste". Cela donne l'impression de réduire, faute d'une bonne vue d'ensemble ou d'une bonne connaissance du genre (un reproche que l'on peut parfois faire à certains ouvrages "académiques"), le genre à une galerie limitée d'oeuvres (au plus une vingtaine par période étudiée). La brève mention du Cyberpunk par le seul biais de longs emprunts à un article (à paraître) de A. Marcinkowski est d'ailleurs un exemple assez frappant de ce possible manque de perspective. Malgré tout, il ne faut pas bouder notre plaisir devant un ensemble sérieux, à la thèse construite même si elle peut aisément être discutée.
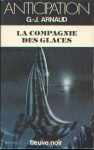
Note GHOR : 2 étoiles
18:33 | 18:33 | Ouvrages thématiques | Ouvrages thématiques | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : français, 2 étoiles | Tags : français, 2 étoiles
24/02/2013
_L'imaginaire médical dans le fantastique et la science-fiction_ & _L'imaginaire du temps dans le fantastique et la science-fiction_
L'imaginaire médical dans le fantastique et la science-fiction : Jérôme GAUFETTE & Lauric GUILLAUD (editors) : 2011 : Bragelonne (Collection "Essais") : ISBN-13 978-2-35294-442-3 : 376 pages (pas d'index, bibliographies variables) : coûte 40€ pour un tp non illustré disponible en neuf.

L'imaginaire du temps dans le fantastique et la science-fiction : Natacha VAS-DEYRES & Lauric GUILLAUD (editors) : 2011 : Presses Universitaires de Bordeaux (#91 de la revue Eidôlon) : ISBN-13 978-2-903440-91-6 : 290 pages (pas d'index, bibliographies variables) : coûte 23€ pour un tp non illustré disponible en neuf.

Chers amis lecteurs, afin de vous faire gagner du temps, le GHOR a décidé de vous proposer d'évoquer deux livres en un seul et même avis. Deux ouvrages aux titres très proches, parus la même année, l'un dans la méritante collection d'essais de l'éditeur maudit Bragelonne et l'autre au sein d'une revue littéraire, deux volumes basés sur le même principe (une collection d'essais autour d'un thème suffisamment vague), impulsés par la même structure (le CERLI d'Angers) et ayant de nombreux auteurs en commun (presque la moitié). Dans un souci (louable) de rationalisation, ils feront donc critique commune.

La toute première constatation qu'appelle ce duo d'ouvrages est que l'étude de la SF ne doit pas bien se porter dans notre pays. En effet, la portion réservée à la SF stricto-sensu est particulièrement faible puisque, à la louche, un petit tiers de l'ensemble doit lui être consacré (à noter que le cas de la Fantasy est pire, avec un nombre d'essais se comptant aisément sur les doigts d'une seule main). Même si le terme à la mode de l'Imaginaire englobe plusieurs genres, je ne suis pas convaincu que les amateurs d'horreur soient forcément intéressés par une étude sur Greg Bear (par Minne), et que les fans de SF aient envie de se passionner pour des nouvelles "irréalistes" (ce qui semble vouloir dire vaguement policières et vaguement fantastiques) britanniques parues entre 1850 et 1900 (le sujet de l'essai de Desmarets). Cette alliance de la carpe et du lapin qui se manifeste trop souvent dans les ouvrages de référence francophones est soit due au manque d'intervenants potentiels, soit à un certain mépris des genres mineurs qui peuvent aisément être parqués ensemble.

L'idée exprimée plus haut qu'il manque peut-être de spécialistes francophones pour discourir sur la SF (ou la Fantasy) peut être accréditée par la deuxième constatation, à savoir qu'il y a, dans ces ouvrages, des textes qui n'ont strictement aucun rapport avec genre. On va y trouver une étude sur l'image de l'hôpital (Jandrok), sur le "transcorps" (Andrieu) ou sur Gödel où l'auteur (Cassou-Noguès) a cette touchante confidence : "Je n'étudierai pas à proprement parler ces textes de science-fiction..." ce qu'il s'empresse de d'ailleurs de faire. Cet état de fait (peu d'intervenants) est aussi perceptible dans les nombreux auteurs qui apparaissent dans les deux sommaires (Minne, Ménégaldo, Lagoguey, Vas-Deyres, Jandrok, Guillaud, Dupeyron-Laffay, André) et qui pour certains (Lagoguey) traitent de sujets similaires (PKD).

La troisième constatation est que la crédibilité des papiers présentés serait sans doute renforcée par un minimum de relecture et d'attention portée aux détails. Même si le lecteur un tant soit peu connaisseur du genre est capable de corriger l'information instantanément, la mention dès la page 11 du Bragelonne du célèbre texte de John Varley Blood Music pique un peu les yeux. On peut sans doute imputer à ce qui semble être un manque de travail un certain nombre de curiosités : Robert Matheson, Marck Reynolds, plusieurs Frederick Pohl (comme sur certains PdF), plusieurs Man in the hight castle, des affirmations un peu rapides (les textes de Guardians of Time/La patrouille du temps écrits dans les années 60, Les temps parallèles traduit en 2004) ou le fait que les titres soient parfois donnés en VO et parfois traduits, le tout sans aucune logique apparente. Dans le même esprit, il est dommage que l'essai sur l'immortalité de Guillaud dans le Bragelonne (qui à la lecture semblait un article d'encyclopédie) fasse, après vérification, de très larges emprunts non crédités à des entrées de la SFE de Clute & Nicholls, puisque l'on y retrouve des pans entiers (les plus visibles étant par exemple des listes d'oeuvres) issus directement des articles CRYONICS & SUSPENDED ANIMATION. A 40€ le volume, on pouvait espérer un peu mieux.
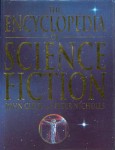
Globalement et en ce qui concerne les textes relatifs à l'ensemble SF&F (je n'ai pas d'avis sur ceux traitant de l'horreur ou du fantastique) les deux ouvrages donnent une impression d'approximation et de hors-sujet, en ce sens que les auteurs (comme souvent avec certains universitaires spécialisés) partent souvent de quelques textes de SF pour bifurquer le plus rapidement possible sur leur vrai domaine d'expertise. On pourra quand même sauver de ces recueils ratés quelques essais : Besson sur les guérisseurs dans la Fantasy, les deux textes de Lagoguey sur PKD, l'étude de Héraud sur Les temps parallèles. Au final, un couple d'ouvrages dont l'intérêt pour l'amateur de SF est très limité et dont la qualité de finition laisse à désirer, un point regrettable vu leur prix surtout pour le Bragelonne, qui n'est vraiment pas donné. Sur l'ensemble, L'Eidôlon est quand même un cran au dessus.
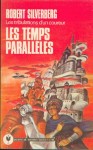
Note GHOR : 1 étoile pour l'ensemble (0 pour le Bragelonne, 1 pour le PUB)
17:46 | 17:46 | Ouvrages thématiques | Ouvrages thématiques | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : français, 1 étoile | Tags : français, 1 étoile
08/12/2012
_La Science-Fiction en France_
La Science-Fiction en France : Théorie et histoire d'une littérature : Simon BREAN : 2012 : Presses de l'Université Paris-Sorbonne : ISBN-13 978-2-84050-851-9 : 501 pages (y compris index et bibliographies) : coûte 22 Euros pour un TP non illustré, disponible dans toutes les bonnes librairies et chez l'éditeur (http://pups.paris-sorbonne.fr/pages/aff_livre.php?Id=991).

Attendu comme le messie par une partie des amateurs français grâce à un buzz persistant, cet ouvrage est dû à la plume de Simon Bréan, un chercheur et professeur français en littérature rattaché à la Sorbonne, spécialiste de la SF française. Ce livre est donc la publication remaniée de sa thèse qui a été soutenue en 2010. Vu les ambitions affichées et le niveau supposé du livre, il s'agit là de l'une des parutions majeures dans le domaine des ouvrages de référence en français de ces dernières années, ce qui explique probablement toute l'exposition médiatique (en tout cas dans le petit milieu de la SF) qui l'a entouré.
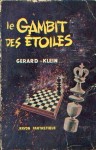
L'ouvrage débute par une préface de Gérard Klein, un des hommes orchestre de la SFF, un auteur que l'on aura d'ailleurs souvent l'occasion de croiser au fil de la lecture. Suit une longue introduction théorique de l'auteur qui définit la SF comme un régime ontologique matérialiste spéculatif et qui la place par rapport à d'autres "genres" ou productions littéraires. Les quatre chapitres suivants s'étendent sur la moitié du livre et brossent une histoire de la SF française et en France. On aborde donc d'abord les précurseurs et l'état du genre en 1950 puis chaque décennie est ensuite étudiée dans un chapitre dédié (le tout s'arrête en 1980 même si un bref bilan historique nous amène jusqu'au présent). Après cette séquence historique on bascule ensuite dans la partie théorique avec tout d'abord un chapitre sur les spécificités du genre tant au niveau de la construction littéraire que du processus de lecture lui-même. La partie suivante est plutôt d'essence thématique puisqu'elle balaye les principaux thèmes (voyage spatial, machines pensantes, extraterrestres, etc.) du genre en liaison avec la section historique. Le chapitre suivant développe la théorie du "macro-texte" commun qui encapsule tous les récits de SF et approfondit les parcours littéraires de deux auteurs : Gérard Klein et Pierre Pelot (sur la période étudiée). Une brève conclusion termine l'ouvrage et précède de volumineuses annexes : chronologie du genre, chronologie des régimes ontologiques, tableaux synthétiques des ouvrages parus en France, bibliographie primaire et secondaire et deux index (général et des oeuvres).

Avant d'aborder le contenu de cet ouvrage, il me paraît important de le redéfinir un peu. Sans avoir d'idée préconçue quant au contenu de l'ensemble et en me fiant au titre (et au sous-titre) : La Science-Fiction en France : Théorie et histoire d'une littérature, le livre que j'ai été amené à lire ne correspondait pas vraiment au ce qui était annoncé. En effet, j'ai plutôt lu un ouvrage qui aurait pu majoritairement s'appeler : Les romans de la Science-Fiction française des origines aux années 1980 tels que perçus par la revue Fiction. En effet, hormis quelques paragraphes contextualisants, seuls les auteurs et le domaine français sont étudiés (et encore uniquement les romans) et la partie historique est placée sous le prisme quasiment unique des analyses et avis donnés dans Fiction. Il est vrai que l'auteur s'en explique dès l'introduction, mais j'avoue bêtement aimer acheter le produit promis et non un autre.

Ensuite, j'ai eu parfois du mal avec le projet du livre et son articulation. L'introduction laissait présager d'un ouvrage théorique sur le genre dans la lignée de Langlet ou de Saint-Gelais avec la classique tentative de définition du genre et les habituelles problématiques de l'exercice. Pourtant la suite bascule dans une histoire de la SF française en France qui ressemble beaucoup dans son esprit et son exécution (vie et mort des collections, résumés -parfois longs- des intrigues, querelles de personnes, etc.) à la partie française de l'histoire du genre racontée par Sadoul, aux bémols près 1) d'une certaine tendance à réécrire l'histoire en se basant souvent sur des commentaires (par exemple les préfaces de Klein) rédigés des années après les évènements évoqués et 2) d'une utilisation trop exclusive du matériau extrait de Fiction. Outre le fait que je n'ai jamais été vraiment Fiction mais plutôt Galaxie (je confesse aussi n'apprécier guère le F&SF original), il me paraît dommage de n'avoir retenu qu'un son de cloche. Même si les autres sources sont certainement plus difficiles à obtenir (fanzines, autres magazines, rares articles ou ouvrages de référence), il existait un "autre" discours critique (parfois écrit par les mêmes personnes, cf. le cas de Satellite) même s'il était moins développé ou moins influent que la "mafia" de Fiction. Cette copieuse (mais limitée dans son horizon) histoire du genre contée, retour à la théorie avec la meilleure partie du livre sur les objets et leur positionnement, même si le remplacement de la xénoencyclopédie de Saint-Gelais par le vade-mecum de Bréan n'est pas forcément une avancée fulgurante. J'ai beaucoup apprécié le travail passionnant sur les réécritures de Drode ou Curval qui est hélas bien trop court. Le chapitre suivant, une sorte de catalogue thématique, m'a complètement échappé, d'autant plus qu'une partie est constituée de redites d'éléments d'intrigues déjà dévoilés dans les chapitres historiques (j'ai même eu l'impression -peut-être fausse- d'y lire les mêmes phrases). Le retour à la théorie est alors le bienvenu surtout que (AMHA) on touche là à la vraie spécificité de la SF, à savoir l'aspect hyper-référentiel du genre et les demandes qu'il impose tant au lecteur (via les protocoles de lecture chers à Delany) qu'à l'auteur (qui doit intégrer tout un corpus à l'aune duquel il est jugé). Toutefois, les théories de Broderick sont plutôt à lire directement chez l'auteur (même si Reading by Starlight est parfois indigeste). De plus, j'ai été littéralement arrêté dans ma lecture par la fin de ce chapitre qui est constituée par deux études d'auteurs (dont l'omniprésent GK) certes très intéressantes mais dont la présence semble pour le moins incongrue tant elles semblent être autonomes (les liens avec le macro-texte qui les parsèment me paraissant presque "rajoutés"). L'étude sur Klein (et les parties du livre consacrées aux débuts du FNA) entrent d'ailleurs particulièrement en résonance avec les travaux contemporains de Lyau sur le même sujet (là : http://ghor.hautetfort.com/archive/2011/04/26/the-anticip...).

Même si l'on ne peut qu'être admiratif devant la quantité de travail fournie par l'auteur (et de son courage pour avoir lu certains vieux FNA), un certain nombre de détails auraient gagné à être approfondis et vérifiés directement à l'origine ou recoupés avec des sources fiables. Par exemple, et contrairement à ce qui est écrit par Bozzetto (là-dedans : http://ghor.hautetfort.com/archive/2009/08/31/rah-peyresq...), Slan n'est pas un fix-up; le passage du format pulp à un format plus modeste ne date pas forcément de la fin des années 40 mais plutôt du milieu de la décennie (1943 pour le leader Astounding); le fait est que, contrairement à l'idée reçue, les nouvelles parues dans Galaxie (surtout dans sa deuxième incarnation) proviennent souvent d'autres magazines que de Galaxy (WoT, If et même New Worlds); ou l'anthologie Marginal (telle que publiée par OPTA) n'a pas eu 16 numéros dans notre réalité. Cette (fugitive) impression d'approximation est aussi présente en règle générale dans les parties consacrées au survol historique de la SF anglo-saxonne qui sont tellement résumées qu'elles pourraient parfois donner une image un peu déformée de la réalité, un lecteur non averti pourrait penser à la lecture de l'ouvrage que le New Worlds des années 70 est le descendant direct de celui de 1946. Pour terminer les reproches, il est dommage que la riche bibliographie secondaire soit tellement segmentée qu'elle en est inexploitable (même si cette problématique de classement se retourve pour toute liste d'ouvrages de référence, y compris ici).
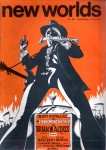
Au final, pour un lecteur récent du genre, le livre représente une très pertinente synthèse d'un certain nombre de concepts théoriques et permet de connaître l'histoire de la production autochtone de la SF dans notre pays (au moins jusqu'en 1980). A ce titre, il est une addition bienvenue au catalogue des ouvrages de référence en VF. Toutefois, les amateurs plus au fait des travaux sur le genre pourront percevoir ce livre comme une certaine concaténation d'ouvrages existants (Lyau+Fiction+Saint-Gelais+Langlet+Sadoul+Wolfe+Broderick+Le Rayon SF) qui détaillent parfois de façon plus approfondie les mêmes sujets. A ce titre, il est au final d'un intérêt moindre.

Note GHOR : 2 ou 3 étoiles ("your mileage may vary" comme disent nos amis anglo-saxons)
17:21 | 17:21 | Ouvrages généraux sur la SF | Ouvrages généraux sur la SF | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (4) | Commentaires (4) | Tags : français, 2 étoiles | Tags : français, 2 étoiles
19/11/2012
_Fleuve Noir : 50 ans d'édition populaire_
Fleuve Noir : 50 ans d'édition populaire : Juliette RAABE : 1999 : Bibliothèque des littératures policières : ISBN-10 2-84331-046-6 : 191 pages (pas d'index ni de bibliographie) : coûtait 130 FF pour un TP illustré en N&B.

Cet ouvrage est chroniqué ici pour mémoire. En effet, il s'agit d'un dossier réalisé conjointement à une exposition organisée (fin 1999 - début 2000) par les bibliothèques de la ville de Paris. Cette exposition portait sur l'éditeur populaire Fleuve Noir. Cet éditeur ayant eu à son catalogue plusieurs collections de SF dont bien sûr la mythique "Anticipation", le contenu de cet ouvrage pourrait être susceptible d'intéresser les amateurs du genre même s'il est clairement axé sur le policier.

Hélas (pour l'amateur du genre), à la lecture, on ne peut que constater que la partie consacrée à la SF est minimale. Seules quelques pages de RCW traitent de la collection "Anticipation" et les interviews des auteurs liés au genre (Houssin, Pelot, Mazarin, Arnaud, Morris) sont soit anecdotiques (1 page pour les deux premiers) soit évoquent leur travail dans d'autres domaines. Comme l'analyse contextuelle ou économique n'est pas le fort de l'ouvrage, l'histoire du FNA reste encore à écrire (malgré le Douilly qui représente un petit pas dans cette direction).

Pas de note GHOR
08:33 | 08:33 | Ouvrages de référence divers | Ouvrages de référence divers | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : français | Tags : français


