11/06/2022
_The Fortean Influence on Science Fiction_
The Fortean Influence on Science Fiction : Charles Fort and the Evolution of the Genre : Tanner F. BOYLE : 2021 : McFarland (série "Critical explorations in Science Fiction and Fantasy" #73) : ISBN-13 978-0-4766-7740-8 (la fiche ISFDB du titre): viii+180 pages (y compris bibliographie et index) : coûte 45.00 USD pour un TP non illustré disponible chez l'éditeur (là), existe aussi en ebook (978-1-4766-4190-4).
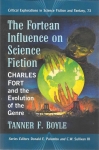
Charles Fort (1874-1932) était un grand collectionneur d'évènements inexpliqués de tous types (apparitions dans le ciel avant la vague des soucoupes volantes, pluies d'objets, disparitions, cryptozoologie...) qui, après la parution de ses principaux ouvrages dans les années 30 (y compris en sérial dans Astounding), a bénéficié d'un ensemble de fidèles dévoués à ses idées et a exercé un influence durable bien que marginale dans le paysage culturel (surtout US). Un des domaines où ses idées ont bien pris racine est évidemment, de par une grande proximité intellectuelle, la SF. Tout le monde connaît l'influence de Fort sur le Sinister Barrier de Russell (c'est d'ailleurs la couverture du serial dans Unknown qui ressert pour cet ouvrage) mais l'ambition de Boyle (qui est présenté juste comme un écrivain américain) dans ce livre est de montrer que cette influence est bien plus grande que ne le présente l'histoire canonique du genre.
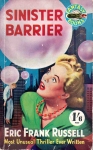
Après une courte préface et un aussi court premier chapitre introductif, l'ouvrage peu être subdivisé en plusieurs parties distinctes : quelques pages sur la SF Fortéenne avant Fort; une définition de ce que Boyle appelle la "maybe-fiction" (en gros les textes qui sont entre la fiction et la non-fiction suivant les lecteurs, les récits d’abduction extraterrestres en étant l'exemple type) une catégorie très influencée par les écrits de Fort; les premiers auteurs de SF "Fortéens" (Lovecraft, Russell et d'une façon plus surprenante Herbert); Fort comme source d'inspiration dans les pulps SF (on va alors croiser Palmer & Shaver); quatre chapitres centrés sur des auteurs précis (dans l'ordre Clarke, Dick, Heinlein et Robert Anton Wilson); un bref panorama de Fort tel que lu par d'autres média et enfin une très courte conclusion. L'ensemble est complété par plusieurs pages de notes, une bibliographie et un index.
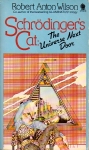
On notera tout d'abord que l'ouvrage n'est pas très épais avec à peine 150 pages de texte. Après, l’idée que Fort a eu une influence sur le genre paraît tellement évidente à première vue que l'on se demande ce que va pouvoir dire l'auteur de fondamentalement nouveau. Du coup, la première grosse partie (celle sur la maybe-fiction) donne l'impression d'une digression, certes intéressante, mais pas forcément en rapport avec le sujet annoncé du livre (en fait le concept aurait mérité d'être traité à part, tant la matière et l'approche de l'auteur sont riches). Quand on arrive enfin au cœur du sujet, on est déjà au premier tiers du livre. La suite propose un certain nombre d'hypothèses originales (le lien entre le ver des sables de Dune et le Mongolian Death Worm, une des créatures de la cryptozoologie ou une lecture Fortéenne de RAH) mais le discours de Boyle me semble manquer de profondeur.
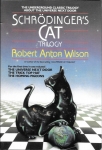
En fait, je ne suis pas particulièrement convaincu par le travail de l'auteur que je trouve effectivement un peu léger sur la partie relative au genre (à la différence de celle sur sa maybe-fiction). À la fois dans son raisonnement qui se limite parfois simplement à des analogies formelles au niveau des thèmes (comme avec You're All Alone de Leiber)et dans ses recherches qui (dans mon ressenti) semblent se cantonner à des sources secondaires dont certaines (par exemple le Seekers of Tomorrow de Sam Moskowitz qui pourtant revient très -trop ?- souvent) sont sans doute à prendre avec du recul. Le tout donne une impression bizarre, un ensemble parfois intéressant mais qui d'autre part donne l'impression d'enfoncer des portes ouvertes en survolant la surface des choses. Du coup, à chacun de se faire son opinion et à trouver quelle partie lui convient le plus.
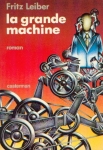
Note GHOR : 2 étoiles (pour l'enthousiasme de l'auteur)
19:21 | 19:21 | Ouvrages thématiques | Ouvrages thématiques | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : anglais, 2 étoiles | Tags : anglais, 2 étoiles
02/05/2022
_La parodie monstrueuse_
La parodie monstrueuse : La naissance des monstres modernes : Marc ATALLAH (editor) : 2020 : Cernunnos : ISBN-13 9782374951614 : 255 pages (pas d'index ni de bibliographie) : coûte 26.95 Euros pour un petit hc illustré en couleur et n&b, disponible en ligne et en librairie.
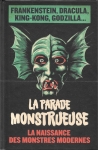
Comme souvent avec les ouvrages de Marc Atallah, ce livre est lié à une exposition ("Je est un monstre") qui s'est tenue en 2020 à La Maison d'Ailleurs, le (seul) musée de la SF qui se trouve en Suisse à Yverdon. En terme de contenu, on a presque trois sections entremêlées : une demi-douzaine d'essais d'une vingtaine de pages (sous les plumes de divers professeurs de français de l'université de Lausanne ainsi que de l'editor), deux portfolios (un au début et un à la fin) de Benjamin Lacombe (divers monstres) et de Laurent Dureiux (des affiches de films célèbres revisitées) et plusieurs séquences d'illustrations (couvertures de livres ou de pulps, photos de films). Comme souvent avec les productions de la MdA, il n'y a pas d'index.
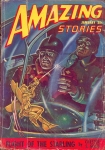
Pour être franc, j'estime que ce livre n'offre strictement aucun intérêt. Texte prétentieux (je cite : "Considéré ainsi, le monstre se constitue, d'une part en unité signifiante d'une représentation collective qui participe de l'élaboration d'un mythe de la modernité technologique et, d'autre part, en instrument théorique et critique permettant de questionner l'identité ontologique des machines et leur rapport trouble et déstabilisant à l'humain et aux environnements naturels et sociaux", Marta Caraion p177-178) et sans intérêt pour l'amateur (on est plutôt dans la philosophie classique grecque ou romaine), autoréférences constantes (Marc Atallah aime beaucoup citer Marc Atallah), essais hors sujets (le triste sort de la reine malgache Ranavalona (ou Ranavalo, le livre n'est pas très sûr), illustrations massacrées (il manque toujours un partie des couvertures - un problème de droit ?-) ou photos de livres en mauvais état (cf. page 93), couvertures pillées ça et là (encore un coup de l'agence martienne ?) sans même l'effort de les créditer ou de simplement les légender, la liste de mes griefs est longue. Cela ne fait pas beaucoup de travail pour une trentaine d'euros.
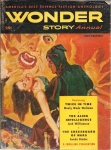
Note GHOR : 0 étoile (1 étoile pour ceux qui ont un devoir de philo à rendre sur le thème de l'altérité)
10:49 | 10:49 | Ouvrages thématiques | Ouvrages thématiques | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : français, 0 étoile | Tags : français, 0 étoile
06/04/2022
_Visions of Mars_
Visions of Mars : Essays on the Red Planet in Fiction and Science : Howard V. HENDRIX & George SLUSSER & Eric S. RABKIN (editors) : 2011 : McFarland : ISBN-13 978-0-7864-5914-8 (la fiche ISFDB du titre): vi+216 pages (y compris index et bibliographies) : coûte 29.99 USD pour un tp non illustré disponible chez l'éditeur.
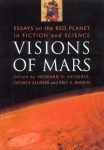
Après cet avis, nous restons sur Mars avec ce volume publié par McFarland. Sous la houlette d'un trio d'editors connus dans le domaine des ouvrages de référence (Hendrix étant en plus un auteur de fiction confirmé), cet ouvrage est en quelques sorte le recueil des actes de la Eaton Conference (un rassemblement annuel d'étude sur le genre) tenue en 2008 et qui s'intitulait justement Chronicling Mars. Contemporain d’autres titres sur le même sujet, on peut considérer que cet ouvrage et ses cousins est la réponse de l'académie à la vague des "Mars Novels" des années 90-00.
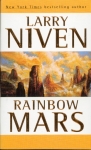
Après une préface et une introduction, le corps du livre se compose de dix-sept essais de taille variable (certains correspondent visiblement au texte brut des interventions et d'autres ont été sans doute retravaillés). On y retrouve des plumes connues dans le domaine de la réflexion sur la SF (en plus des editors, on peut y lire Robinson, Huntington, Lyau, Crossley...) qui abordent divers sujets qu'ils maîtrisent particulièrement, comme par exemple Lyau qui se (re)baigne dans le Fleuve Noir (voir son son livre sur le sujet). En "bonus", nous avons, outre un index (les bibliographies sont à la fin de chaque essai), la transcription de deux panels tenus à la conférence avec des acteurs du genre célèbres (Hartwell, Bradbury, Pohl, Niven, Landis).
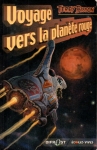
Au final, l'ensemble offre une lecture intéressante même si, immédiatement, il se dégage de l'ensemble parfois une impression de "recyclage" (Lyau et Crossley sont frappants en ce sens). Le lecteur est aussi confronté à des textes assez inégaux, tant en longueur (le plus court fait à peine quatre pages et est juste une sorte de teaser) qu'en pertinence (l'essai de Palmer sur Icehenge dont on peut se demander ce qu'il fait dans cet ouvrage) ou qu'en qualité (la liste des occurrences de Mars chez Jules Verne qui aligne plusieurs pages de références tirées des textes de l'auteur pour un résultat nul : Verne ne s'intéressait pas à Mars).
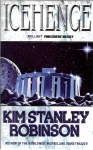
Toutefois, un nombre significatif de textes soit abordent des sujets originaux : Nichols sur les adaptations TV/Cinéma de The Martian Chronicle ou Slusser sur les liens entre Wells et les frères Strugatsky, soit explorent en détail des thématiques précises (Mars chez Heinlein ou Dick) d'une façon que des titres plus généraux sur ces auteurs ne peuvent égaler. Par contre, les deux transcriptions de panels n'offrent guère d'intérêt (outre un qualité technique moyenne avec force [inaudible]) et ressemblent fort à du remplissage pour un livre qui ne brille quand même pas par son rapport qualité/prix.
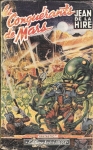
Note GHOR : 2 étoiles (pour les meilleurs essais)
16:52 | 16:52 | Ouvrages thématiques | Ouvrages thématiques | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (10) | Commentaires (10) | Tags : mars, anglais, 2 étoiles | Tags : mars, anglais, 2 étoiles
25/03/2022
_Imagining Mars_
Imagining Mars : A Literary History : Robert CROSSLEY : 2011 : Wesleyan University Press : ISBN-13 978-0-8195-6297-1 (la fiche ISFDB du titre) : xvii+353 pages (y compris index) : coûte 40.00 USD pour un hc illustré (et cahier photographique central en couleur) avec jaquette disponible chez l'éditeur (là), existe aussi en ebook (-7105-2).
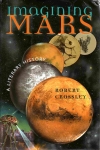
On peut constater que, parallèlement aux progrès scientifiques et technologiques dans le domaine de l'observation des autres planètes, l'intérêt des auteurs de science-fiction pour Mars a connu plusieurs phases. Le statut de la "Matter of Mars" est passé par tous les stades, de sujet brûlant (vers 1890 ou dans les années 90 avec la fameuse vague de romans martiens) à toile de fond (les années 30) en passant par thématique presque oubliée (les années 60). C'est donc à l'histoire mouvementée de la représentation de la planète rouge dans le genre que s'attaque ici Robert Crossley, un universitaire américain spécialiste (entre autres) de Stapledon à qui l'on doit cette étude sur l'auteur. Pour les complétistes, on notera qu'il existe au moins (ça veut dire présents dans ma bibliothèque) deux ouvrages presques contemporains sur le même sujet : Visions of Mars (2011) de Hendrix et al. et Dying Planet (2005) de Markley, des titres que je n'ai pas encore lus.

Après une courte préface qui présente la structure du livre, l'ouvrage est construit en 14 chapitres d'une vingtaine de pages chacun. Ils suivent un ordre chronologique, du moyen âge à l'an 2000 et se concentrent presque exclusivement sur la science fiction écrite (cf. le sous-titre de l'ouvrage) et plus particulièrement sur les romans (quelques nouvelles marquantes sont toutefois mentionnées). On trouvera aussi quelques illustrations en n&b au fil du texte et un cahier central de huit pages en couleur sur papier glacé. Il y a bien un index mais pas de bibliographie qui se trouve en fait partiellement dans les copieuses (30 pages) notes de fin d'ouvrage.
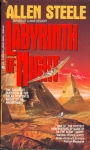
Je possède cet ouvrage depuis presque une dizaine d'années mais je l'avais laissé dans ma PAL jusqu'à présent, sans doute un peu rebuté par la couverture qui me semblait sans doute "datée" et promettait un texte plus centré sur la proto-sf. À la lecture, c'était une erreur de ma part. Le résultat du travail de Crossley est particulièrement intéressant et représente sans doute presque l'ouvrage définitif sur le sujet de Mars en littérature. Exhaustif (qui d'autre peut se rappeler le Mars Genesis de S. C. Sykes paru dans la remarquable mais éphémère collection The Next Wave de Bantam), érudit et d'une lecture fluide, il n'y a pas grand chose à reprocher à ce livre. On regrettera quand même l'absence d'une bibliographie classique qui fait que, pour retrouver les références d'un titre, il faut consulter l'index, trouver la page et puis la note correspondante. On se rappellera aussi que le livre de Crossley s'arrête de facto au début des années 2000 ce qui laisse une période non couverte qui s'allonge au fur et à mesure que les années passent. En tout, une très agréable surprise au final et un ouvrage recommandé.
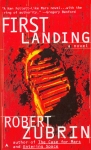
Note GHOR : 3 étoiles
15:51 | 15:51 | Ouvrages thématiques | Ouvrages thématiques | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : anglais, 3 étoiles | Tags : anglais, 3 étoiles
16/03/2022
_Islands in the Sky_
Islands in the Sky : The Space Station Theme in Science Fiction Literature (2ème édition) : Gary WESTFAHL : 2009 (pour cette version) : Wildside/Borgo Press (série "I.O. Evans Studies in the Philosophy and Criticism of Literature" #15) : ISBN-13 978-1-4344-0356-8 (la fiche ISFDB du titre) : 265 pages (y compris index et bibliographie) : coûte 19.99 USD pour un tp (en POD) non illustré disponible chez l'éditeur (là).

Comme souvent chez Wildside/Borgo, il s'agit d'un titre à l’histoire éditoriale compliquée. Initialement publié en 1996 cet ouvrage est donc ressorti en 2009 sous une forme expansée (quelques textes en plus) et plus ou moins révisée comme l'explique Westfahl dans son introduction. De plus, il existe une sorte de "compagnon" bibliographique à ce volume : The Other Side of the Sky (évoqué ici) qui en est la bibliographie commentée. Tout cela tourne donc autour du thème des stations spatiales (et par extension des habitats spatiaux type cités d'O'Neill) et de leur représentation (signification, utilisation, récurrence) dans le genre, un sujet qui semble passionner l'auteur depuis des années.
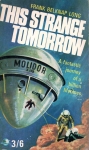
Pour simplifier les choses, ce livre est constitué d'une reprise du texte de 1996 (sur deux cents pages avec une préface de Benford et une douzaine de chapitres en quatre parties) augmenté de plusieurs essais et d'une nouvelle introduction. L'ensemble adopte une structure plutôt thématique, la première partie est introductive et historique, la deuxième passe en revue les "types" de stations spatiales, la troisième s'élargit à des thèmes connexes (habitats, stations vagabondes et ascenseur spatial), la quatrième conclut en évoquant la place de ce thème particulier au sein de la science-fiction et la dernière est constituée de divers courts appendices (des essais récupérés ça et là). Une bibliographie (non commentée évidemment) et un index terminent l'ouvrage.

Malgré tous les efforts de Westfahl pour justifier ses travaux (que je soupçonne d'être essentiellement de commande), j'avoue avoir eu mal à être emballé par son discours même si son idée que les stations spatiales de par leur présence dans le genre amènent un changement de paradigme de notre perception de l'espace interplanétaire, qui passe d'une perception "maritime" (un espace vide à sillonner) à une vision plus terrestre (un territoire à occuper) n'est pas sans mérite. On appréciera aussi les références nombreuses à des textes d'auteurs relativement inconnus (Long, Mason, Caidin...) qui, même s'il ne semblent pas être des chefs-d’œuvre, présentent une pertinence certaine pour l'étude du thème.

Par contre, je trouve que, dans cet ouvrage, Westfahl fait un peu trop du Westfahl pour en être complètement satisfait. Son côte "iconoclaste professionnel" habituel, qui est souvent rafraichissant et parfois même salutaire, est ici poussé un peu à l'excès au point de s'en prendre à d'autres auteurs d'ouvrages de référence (Wolfe ou Nicholls pour ne citer qu'eux) ou à l'ensemble de ceux qui réfléchissent sur le genre d'une façon manquant un peu d'élégance et de recul. Cela gâche un peu le plaisir de la lecture d'un ouvrage qui aurait pu être aussi un peu allégé de ses appendices rajoutés à la fin qui sont trop datés pour être intéressants.
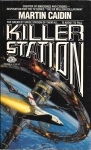
Note GHOR : 2 étoiles
17:34 | 17:34 | Ouvrages thématiques | Ouvrages thématiques | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : anglais, 2 étoiles | Tags : anglais, 2 étoiles


