20/01/2020
_The Time Machine Hypothesis_
The Time Machine Hypothesis : Damien BRODERICK : 2019 : Springer (série "Science and Fiction") : ISBN-13 978-3-030-16177-4 (la fiche ISFDB du titre) : xiii+243 pages (y compris index et bibliographie) : coûte 24.25€ pour un tp non illustré disponible chez l'éditeur (là), existe aussi en ebook (-16178-1).

Suivant le canevas habituel des titres de cette série de chez Springer (un éditeur suisse-allemanique qui publie en anglais) comme celui-ci, cet ouvrage est donc consacré aux machines à voyager dans le temps. Damien Broderick, un universitaire australien à qui l'on doit un certain nombre de textes de fiction et de non-fiction appartenant au genre, nous évoque tout d'abord l'état de l'art scientifique sur le sujet dans les premières cinquante pages. Il enchaîne ensuite par une promenade chronologique (de The Time Machine de Wells au tout récent Rewrite: Loops in the Timescape de Benford) autour des textes majeurs de ce sous-genre, chacun d'entre eux étant évoqué en plusieurs pages.

L'ouvrage proprement dit se termine par une longue et audacieuse conclusion (les UFO comme machines à voyager dans le temps) suivie d'une bibliographie et d'un index. D'une façon étonnante (en tout cas en ce qui me concerne) et comme pour le livre de Nahin, nous avons finalement droit à une coquetterie de l'auteur, une nouvelle (inédite semble t-il), d'une dizaine de pages sur le sujet : The Dry Sauvages.
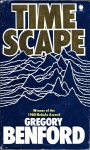
Je dois avouer avoir été plutôt déçu par cet ensemble bancal. La première partie est intéressante mais sans doute encore trop spéculative pour être scientifiquement pertinente s'agissant d'un domaine encore absolument vierge (on ne comprend déjà même pas la flèche du temps alors voyager dedans...). La deuxième partie nous permet de revisiter un certain nombre de classiques (il y a peu de textes inconnus) sur le sujet (By His Bootstraps, Bring the Jubilee, The Big Time, In the Garden of Iden, etc.). Hélas, je n'ai guère accroché à la démarche de Broderick qui mélange dans ses recensions un peu tout : la biographie de l'auteur, sa bibliographie, les détails de 'intrigue du texte étudié, de larges extraits de celui-ci, une appréciation critique et une analyse "scientifique". Du coup, ces mélanges ne se révèlent guère fluides à la lecture. De plus, l'absence d'une section récapitulative qui aurait pû mettre en prespective l'évolution de cette branche particulière de la SF se fait nettement ressentir.
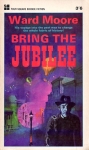
En effet, la conclusion qui pourrait jouer ce rôle de résumé part dans une direction complètement différente. Même si Broderick nous prévient qu'il s'agit d'une expérience de pensée, on croirait en fait lire un de ces ouvrages soucoupistes publiés par J'ai Lu dans sa collection "L'aventure mystérieuse" (avec Fatima, Socorro ou Rendlesham Forest). Quant à la nouvelle de l'auteur, je préfère ne même pas en parler. Au final un ensemble décevant, mal construit et qui donne l'impression d'un collage de plusieurs parties sans lien entre elles.
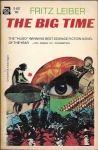
Note GHOR : 1 étoile
11:45 | 11:45 | Ouvrages thématiques | Ouvrages thématiques | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : anglais, 1 étoile | Tags : anglais, 1 étoile
24/12/2019
_Tout le Steampunk !_
Tout le Steampunk ! : Etienne BARILLIER & Raphaël COLSON : 2014 : Les Moutons Electriques (série "Bibliothèque des miroirs") : ISBN-13 978-2-36183-182-0 (inconnu de l'ISFDB) : 350 pages (avec index, mais sans bibliographie) : coûtait 29.90 € pour un hc carré avec jaquette, illustré en couleurs et disponible pour pas cher chez l'éditeur.
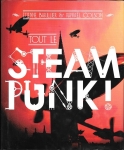
Sous la plume de Barillier & Colson (comme quoi on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même), auteurs récurrents du monde des ouvrages de références francophones, cet ouvrage est une sorte d'ode au Steampunk. Ce "genre" autoproclamé par des amateurs de marketing m'a toujours fait penser à la grenouille qui tente de se faire aussi grosse qu'un bœuf. Malgré toute l'emphase des auteurs (et pourtant il y en a des tonnes), je reste convaincu que le Steampunk n'est juste qu'un vernis superficiel caractérisé par quelques signes distinctifs (le dirigeable, la vapeur, le cuivre...) que l'on "plaque" d'une façon opportuniste sur des genres existants (essentiellement l'uchronie et les super-héros). Du coup, j'ai du mal à m'enthousiasmer sur ce catalogue déjà vieux de plusieurs années qui encense un mouvement qui est d'une façon logique proche de la fin de son cycle commercial (comme le Cyberpunk avant lui ou les zombies).
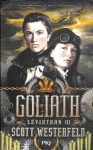
De plus, le discours des auteurs (on ne sait d'ailleurs pas trop qui a écrit quoi) vise beaucoup trop large et à force de nous servir des sous-sous-genres (Dieselpunk, Atompunk, Biopunk, Clockpunk, Néo-pulp et j'en passe sûrement) finit par juste donner une impression de remplissage, impression accentuée par un certain nombre de redites. Comme souvent, le côté "catalogue" prend l'ascendant sur une éventuelle réflexion sur le pourquoi de cette imagerie et de son succès (qui n'apparaît brièvement qu'à la toute fin de l'ouvrage) qui aurait sans doute été intéressante. L'absence de bibliographie, qu'elle soit primaire ou secondaire, est d'ailleurs révélatrice du fait que ce livre n'a visiblement pas été pensé comme un ouvrage de référence.

Pour continuer à être méchant, il faut d'abord indiquer que mon exemplaire est d'une qualité de fabrication déplorable : massicoté à la hache et horriblement relié en carton par un club du troisième age tchèque. Tellement que je me suis même demandé si ce n'était pas un ARC. Ensuite, l'on y retrouve toutes les qualités habituelles des ouvrages de référence des Moutons : fautes d'orthographe, police de caractère maniérée (un sorte de virgule sur certains "t" et "p"), affirmations hâtives (John Clute présenté comme américain), chronologie à revoir (pour Priest, La machine à explorer l'espace est donnée comme antérieure à Le monde inverti), références obsolètes (le Barets, quand même !), illustrations massacrées (bouffées par le cadre vaguement art-déco, sauvagement rognées, tout cela sans doute pour des raisons de copyright) et non légendées, recherches insuffisantes (comme ignorer l'école rétrofuturiste des débuts de Métal Hurlant - Sire, Chaland, Benoît-), auto-publicité envahissante (la plupart des rares références citées concernent -Oh surprise !- d'autres ouvrages du même éditeur).
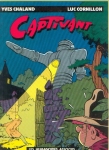
Au final, il n'y a pas grand chose à sauver de ce livre sauf quelques illustrations ayant échappé au massacre, sous réserve de retrouver à quoi elles correspondent. Cette opinion doit vouloir dire que je ne suis pas dans la cible visée par cet éditeur.
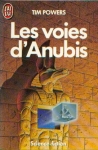
Note GHOR : 1 étoile (à réserver à ceux qui pensent que le Steampunk est la dernière chose à la mode)
12:15 | 12:15 | Ouvrages thématiques | Ouvrages thématiques | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : français, 1 étoile | Tags : français, 1 étoile
26/11/2019
_Cthulhu !_
Cthulhu ! : Patrick MARCEL : 2017 : Les Moutons Electriques (série "La bibliothèque des miroirs") : ISBN-13 978-2-36183-332-9 (inconnu de l'ISFDB) : 230 pages (y compris bibliographie mais pas d'index) : coûte 19.00 € pour un tp format carré illustré en n&b + planches couleurs, disponible chez l'éditeur (là), existe aussi en ebook.

Cet ouvrage semble être une sorte de reprise de Les nombreuses vies de Cthulhu avec un certain nombre de modifications dont l'étendue n'est pas précisée (comme je n'ai pas les deux ouvrages, je ne peux pas comparer mais il manque les nouvelles de la première version). L'ayant trouvé en bouquinerie, je l'ai pris sans trop me poser de questions quant au contenu, m'attendant à une sorte d'étude sur le mythe de Cthulhu. En fait, j'ai rapidement découvert que l'essentiel du livre (les 185 premières pages) est une métafiction qui postule l'existence réelle des éléments décrits par un certain nombre d'écrivains, Lovecraft au premier chef, et qui nous les décrit et les interroge comme s'ils étaient authentiques.
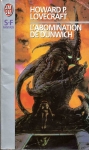
C'est donc en fait un livre de non-fiction fictif, un peu comme ces biographies de héros, ces ouvrages savants ou ces encyclopédies que l'on peut trouver sur Dune, Star Wars, Bob Morane ou La Terre du Milieu. C'est sans doute très intéressant pour les amateurs mais j'ai hélas passé l'âge d'être emballé par ces "histoires secrètes du monde". Du coup j'ai survolé l'ensemble et je me suis arrêté uniquement sur la courte partie biographique consacrée à HPL (une petite douzaine de pages très classiques avec les habituels conflits entre thuriféraires), la bibliographie d'HPL relative à Cthulhu (inexploitable) et les jolies photos couleurs des dernières pages. Un ouvrage décevant mais sans doute ne fais-je simplement pas partie du public visé.
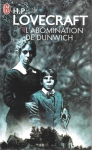
Note GHOR : 0 étoile (juste pas ma came)
19:02 | 19:02 | Ouvrages thématiques | Ouvrages thématiques | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : français, 0 étoile, lovecraft | Tags : français, 0 étoile, lovecraft
01/11/2019
_French Science Fiction, Fantasy, Horror and Pulp Fiction_
French Science Fiction, Fantasy, Horror and Pulp Fiction : Jean-Marc LOFFICER & Randy LOFFICIER : 2000 : McFarland : ISBN-10 0-7864-0596-1 (la fiche ISFDB du titre) : xi+787 pages (y compris index et bibliographie) ; coûtait 95.00 USD pour un grand tp illustré en n&b, très difficilement trouvable à des prix acceptables.
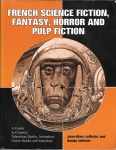
Note liminaire : Il pourrait paraître amusant de devoir consulter un ouvrage anglo-saxon pour avoir un panorama de la SF&F&H francophone. Une fois que l'on réalise que cet ouvrage est le seul (quelle que soit la langue) à proposer une démarche d'une telle ampleur, on ne peut que constater et se désespérer de l'état sinistré de la publication de la réflexion sur le genre en VF (antienne que j'ai déjà entonnée au sujet de cet ouvrage).
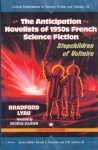
Mais revenons à nos moutons avec cet ouvrage, paru sous la plume des Lofficier, le couple qui est derrière Black Coat Press et qui est depuis des années un infatigable promoteur de la SF francophone dans le paysage éditorial anglo-saxon. Paru en 2000, ce massif (800 pages) volume voulait justement combler la manque d'information (voire l'ignorance complète) Outre-Atlantique sur l'existence d'une SF (et du reste des genres associés) francophone autonome et possédant une histoire significative et présente dans tous les domaines.
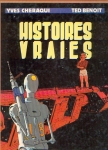
Après divers préambules, ce gros ouvrage (format A4) est divisé en deux "livres". Les deux couvrent donc la SF, la Fantasy (au sens anglo-saxon), le Fantastique, l'Horreur et la fiction populaire (type Fantômas), le premier traite sur 300 pages toute la sphère non-littéraire, du cinéma à la bande dessinée en passant par la télévision ou la radio. Chacune des parties commence par un chapitre historique puis enchaîne avec des listes commentées d'oeuvres (dans l'ordre alpahabétique). On trouve aussi quelques courtes interviews et une série de notules biographiques consacrées aux principaux artistes. La seconde partie est donc uniquement consacrée à la littérature et présente une organisation différente. Tout d'abord purement chronologique (tous genres confondus) jusqu'en 1800, elle se subdivise ensuite en chapitres consacrés à chacun des sous-genres sur une période déterminée (par exemple le Fantastique de 1800 à 1914), ces chapitres ayant une organisation elle-même variable (par thème ou par sous-périodes). On trouve aussi quelques pages sur la SFQ et surtout un copieux "dictionnaire des auteurs" qui est en fait une bibliographie par auteur. Outre un système de renvoi interne (en gras comme la SFE), on trouve une micro bibliographie, une liste des principaux prix francophones et un index général.
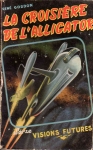
Tout d'abord, on ne peut qu'admirer la quantité de travail qu'a dû représenter l'écriture et la compilation d'un tel panorama. Au vu de la taille même du domaine considéré, il est bien sûr inévitable de constater un certain nombre d'oublis(surtout dans la BD) ou d'erreurs. Tout cela reste quand même strictement marginal et n'empêche pas l'utilisation de cet ouvrage comme source d'information fiable (d'autant plus si vous êtes anglo-saxon et par exemple pas particulièrement pointu sur les mystères de l'édition française).

Le principal reproche que l'on peut faire à cet ouvrage est sans doute celui d'une organisation interne pas forcément très lisible. Vu l'ampleur du sujet, il n'y a sans doute pas de "bonne" solution mais, dans ce cas précis, la perception globale du genre est trop émiettée dans divers chapitres, sections et sous-sections du livre. Si un auteur est à cheval sur plusieurs périodes et plusieurs genres (voire dans plusieurs médias), il va être évoqué un peu partout mais n'aura un profil détaillé (chevauchant les périodes) qu'à un seul endroit (dans une des sous-sections Major Authors) mais sa bibliographie complète sera à la fin du livre. Sans doute une organisation du type partie historique puis partie bio-bibliographique aurait-elle été plus rationnelle. Mais il s'agit là de points "techniques" qui n'enlèvent rien à la qualité de cet ouvrage qui est sans doute la plus complète présentation des genres de l'imaginaire en francophonie (on appréciera en particulier l'attention portée à la Belgique).
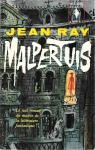
Note GHOR : 3 étoiles
13:52 | 13:52 | Ouvrages thématiques | Ouvrages thématiques | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : anglais, 3 étoiles | Tags : anglais, 3 étoiles
23/09/2019
_The Transhuman Antihero_
The Transhuman Antihero : Paradoxical Protagonists of Speculative Fiction from Mary Shelley to Richard Morgan : Michael GRANTHAM : 2015 : McFarland : v+189 pages (y compris index et bibliographie) : ISBN-13 978-0-7864-9405-7 (la fiche ISFDB du titre) : coûte 29.95 USD pour un tp non illustré qui existe aussi en ebook (978-1-4766-1955-2), disponible chez l'éditeur.
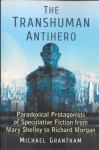
Cet ouvrage est dû à un universitaire australien inconnu (en tout cas qui n'a visiblement pas écrit autre chose dans le genre) et semble correspondre à la publication de sa thèse de doctorat. Il s'agit de l'exploration du thème de l'antihéros sous l'angle du post/transhumanisme, aux bémols près que l'antihéros de l'auteur est parfois tout simplement le héros pour le commun des mortels et que le post/transhumanisme évoqué est parfois seulement le résultat d'un entraînement physique poussé.
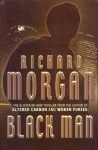
L'origine de l'ouvrage explique sans doute le sentiment un peu bizarre que j'ai eu à la lecture. En effet, comme souvent avec ce type d'exercice (la thèse de doctorat), l'échantillon des textes étudiés est plutôt limité. Ici Grantham ne considère en profondeur qu'une dizaine de romans (Frankenstein, Odd John, The Stars My Destination, More Than Human, Neuromancer, la trilogie "Kovacs" et Black Man de Mogan) et deux bandes dessinées (V for Vendetta et Watchmen) même si une dizaine d'autres titres Cyberpunks font parfois un brève apparition. Cette sélection réduite et non dénuée d'effets de mode (Gibson, Moore) donne un ensemble qui paraît assez réducteur et plutôt déconnecté de la richesse du genre. La consultation de l'index qui tient en seule page est d'ailleurs assez révélatrice de cette pauvreté.
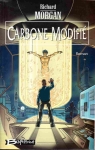
On trouve aussi dans ce livre une structure en mille-feuille assez typique qui permet à l'auteur de montrer au jury qu'il a bien fait ses devoirs. On a donc souvent une sorte de sandwich avec une petite tranche de théorie (que cela soit sur Nietzsche, le monomythe de Campbell, le mouvement cyborg ou l'esthétique punk) puis une grosse tranche de SF et ainsi de suite au fil des sept chapitres. Il ne faudrait pas conclure de cette description que l'ensemble est mauvais. De fait, si l'on saute les passages extra-SF, le reste est d'une lecture agréable et soulève des points pertinents (même s'ils ne sont pas d'une originalité folle). On appréciera particulièrement les deux derniers chapitres sur certains romans de Richard Morgan qui sont à la fois originaux et intéressants.
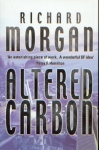
Note GHOR : 2 étoiles
19:22 | 19:22 | Ouvrages thématiques | Ouvrages thématiques | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : anglais, 2 étoiles | Tags : anglais, 2 étoiles


