05/11/2008
_The influence of imagination : Essays on science fiction and fantasy as agents of social change_
The influence of imagination : Essays on science fiction and fantasy as agents of social change : Lee EASTON & Randy SCHROEDER : McFarland : 2008 : ISBN-13 978-0-7864-3230-1 : 228 pages (y compris index et blibo des ouvrages cités après chaque essai) : une vingtaine d'Euros pour un TP.

Cet ouvrage est un receuil d'essais (inédits à ma connaissance) qui correspond plus ou moins aux actes d'un colloque tenu au Canada en 2004 sur le thème de "SF & social change".
Il est composé de 17 essais, de moins d'une dizaine de pages en général, qui abordent une vaste gamme de sujets, certains assez focalisé, comme les grilles de lecture de certaines oeuvres, qu'elles soient littéraires (Moonwise, Always coming home, Midnight robber, Last and first men ou No woman born), cinématographiques (Gattaca confronté à la "queer theory", le SdA) ou dans le domaine de la BD/Comics.
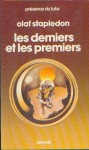
D'autres essais se veulent d'une portée plus générale, et traitent, par exemple, des auteurs féminins dans le magazine Weird tales ou des tentatives de créer une SF hypertextuelle.
Pour aller à l'essentiel, il n'y a pas grand chose à sauver de ce livre :
- Aucune unité, les sujets n'ayant parfois aucun rapport discernable avec le thème choisi, qui pourtant est assez clairement exposé dans
l'introduction ou dans la 4ème de couverture : "This collection of essays examines the potential connections between speculative fiction and actual social change.". Par exemple le texte sur le SdA qui montre d'une façon assez concluante l'étendue des trahisons de Jackson vis à vis de Tolkien en ce qui concerne les arbres et leur signification, est intéressant comme analyse croisée de divergences d'interprétation mais n'a aucun rapport avec la conscience sociale.
- Une trop grande proportion de textes "amateurs". Il est clair que tout le monde n'est pas Clute, Wolfe ou Westfahl, mais les auteurs ont quasiment tous été recrutés au sein du corps enseignant ou estudiantin du "Mount Royal college" situé en Alberta (Canada) avec (AMHA) comme seule condition l'existence chez le candidat d'un vague intérêt pour la SF&F. Ceci génère un double effet de manque, à la fois de recul mais aussi de pertinence (certains ne sont visiblement spécialistes que d'une seule chose et peinent à la relier au reste du genre) et un niveau de discours assez faible. Ceci nous vaut des articles sans aucune structure (celui sur Weird tales est une suite de paragraphes disjoints) ou des pages pleines de jargon à la mode (généralement féministe ou postmoderniste).
- Une certaine tendance à réinventer la roue, l'exemple frappant étant (encore) le texte sur les auteurs féminins dans Weird tales qui ne fait que paraphraser Davin (Partners in wonder : Women and the birth of science fiction 1926-1965) en infiniment moins bien et visiblement sans même en avoir connaissance (il n'est pas cité dans la biblio).

Du coup ne sont récupérables que l'analyse fouillée de No woman born dans le contexte de la fin de la 2GM et des préparatifs pour un retour des femmes à leur condition domestique antérieure (Linda Howell), la lecture de Gattaca comme récit homoérotique et/ou queer, qui éclaire le film d'un jour nouveau (Lee Easton) et l'article sur les fictions hypertexte qui offre des exemples récents d'une éventuelle évolution de la forme que pourrait prendre la SF (Brian Greenspan) même s'il pêche (AMHA) par un enthousiasme excessif.
Un livre pas vraiment indispensable qui ne révolutionnera pas la réflexion sur le genre et dont les raisons de la parution me sont mystérieuses.
Note GHOR : 1 étoile
10:18 | 10:18 | Ouvrages thématiques | Ouvrages thématiques | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : anglais, 1 étoile | Tags : anglais, 1 étoile
04/11/2008
_Galactic suburbia : Recovering women's science fiction_
Galactic suburbia : Recovering women's science fiction : Lisa YASZEK (1969- ) : Ohio State University Press : 2008 : ISBN-13 978-0-8142-5164-5 : 234 pages (y compris index et biblio) : 16 Euros 44 pour un TP.
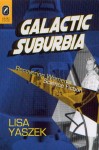
Cet ouvrage fait partie de la (très) longue liste de livres traitant des rapports entre les femmes et la SF.
Il s'intéresse ici aux femmes écrivains (et non lectrices par exemple) et aux écrits qu'elles ont pu produire et publier durant la période 1945-1965, soit la période située entre la fin de la 2GM et la pleine action du women's lib. Les recherches de Yaszek montrent que les femmes auteurs de SF ont, pendant cette période, utilisé une sorte de décor/ensemble de thématiques commun qu'elle nomme "Galactic suburbia", c'est à dire une version du futur des USA (et en leur sein de la place des femmes) concentrée sur la sphère domestique.
Ce cliché de "La femme américaine du futur au fourneaux" a été clairement le fruit d'une nette volonté de la société US et de ses dirigeants (masculins) de renvoyer les femmes dans leur foyers après les avoir utilisées comme main d'oeuvre durant la guerre (la fameuse "Susie la riveteuse"). Malgré tout, l'usage de ce cadre a permis aux auteur(e)s de subvertir, au sein d'un genre accueillant (le seul peut-être permettant une telle liberté), l'idéologie patriarcale ambiante en ouvrant la voie à un féminisme naissant et de préparer la place de la femme dans l'imagerie du futur.
Cet ouvrage est organisé en 4 chapitres :
1- "Writers" : qui place les auteurs féminins dans le cadre plus large de la SF de l'époque et explique leur positionnement et leurs stratégies dans l'espace propre au genre et extérieur à celui-ci.
2- "Homemakers" est un peu le coeur du livre qui montre comment ces écrivains ont utilisé la SF pour émettre un commentaire sur l'état de la
société US et constater le recul de la place des femmes sous la poussée conjuguée des demandes de la guerre froide et de la consommation.
3- "Activists" montre comment les femmes ont utilisé l'espace qui leur était dévolu (le foyer, la famille et les enfants) pour participer d'une façon importante aux avancées civiques des années 50-60 et comment cela s'est traduit en terme de récits SF se concentrant sur la rencontre de l'alien.
4- "Scientists" montre comme les femmes de la SF se sont positionnées par rapport à la science, à la fois comme journalistes scientifiques mais aussi, au travers des textes de fiction comme actrices de l'aventure scientifique.
Dans le débat traditionnellement assez controversé sur l'histoire croisée du féminisme et de la SF, il existe schématiquement deux positions :
- l'école Russ (et al.), du féminisme des années 60 qui part du principe que les auteurs de cette mouvance ont fait tomber les barricades de la SF et ont, à elles toutes seules, imposé la présence des femmes dans un genre qui les niait complètement.
- l'école Willis (et al.), celles des participantes au genre qui ont toujours connu une présence clairement féminine au sein de la SF, présence qui leur permettait (du moins pour un partie) de distiller leur message d'égalité.
Ces deux écoles sont bien sûr souvent antagonistes, les premières trouvant que les secondes ont trahi la cause en rampant au pied du patriarcat, les secondes trouvant les premières par trop ignorantes des réalités du genre et trop promptes à oublier leur contribution.
Yaszek me parait plutôt souscrire à la seconde école qu'à la première, même si sa conclusion lie les deux en faisant découler la révolution féministe en SF du travail des pionnières.
Sa thèse, à savoir l'utilisation d'une sorte de vision future de la sphère domestique pour faire passer des idées progressistes sur le rôle de la femme et l'emploi des tribunes offertes par le genre pour promouvoir une autre voie que la société patriarcale, est très bien présentée et appuyée sur des exemples concrets, même si l'on pourra toujours regretter une certaine concentration sur un petit nombre d'auteurs (la place prise par Merrill, est AMHA un peu disproportionnée, mais elle est la seule à avoir fait l'objet d'une biographie aisément disponible).

On notera qu'une partie importante du texte est consacrée à la présentation du contexte social et de ses enjeux, chose précieuse pour des non-américains.
L'écriture est facile et le discours reste très mesuré (ce n'est pas du Russ) mais n'en est pas moins lucide et critique, même si la conclusion sonne parfois un peu trop PC dans les lauriers tressés à la vague féministe et dans une certaine (AMHA) exagération de sa place actuelle et de son influence au sein du genre.
On regrettera juste quelques redites (des paragraphes entiers sur Merrill repris à l'identique dans les chapitres 1 et 4) et une impression (assez floue, je le concède) d'un léger manque de profondeur, générée à la fois par certaines affirmations qui sonnent un peu faux à la lumière d'autres travaux (par exemple la place "importante" d'Amazing sur la scène SF dans les années traitées me parait douteuse) et ce qui me parait être un manque de familiarité avec la totalité du matériau primaire disponible (les textes parus en revue entre 1945 et 1965), matériau peu accessible il est vrai.
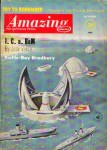
Mais ces quelques points ne doivent pas masquer le fait qu'il s'agit de la meilleure, la plus claire et la plus complète présentation du travail des auteurs féminins de SF de l'après 2GM. A ce titre et dans une perspective historique de la SF, c'est un ouvrage indispensable.
Note GHOR : 3 étoiles
15:06 | 15:06 | Ouvrages thématiques | Ouvrages thématiques | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : sf, feminisme, anglais, 3 étoiles | Tags : sf, feminisme, anglais, 3 étoiles
_Harry Harrison_
Harry Harrison : Leon STOVER : Twayne Publisher (série TUSAS #560) : 1990 : ISBN-10 0-8057-7603-6 : 141 pages (y compris index et biblio) : une dizaine d'Euros pour un HC (qui a probablement une jaquette comme certains autres ouvrages de la même série, d'où l'image ci-dessous, un peu étrange).

Cet ouvrage nous offre un panorama de l'oeuvre de Harry Harrison, écrivain au positionnement et au parcours atypique, successivement star de Analog puis leader de la SF anti-militariste pour finir par être surtout connu comme auteur ou concepteur à la chaîne de sequelles médiocres à ses plus grands succès (séries 'Bill' & 'Ratinox').
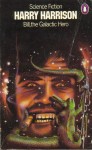
Il est organisé en 11 chapitres se concentrant sur diverses parties de l'oeuvre de Harrison (romans et -un peu- nouvelles), correspondant soit à des thèmes (politique, économie), à des styles (humour, parodie) ou à des séries (Ratinox, Deathworld, Bill, West of Eden). Seuls échappent à ce principe le premier chapitre qui est une sorte d'introduction à la proto-SF directement extraite d'un autre ouvrage de référence et le deuxième qui est une courte biographie de l'auteur.
Comme souvent avec Stover, le résultat final est plutôt décevant.
On peut passer sur les habituelles approximations et conneries : Campbell devenant rédacteur en chef d'Astounding en 1947 ou la pittoresque série policière française 'Arsine Lupin' due à Ponson du Terrail.
On peut aussi passer aussi sur les vrais bouts de messages idéologiques propres à Stover (capitalisme et religion marchant main dans la main pour nous libérer de tous ces maudits gauchistes utopistes), moins fréquents mais largement aussi pénibles (et surtout sans intérêt dans le cadre d'une telle étude) que dans son Robert Anson Heinlein.
On peut même excuser le premier chapitre qui est plus du remplissage d'un ouvrage bien mince (10 pages sur 120 pages de texte) qu'un éclairage quelconque sur l'auteur puisqu'il n'a aucun rapport avec lui.

Ce qui est vraiment dommage, c'est que Stover, qui a quand même collaboré avec Harrison (sur le roman Stonehenge) et qui semble être un intime, n'ait pas réussi à nous faire partager les ambitions ou les motivations de l'auteur, chose qui aurait été un plus indiscutable dans un ouvrage voulant un tant soit peu analyser un auteur.
A la place on a "Stover raconte l'intrigue des textes de Harrison" ou "Stover recopie les dossiers de presse de Harrison" ou "Les causeries de Tonton Stover". Ce n'est pas forcément mal fait mais c'est hyper-schématique, peu creusé pour ce qui est de la SF et du contexte des oeuvres (personnel ou général, cf le premier Bill dont l'histoire de la génèse est escamotée) mais trop détaillé sur des sujets connexes, comme par exemple plusieurs pages sur les diverses époques de la préhistoire (l'Holocène, le Néolitique etc...). On notera aussi que si Stover ne semble pas avoir grand chose à dire sur Harrison, il est beaucoup plus prolixe sur Stover.
Du coup, on préfèrera nettement Harrison sur Harrison (Hell's cartographers, pas tout jeune mais pertinent) ou Tomlinson sur Harrison (Harry Harrison An annotated bibliography), un ouvrage structuré différement, puisque étant une biblio commentée, mais nettement plus riche au final.

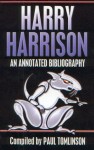
Un ouvrage à réserver aux fans de Harrison mais qui risque de les décevoir tant il est 'léger' en info et/ou en analyse.
Note GHOR : 1 étoile
10:22 | 10:22 | Etudes mono-auteur | Etudes mono-auteur | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : harrison, sf, stover, 1 étoile, anglais | Tags : harrison, sf, stover, 1 étoile, anglais
03/11/2008
_Anthony Boucher : A biobibliography_
Anthony Boucher : A biobibliography: Jeffrey MARKS : McFarland : 2008 : ill photo + image de stock : ISBN-13 978-0-7864-3320-9 : 212 pages (y compris index & biblio) : une grosse vingtaine d'Euros (port compris) pour un TP.
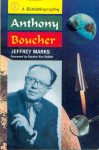
Comme l'indique son sous-titre, cet ouvrage est une biobibliographie (un terme original qui décrit toutefois bien le produit) consacrée à Anthony Boucher.
La chose est connue, Anthony Boucher est le pseudo le plus célèbre (en tout cas dans le domaine de la SF) de William Parker White. Sous ce pseudo, il a écrit un certain nombre de nouvelles (un petite cinquantaine) dans le genre qui nous intéresse, textes qui ont eu une réception favorable mais sans plus.
Ses titres de gloire dans le domaine sont en fait d'avoir été le premier rédacteur en chef de F&SF (de 1949 à 1958) ainsi qu'un critique réputé. Il est aussi l'auteur du fameux Rocket to the morgue,un roman policier "à clef" qui se déroule durant une convention de SF et qui a comme personnages des auteurs de SF à peine déguisés (Heinlein, Cartmill, Campbell et les membres de la fameuse Manana Society).
Outre ses nombreuses autres casquettes (traducteur, animateur radio, amateur d'opéra) Boucher (le nom qu'il semblait préférer) est aussi un des grands du romans policier. Il a d'ailleurs été honoré par plusieurs Edgars (similaires aux Nébulas), essentiellement pour sa production critique plus que pour ses quelques romans et nouvelles.
Ce livre est divisé en deux parties :
- une première partie de texte (la biographie) qui couvre successivement (en recommençant à chaque fois si besoin est) les diverses facettes de Boucher : l'homme (la partie biographique 'classique'), l'auteur (Policier & SF), l'éditeur (lire rédacteur en chef en VF) et le critique.
- une seconde partie de données (la bibliographie) qui groupe les écrits de Boucher par grandes catégories :
Romans (policier uniquement)
Articles
Nouvelles parues en recueil
Nouvelles non reprises en recueil ou carrément non publiées
Sherlockania
Pièces et scénarii
Critiques (lieu de parution seulement, pas d'index -trop lourd ?-)
Programmes de radio
Programmes d'opéra
Anthologies
Traductions
Biblio secondaire
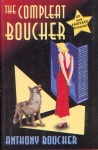
Il s'agit là du premier ouvrage consacré à cet acteur important du genre (seuls quelques articles existaient sur lui). Force est de constater que, malgré un sujet 'neuf', ce livre ne m'a que très moyennement convaincu.
Non pas parce que la partie concernant la SF (celle m'intéressant au premier chef) est assez faible (en volumétrie elle correspond au prorata de la part de la SF dans les activités de Boucher, je dirais au mieux 30%), mais parce que cet ouvrage manque cruellement de méthode.
En effet la première partie biographique est, de par sa structure, extrêmement décousue et peu simple à lire. Ce qui est arrivé à l'auteur durant l'année X doit être recherché dans les quatre parties (une par "métier") et parfois même dans les subdivisions de ces parties (par exemple la partie 'Le critique' se subdivise en critique de SF, policier, opéra...).
Du coup, on n'a pas du tout de perspective sur l'évolution personnelle de Boucher, sur sa trajectoire dans les genres qu'il pratiquait puisque la partie biographie est découplée de la partie SF. Idem pour les possibles influences du Boucher critique sur le Boucher écrivain qui sont traitées séparément, alors que ce genre de dialogue peut être assez riche (cf. James Blish/William Atheling Jr.).
De plus, le texte en lui-même est assez basique au niveau de son style et de sa narration. Après lecture attentive, il se trouve extrêmement pauvre en information. Marks abuse aussi des citations (de Boucher ou d'autres sources) qui me semblent trop nombreuses, d'un lien ténu avec les points soulignés et peut-être le signe du choix d'une certaine facilité dans l'analyse.

Sur la seconde partie (la bibliographie), c'est encore pire. Même si elle semble exhaustive, elle se trouve être proche de l'inexploitable. Par exemple, pour trouver les parutions d'une nouvelle de SF de l'auteur, il faut tout d'abord savoir dans quel recueil (uniquement ceux-là, pas les magazines ni les anthologies) elle est sortie. Après, si elle est parue dans plusieurs livres (par exemple Balaam), il faut choisir entre The compleat Boucher et Far away parce qu'il n'y a pas les mêmes informations (rééditions) pour ce même texte dans chaque entrée.
Vous pouvez aussi chercher les références de ces fameux recueils qui conditionnent l'accès aux nouvelles, elles n'y sont pas, idem pour les rééditions des romans (pas toutes mentionnées).
Pas non plus de date et lieu pour les pièces radiophoniques et de lieu ou cote de consultation pour les textes inédits, ce qui pose le problème de la fiabilité.
Pas plus d'indication des TO des nouvelles et romans traduits par Boucher (certains romans policiers français par exemple).
En ce qui me concerne, j'estime que c'est un travail bibliographique de mauvaise qualité. Sans nier la quantité de travail fournie par Marks, l'utilité de l'ensemble est discutable puisque son côté brouillon, le rend impropre à une utilisation sérieuse avec de bonnes garanties d'exactitude. Comme souvent dans ce type d'ouvrage, la partie bibliographie aurait pu laisser sa place à une partie biographie/analyse plus étoffée (la biblio étant réduite à une courte liste) ou faire l'objet d'un volume à part uniquement centré sur cet aspect de l'oeuvre de Boucher.
On touche peut-être la différence de maturité entre les ouvrages de référence sur la SF et ceux sur le Polar aux USA, ce dernier domaine me semblant encore moins 'défriché' que le notre.
Note GHOR : 1 étoile (pour le sujet original)
14:57 | 14:57 | Biographies & autobiographies | Biographies & autobiographies | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : boucher, f&sf, biographie, 1 étoile, anglais | Tags : boucher, f&sf, biographie, 1 étoile, anglais
24/10/2008
_Political science fiction_
Political science fiction: Donald M. Hassler & Clyde Wilcox : University of South Carolina Press : 1997 : ISBN-10 1-57003-113-4 : 256 pages (y compris index et biblios éventuelles) : une vingtaine d'euros pour un HC avec jaquette.

Cet ouvrage est en quelque sorte le premier volume d'une série de recueils d'essais qui s'est poursuivie par New boundaries in
political science fiction que j'ai récemment évoqué.

Il rassemble donc aussi des textes portant sur l'angle politique de la SF. Il est d'ailleurs frappant de voir la similitude (ou la permanence) des sujets abordés dans ces deux ouvrages, à croire que certains sujets ou écrivains sont particulièrement attractifs pour qui veut lier ces deux thèmes.
Au sommaire :
- l'utopie (Wells, Le Guin) ou la dystopie (Swift, Pohl & Kornbluth).
- le Cyberpunk, un article élogieux qui tranche avec celui de 2008.
- Dune, un texte qui lie les romans du cycle avec la pensée de Machiavel.
- Heinlein, avec une analyse de The moon is a harsh mistress (en parallèle avec Triton et Les dépossédés) et un article sur Starship troopers visiblement un livre qui fait toujours débat.
- l'Amérique latine et la SF qui s'y écrit.
- Star Trek, trois articles (!), le premier sur les typologies de gouvernement que l'on y rencontre, l'un sur les problématiques de genre et l'autre sur la politique US des années 60-90 telle que reprise dans la série TV (l'ancienne et TNG).
- une tentative de classification des gouvernements extraterrestres imaginés par les auteurs de SF.
Même en faisant effort d'originalité, je ne peux que faire les mêmes commentaires que sur New boundaries in political science fiction du fait de la grande similarité formelle et conceptuelle de ces ouvrages. Je tiens à préciser que, même s'ils abordent les même thèmes, ils sont complémentaires et ne se recoupent pas.
Les essais sont de qualité et sont agréables à lire. Je dirais même que ce premier volume est un peu supérieur au deuxième, même si je suis toujours surpris de la quantité de choses que des académiques arrivent à lire dans des épisodes de Star Trek. C'est toutefois clairement un ouvrage américano-centré (même s'il est parfois très critique des actions US) et cet aspect pourra éventuellement le distancer de notre sensibilité européenne.
C'est donc un ouvrage à acquérir qui, pour un prix modique, offre une vaste palette de pistes de réflexion à l'amateur.
Note GHOR : 2 étoiles (et demi ^_^)
11:20 | 11:20 | Ouvrages thématiques | Ouvrages thématiques | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : 2 étoiles, anglais | Tags : 2 étoiles, anglais


