23/01/2009
_To seek out new worlds : Exploring links between science fiction and world politics_
To seek out new worlds : Exploring links between science fiction and world politics : Jutta WELDES (editor) : Palgrave McMillan : 2003 : ISBN-10 1-4039-6058-5 : 230 pages (y compris index -noms propres et thématique- et notices bibliographiques) : une grosse dizaine d'Euros pour un TP.

Cet ouvrage est un recueil d'essais rassemblés par Jutta WELDES (elle signe d'ailleurs le premier) sur le thème de la rencontre entre les International Relations (IR en abrégé, diplomatie en VF) et la SF. Cette interaction est une chose qui est assez régulièrement étudiée aux USA, à tel point qu'il existe même une anthologie commentée qui s'appelle International relations through SF (New Viewpoints 1978).

La possibilité d'un tel lien est due au fait que les "clients" des deux systèmes sont les mêmes (les citoyens US) et qu'ils se nourrissent un peu l'une de l'autre, la SF offrant un terrain de simulation vierge et la diplomatie utilisant parfois des métaphores SF pour se justifier.
Le livre est organisé en neuf essais d'une longueur assez homogène (une vingtaine de pages chacun) qui traitent des sujets suivants :
- Une introduction globale au projet (Weldes).
- La diplomatie dans Star Trek et ses parallèles avec la diplomatie US réelle (Neumann).
- Les problèmes de communication posés par les situations de "first contact" dans Star Trek : The next generation (Inayatullah).
- Le concept de l'alien dans trois films dont deux de SF (Blade runner, Chute libre et Matrix) (Lipschutz).
- La souveraineté et l'espace social dans Buffy (et ses spin-offs) (Molloy).
- Une étude de Stalker (le film) sous l'angle de la loi et de la souveraineté (Hozic).
- Une analyse de l'évolution de la réprésentation des Borgs (dans STTNG) passant du statut de collectif étranger et menaçant à une simple dictature à abattre (Jackson & Nexon).
- Le problème de la représentation de l'autre au travers de Star Trek, Starship troopers (le film ici aussi) et Chroniques martiennes (Whitehall).
- Les utopies féministes (Crawford).
La lecture de la liste des sujets permet de voir qu'il s'agit d'un ouvrage qui se concentre d'une façon quasi-exclusive sur la SF portée à l'écran (petit ou grand). Du coup, ma modeste connaissance de Star Trek (je n'ai vu que trois long-métrages et une partie des épisodes de la série TV originelle) m'a peut-être empéché de saisir tout le sel des démonstrations. En effet, la plus grande partie des analyses et des exemples (largement plus de 50%) lui est consacrée, certainement à cause de son côté populaire et emblématique de la SF dans l'esprit du grand public.
Malgré cette ignorance de ma part, les essais sont intéressants à lire et l'éclairage fourni sur la politique diplomatique US tant dans sa philosophie que son exécution est le bienvenu. Il est frappant de voir comment la sphère de l'imaginaire peut souvent prédater/influencer/être utilisée par les discours officiels dans le domaine de la diplomatie US, un constat similaire ayant aussi pu être fait pour les questions de défense nationale par Franklin. Il y a aussi des petits bouts bien sympathiques comme une évaluation négative (mais assez juste AMHA) de la baudruche Matrix.

Ce sont donc des textes d'un bon niveau général à l'exception de 1) l'avant dernier pour cause de jargon envahissant et d'un abus de Kant & Heidegger et 2) le dernier essai, couplet obligé dans tout ouvrage universitaire sur la SF, dont le traitement des utopies féministes manque singulièrement d'originalité (et encore une couche de Russ, Le Guin, Piercy, Sargent, Gilman...) et surtout d'un quelconque lien avec la diplomatie.
Un ouvrage plus agréable que je ne l'aurais cru de prime abord, mais qui sera certainement encore plus apprécié par un trekkie confirmé.
Note GHOR : 2 étoiles
14:00 | 14:00 | Ouvrages thématiques | Ouvrages thématiques | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : anglais, 2 étoiles | Tags : anglais, 2 étoiles
21/01/2009
_The world Hitler never made : Alternate history and the memory of nazism_
The world Hitler never made : Alternate history and the memory of nazism : Gavriel D. ROSENFELD : Cambridge University Press : 2005 : 0-521-84706-0 (ISBN 10) : 978-0-521-84706-3 (ISBN 13) : 524 pages (dont index, appendices + bibliographie) : une grosse vingtaine d'Euros pour un HC (avec jaquette).
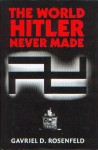
Cet ouvrage est une analyse du traitement par l'uchronie du nazisme par le biais de ses principales conséquences ou acteurs (Hitler, la 2GM, l'Holocauste) qui permet de s'interroger sur la normalisation (au sens de de devenir un fait historique comme un autre et non une exception) de ces éléments dans notre société.
Il est divisé en trois grandes parties :
- "Les nazis gagnent la 2GM" qui étudie pays par pays (USA, GB, Allemagne & reste du monde) les oeuvres uchroniques (romans, nouvelles, essais, films, séries TV, comics) qui montrent une victoire nazie dans ce conflit et quelles en sont les conséquences. On notera qu'il ne s'agit pas de rejouer les batailles (la mécanique de la victoire n'y est pas le point focal). Au début (pendant la guerre et juste après), présentée comme une catastrophe, l'hypothétique victoire nazie devient de plus en plus souvent un évènement "value-neutral", parfois même un simple décor au milieu d'autres situations uchroniques devenues standardisées.
- "Hitlers alternatifs" nous montre les diverses oeuvres qui décrivent une tentative de modifier le cours de l'histoire en agissant sur Hitler (assassinat, changement de carrière vers l'artistique ou l'architecture...) ou en montrant sa fuite après la chute de Berlin. Ici aussi, on passe au fil du temps d'un Hitler complètement maléfique à une certaine humanisation du personnage.
- "Hypothétiques Holocaustes" est la partie la plus courte qui liste les oeuvres qui proposent carrément de modifier l'Holocuaste, soit en le parachevant, soit en le faisant échouer.

Organisé donc thématiquement puis chronologiquement, ce livre balaye plus d'une centaine d'oeuvres uchroniques (en majorité littéraires) pour en montrer l'évolution (différente selon les pays mais généralement convergente) vers une sorte de normalisation du nazisme et de ses horreurs, qui passe du statut de crime exceptionnel à "génocide commun". Évolution qui se fait bien sûr sous l'usure du temps et sous l'impulsion de divers agendas politiques. Il est à noter que, outre l'analyse des textes, Rosenfeld est très documenté sur les motivations des auteurs et précise clairement quels sont les facteurs politiques ou idéologiques (souvent grâce à ses communications avec eux) qui se cachent derrière celles-ci.
C'est un travail solide, parfaitement documenté et qui, en plus des classiques (Le maître du haut-château, SS-GB, Fatherland, Le moindre des fléaux, Making history...), plonge parfois dans les profondeurs d'Astounding ou nous convie à visionner des épisodes de Sliders pour y puiser matière à réflexion.
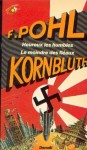
C'est donc à la fois une étude sur un pan de la SF, mais aussi sur l'histoire et la mémoire. Un très bon livre, dont le seul frein à la lecture est peut-être l'abus de notes, puisqu'il y en a pour 90 pages (!), hélas reportées en fin d'ouvrage (AMHA pas le plus pratique); toutes n'étant pas strictement indispensables. Les numéros de page des citations d'un même livre (une fois celui-ci identifié) auraient gagné à être laissés dans le corps du texte.
Un ouvrage d'une grande spécialisation qui n'a pas forcément vocation à se retrouver dans toutes les bibliothèques.
Note GHOR : 3 étoiles
11:07 | 11:07 | Ouvrages thématiques | Ouvrages thématiques | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : anglais, 3 étoiles, uchronie | Tags : anglais, 3 étoiles, uchronie
14/01/2009
_Fights of fancy : Armed conflicts in science fiction and fantasy_
Fights of fancy : Armed conflicts in science fiction and fantasy : George SLUSSER & Eric S. RABKIN : University of Georgia Press : 1993 : ISBN-10 0-8203-1533-8 : 223 pages (y compris index global et parfois notices bibliographiques) : une grosse dizaine d'Euros pour un TP.

Ce volume rassemble 15 essais parmi ceux qui ont été présentés lors de la 10ème conférence J. Lloyd Eaton, en 1988. Ils répondaient à la question de savoir si les conflits armés étaient toujours un aspect central de la SF&F.
Le résultat de ces cogitations se présente donc sous la forme de ces quinze essais, d'une longueur assez homogène (entre 10 et 20 pages) souvent dus aux plumes des habitués de l'exercice (le petit groupe des académiques proches de la SF).
Sont donc abordés les thèmes suivants :
- Réimaginer la guerre (Rabkin)
- La sémantique du conflit (Bretnor)
- Les schémas linguistiques comparés dans les discours des héros et des méchants (Westfahl)
- Les textes de Osip Senkovsky, auteur russe du XIXème (Pedrotti)
- Le désir de la première GM dans la fiction (Davies)
- Le guerre chez Wells (Turner)
- La guerre des sexes (Arbur)
- La guerre du Viet-Nam vue par l'auteur (Haldeman)
- La BD de Druillet La nuit (Radisich)
- Le cinéma post-apo (Fitting)
- Le roman de Delany Dahlgren (Clayton)
- Le champignon atomique comme image divine (Dalrymple)
- Les agendas cachés des créateurs de récits de fin du monde (Bartter)
- L'opposition entre monde occidental et tiers-monde dans certains films (Slusser)
- Le personnage du solitaire dans les films SF (Landon)
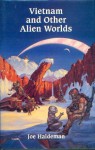
Comme on le voit à la lecture des sujets traités, le thème de la conférence (le conflit armé) n'a pas forcément inspiré les auteurs. C'est fréquemment le cas dans ce type d'ouvrage où, peut-être par manque de matériel utilisable, les essais présentés n'ont parfois qu'un rapport très lointain avec la thématique choisie.
En gros, seule une grosse moitié des essais ont un rapport avec le conflit (armé) dans la littérature SF&F. Les textes sur Druillet, Delany ou Senkovsky ont d'ailleurs recours à des jolies contorsions pour justifier leur place (généralement pas référence à une vague guerre qui précèderait ou entourerait le récit), d'autres comme le Slusser (un des co-éditeurs) sur Rambo et Bruce Lee se dispense même souvent de justification. Le sommet est certainement le texte de Westfahl qui compare statistiquement la structure syntaxique des dialogues prononcés par les catégories de personnages (gentils et méchants). L'autobiographie de Haldeman parle certes de guerre mais n'est pas non plus vraiment pertinente. Le lien entre ce que l'auteur a vécu et ses oeuvres n'est fait qu'à la fin et simplement pour la forme.
Il ne faudrait pas penser que ces textes hors-sujet sont les moins intéressants. Par exemple, le Westfahl est probablement (avec le Bartter) le meilleur du lot. Partant d'une base strictement factuelle (nombre de mots, lisibilité, assertivité...), il en tire des conclusions à la fois évidentes mais surprenantes quand on les lit (le méchant est éduqué, le héros non) qui donnent vraiment envie que Westfahl creuse le sujet avec, par exemple, un échantillonage de textes plus important.
Certains textes sont d'un niveau moins élevé, soit par idéologie envahissante (Arbur), soit à cause d'un sujet peu passionnant (la SF russe non-traduite en anglais de 1833) soit à cause de contraintes techniques, comme le texte sur Druillet qui pâtit de la difficulté d'analyser une BD sans en montrer une seule image (en tout cas le sujet est original pour un ouvrage US).
Un ouvrage qui offre un peu de tout, comme c'est souvent le cas, avec un bon niveau même si le contrat de base (analyser les rapports entre le genre et la guerre) n'est pas vraiment rempli.
Note GHOR : 2 étoiles
10:44 | 10:44 | Ouvrages thématiques | Ouvrages thématiques | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : anglais, 2 étoiles | Tags : anglais, 2 étoiles
06/01/2009
_Ultimate island : On the nature of british science fiction_
Ultimate island : On the nature of british science fiction : Nicholas RUDDICK : Greenwood Press : 1993 : 202 pages (y compris bibliographie & index) : ISBN 0-313-27373-1 : en occase pour quelques dizaines d'euros, en neuf pour une centaine; le tout pour un HC (sans jaquette).

Cet ouvrage a pour but de cerner les spécificités de la SF britannique, dans la mesure où elle existe, principalement en la mettant en opposition aux autres SF (et dans celles-ci, essentiellement la SF US).
Il est divisé en quatre chapitres principaux :
- "Critical assumptions : The idea of british science fiction" : Ruddick trace dans les divers ouvrages consacrés à ce sujet, l'évolution de la pensée théorique sur ce qui "fait" la SF britannique, à la fois par rapport à la SF 'en général' (lire US) et par rapport à la littérature britannique mainstream. Au final, le résultat de ses réflexions est le constat que la SF UK est, plus que d'autres, plutôt bien intégrée à la littérature générale de son pays. La preuve en est donnée par le nombre important d'ouvrages ou d'auteurs SF qui font partie du canon littéraire (Wells, Lewis, Orwell, Huxley, Amis...).
Cette partie est la plus difficile de toutes, non qu'elle ne soit pas claire mais elle nécessite une certaine connaissance à la fois de l'histoire de la SF britannique et surtout des diverses théories et approches de la SF UK qui sont abordées par Ruddick. En effet, l'auteur ne va pas très loin dans les détails des diverses thèses en présence, ce qui est normal sur 200 pages.
Il vaut donc mieux avoir lu Aldiss (Billion year spree), Grifiths (Three tomorows), Ketterer (New worlds for old), Greenland (The entropy exhibition), Stableford (pas lu) ou Clarke (Voices prophesying war 1763-1984) pour pouvoir suivre dans ce chapitre assez dense.

- "The island of Mr Wells" : pose l'île comme motif principal de la SF UK, en traçant sa présence, sous forme littérale ou métaphorique dans une suite continue de textes majeurs (de Shakespeare & More à Ballard en passant par Wells ou Golding) qui forment, pour Ruddick, la colonne vertébrale de la SF UK. En ce qui me concerne, j'ai trouvé que le motif de l'île, tel qu'utilisé par Ruddick, est tellement malléable qu'il peut s'appliquer à n'importe quel ouvrage (The inheritors de Golding, The star de Wells). Cette partie aurait gagnée à être approfondie avec plus d'exemples parce que, intuitivement, on sent bien que l'insularité et sa revendication est une caractéristique britannique très forte, qui n'est certainement pas sans influence sur la SF qui y est écrite, mais cet a priori aurant gangé à être plus étayé avec des exemples où la notion d'insularité est centrale.
- "Peopling the ruins" & "The nature of the catastrophe" : sont deux chapitres qui traitent de la spécificité de la SF UK dans sa thématique de la catastrophe (qu'elle soit cosy ou pas). C'est la partie la plus classique (au sens de proche de l'analyse standard) du livre. Un discours que l'on a pu lire de nombreuses fois (sous la plume d'Aldiss par exemple), qui va de Shelley à Ballard en passant par Wells, Wyndham ou Christopher. Ballard est d'ailleurs particulièrement envahissant puisqu'une grande partie du chapitre lui est consacrée, alors que le rapport entre la pornographie de Crash et la catastrophe (au sens habituel du terme) n'est pas si évident.
Ruddick conclut par sa définition de la SF UK, à savoir une suite de textes qui partagent le motif de l'île comme scène d'une lutte darwiniste, reliés entre eux et reliés au reste de la littérature britannique, le tout sous l'influence (ou en réaction à) de Wells.
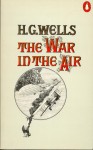
La thése de Ruddick est donc intéressante et bien argumentée. C'est un ouvrage qui atteint son objectif, à savoir de faire réfléchir à sa propre définition de la SF UK et qui donne irrésistiblement envie de discuter (même à distance comme je le fais) avec l'auteur sur le sujet. C'est là le plaisir principal de ce type d'ouvrage de référence.
Personnellement, je ne souscris pas à sa méthodologie, à savoir qu'il ME (sans plus de valeur que cela) donne l'impression d'avoir fait les choses à l'envers. Au lieu de chercher à déterminer des critères discriminants applicables à un ensemble de textes, il semble être parti du résultat, un ensemble de textes canoniques représentant pour lui la SF UK et en avoir dérivé un jeu de critères permettant de les isoler. Du coup, tout ce qui ne rentre pas dans les oeuvres pré-sélectionnées par Ruddick est classé dans la catégorie SF US et se trouve donc, d'une façon parfois un peu trop pratique/rapide, poussé hors de champ de l'étude. L'auteur donne d'alleurs des explications, assez alambiquées dans la conclusion où il finit par mentionner plus ou moins pour la première fois des auteurs aussi "britanniques" que Clarke, Brunner, Shaw, Watson, Roberts (Keith), Stableford ou Moorcock et en les évacuant immédiatement manu-militari du "champ" de la SF UK (qui n'est, pour Ruddick, pas un "genre").

Bien sûr, les pinailleurs dans mon genre tiqueront sur des affirmations du genre "That Lewis was not totally unsympathetic to american pulp science fiction can be established by the fact that he published a story in The magazine of fantasy and science fiction...", qui ne prouve justement rien puisque F&SF n'est typiquement pas un pulp et s'est toujours distingué de ces derniers ou de leurs héritiers; ou sur des tautologies comme "Rather, an island is a land that [...] seems insular to its inhabitants [...]" ("une île est un lieu qui semble insulaire à ses habitants", ce qui paraît assez normal). Mais comment ne pas apprécier un théoricien de la SF qui affirme que l'expression "American Science Fiction" est un pléonasme.
Au bémol près d'une première partie assez technique, c'est un ouvrage riche en analyse et surtout une vraie base de réflexion sur l'existence même ou la matérialisation d'une éventuelle spécificité nationale dans la SF.
Note GHOR : 3 étoiles
14:00 | 14:00 | Ouvrages thématiques | Ouvrages thématiques | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : anglais, 3 étoiles | Tags : anglais, 3 étoiles
02/01/2009
_Intersections : fantasy and science fiction_ & _Bridges to science fiction_
Intersections : fantasy and science fiction : George E. SLUSSER & Eric S. RABKIN : Southern Illinois University Press : 1987 : 252 pages (y compris index) : ISBN 0-8093-1374-X : en occase pour quelques dizaines d'euros pour un HC avec jaquette.

Bridges to science fiction : George E. SLUSSER & George R. GUFFEY & Mark ROSE : Southern Illinois University Press : 1980 : 168 pages (y compris index) : en occase pour quelques dizaines d'euros pour un HC avec jaquette.

Un avis global sur deux livres similaires dans leur principe et le résultat obtenu. Ces ouvrages sont donc des recueils d'essais contenant chacun une dizaine de textes (plus nombreux et plus courts dans le premier que dans le second). Ce dernier (Bridges) correspond (IIRC) aux minutes de la toute première conférence sur le fantastique dans les arts, ce qui peut expliquer la piètre qualité des contributions, prévisible pour une manifestation dans sa première instance.
Ce sont donc des livres purement académiques, à la fois par le fait que le public ciblé est celui des bibliothèques universitaires et par le fait que l'on puisse penser qu'une publication dans ces supports rapporte des points pour une carrière. Du coup, les essais sont souvent (logique à l'époque) écrits par des gens dont les domaines de compétences ne sont généralement pas la SF. Seules exceptions, les universitaires dont le champ d'étude est justement la SF (Slusser, Rabkin) et quelques auteurs comme ici Benford ou Zelazny.
C'est sans doute pour cela que je ne leur trouve aucun intérêt, le canevas de chaque court article étant le même, un début avec un très vague rapport avec la SF et une bifurcation immédiate vers le domaine de prédilection (ou de spécialité) de l'auteur. Ceci nous vaut par exemple des pages de citations en latin, des essais sur Faulkner, sur Gravity's rainbow ou sur Shakespeare, certainement très érudits, mais qui, au final, n'apportent absolument aucun éclairage sur la SF. De toute façon, de leur aveu écrit même, certains intervenants connaissent peu très peu le genre.
Seuls quelques essais arrivent à surnager (celui de Delany par exemple) dans cette mer de médiocrité. C'est dommage parce que le premier ouvrage (qui est nettement le meilleur des deux) aurait pu ouvrir des pistes sur les relations entre SF & Fantasy avec une discussion (hélas avortée) du genre hybride qu'est la Science-Fantasy. Il est probable qu'à l'époque la réflexion sur ce thème était trop peu developpée (surtout du côté Fantasy) pour pouvoir aboutir.
Deux ouvrages que l'on peut aisément éviter, si ce n'est pour faire joli et sérieux dans une bibliothèque.
Note GHOR : 1 étoile pour Intersections, 0 étoile pour Bridges to science fiction.
10:01 | 10:01 | Ouvrages thématiques | Ouvrages thématiques | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : anglais, 1 étoile, 0 étoile | Tags : anglais, 1 étoile, 0 étoile


