05/01/2010
_Future imperfect : Science fact and science fiction_
Future imperfect : Science fact and science fiction : Rex MALIK (editor) : 1980 : Frances Pinter : ISBN-10 0-903804-64-6 : 219 pages (pas d'index ni de bibliographies) : coûtait 25 USD pour un HC avec jaquette avec quelques rares illustrations en N&B.

Ce livre est la compilation des communications présentées lors d'un séminaire tenu en 1979 à St Paul de Vence sous l'égide de la firme Sperry Univac (informatique et systèmes de défense). Cette rencontre rassemblait des écrivains de SF et des professionnels de l'informatique (lourde à l'époque) dans un sorte de symposium centré autour de la futurologie cybernétique.
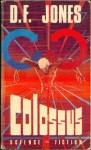
L'ouvrage se divise en cinq parties d'inégale longueur contenant entre un et quatre textes de nature variée. On trouve par exemple une histoire de la proto-SF par I. F. Clarke, la transcription d'une sécance de brainstorming sur l'écriture d'un film de SF, une interview de A. C. Clarke, divers articles de prospective classique (sur l'informatique, les satellites, la fusion homme/machine), les résultats d'un sondage présenté comme traitant des attitudes face à la SF (en fait plutôt axé sur la perception de l'avenir), une revue des ordinateurs au cinéma et des speechs d'auteurs (ici Harrison et Van Vogt). L'ouvrage ne comporte aucune annexe (index, notes ou bibliographie).
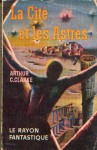
L'essentiel du livre étant surtout consacré à de la prospective "sérieuse" (lire "utile au commanditaire"), la partie pouvant intéresser les amateurs de SF est assez limitée. De plus, elle ne décolle que rarement de l'anecdotique, les présentations de Harrison et Van Vogt ou l'interview de Clarke n'apportant aucune information nouvelle, l'étude sur la SF n'en étant pas vraiment une et le panorama des ordinateurs dans les films trop rapide.

Un livre qui est plus une opération de communication d'un conglomérat appartenant au complexe militaro-industriel qu'un ouvrage sérieux sur le genre. L'exercice de futurologie qu'il représente possède pour seul intérêt de pouvoir comparer les prédictions faites avec le présent. Un exercice que j'ai tout simplement la flemme de faire.
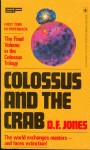
Note GHOR : 0 étoile
07:27 | 07:27 | Ouvrages thématiques | Ouvrages thématiques | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : anglais, 0 étoile | Tags : anglais, 0 étoile
04/01/2010
_Frontiers past and future : Science fiction and the american West_
Frontiers past and future : Science fiction and the american West : Carl ABBOTT : 2006 : University press of Kansas : ISBN-10 0-70061430-3 : 230 pages (y compris index) : coûtait 30 USD pour un HC solide avec jaquette (non illustré).

L'existence de liens entre la SF et le Western est une évidence. Qu'ils concernent la simple terminologie (Space opera basé sur Horse opera), le positionnement (Star Trek présenté comme Wagon train to the stars), l'imagerie (Aliens = Indiens, Far West = Mars) ou d'une façon plus fondamentale la thématique de la frontière, on peut alors dire qu'ils font que ces deux genres partagent un même élan. C'est cette thèse qui est développé par l'auteur (un professeur d'urbanisme intéressé par les deux domaines) dans cet ouvrage justement édité par une université américaine du Middlewest.
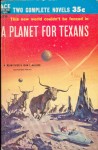
Divisé en neuf chapitres principaux (dont certains ont déjà été publiés sous une forme différente dans divers supports), ce livre explore les convergences entre les éléments communs aux deux genres. On y retrouve par exemple une discussion des types personnages récurrents comme le "space cowboy" ou l'évocation des communautés minières que l'on va retrouver dans les deux types de fiction (en SF, on pensera au film Outland ou aux mineurs d'astéroïdes). On y croisera aussi l'autochtone (lire l'extraterrestre à coloniser), la jungle urbaine comme territoire sans ordre ni loi et les nouvelles frontières cybernétiques avec leurs propres "console cowboys". On trouve en annexe les notes (peu pratique) et un index (mais pas de bibliographie).
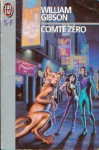
Même si la filiation entre le Western et la SF peut apparaître après coup comme une évidence, cet ouvrage est l'un des premiers à mener un travail de fond sur les parallèles entre ces deux genres, parallèles qui, comme le montre Abbott, dépassent de loin la simple apparence de la transposition du six-coups en désintégrateur. Servi par une grande maîtrise des deux genres, ce livre est suffisamment bien fait pour ne pas nécessiter de connaissances préalables sur la théorie littéraire du Western (un domaine qui semble assez exploré aux USA).

On pourra seulement reprocher à cet ouvrage un certain américano-centrisme (toutefois prévisible au vu de son sujet) puisque la représentation du Far West par les autres SF est complètement passée sous silence. Une lecture très agréable et un constat parfaitement mené sur un sujet dont on aurait pu craindre le côté "bateau".
Note GHOR : 3 étoiles
08:02 | 08:02 | Ouvrages thématiques | Ouvrages thématiques | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : anglais, 3 étoiles | Tags : anglais, 3 étoiles
15/12/2009
_Fictions of nuclear disaster_
Fictions of nuclear disaster : David DOWLING : 1987 : MacMillian : ISBN-10 0-333-39817-3 : 239 pages (y compris bibliographie et index) : coûtait 27.50 GBP pour un HC avec jaquette agrémenté de quelques illustrations en N&B.

La fin des années 80 (contexte oblige ?) a vu fleurir un certain nombre d'ouvrages de référence portant sur les thématiques de la fin du monde et/ou de la guerre nucléaire dans la Science-Fiction. On pensera aux livres de Bartter (The way to ground zero), Brians (Nuclear holocausts : Atomic war in fiction, 1895-1984), Yoke (Phoenix from the ashes) ou Seed (American science fiction and the cold war). Ecrit par un professeur d'Anglais de Nouvelle Zélande, cet ouvrage fait donc partie de cette vague de titres étudiant les penchants apocalyptiques du genre. A noter que cette édition est celle publiée pour le marché britannique et qu'il en existe une éditée simultanément par les presses de l'université de l'Iowa pour le marché américain.

Le livre de Dowling est divisé en huit chapitres d'une longueur inégale (d'un vingtaine à une cinquantaine de pages) dont les premiers abordent successivement les diverses phases d'un conflit : la bombe elle-même, les scientifiques qui la conçoivent, le conflit nucléaire, le monde post-apocalyptique. Les deux suivants traitent de thèmes connexes (l'imagerie religieuse, les autres désastres). On trouve enfin un étude ciblée sur deux romans importants (A canticle for Leibowitz de Miller et Riddley Walker de Hoban) et une courte conclusion. L'ouvrage comporte plusieurs annexes : une revue des films sur le thème, les notes des chapitres, une bibliographie des textes de fiction et un index (auteurs et thèmes). D'une façon assez étonnante, le livre est illustré d'une dizaine de reproductions pleine page de gravures religieuses du moyen-âge.
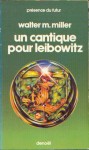
Des ouvrages sur ce thème évoqués plus haut, celui-ci est à mon avis le plus faible. Ce n'est pas qu'il s'agit d'un mauvais livre mais il n'apporte rien de plus que les autres et ne bénéficie pas des atouts de certains (exhaustivité, connaissance du genre, traitement d'autres médias). C'est essentiellement une thèse sans aucune originalité, y compris dans le choix des textes étudiés d'une façon plus approfondie dans le chapitre sept. Il existe une multitude d'étude sur le fix-up de Miller pour que celle de Dowling n'ait rien de remarquable.

Paru au moment où tout le monde se penchait sur la Bombe, ce livre (assez cher quand même) n'a pas su trouver un angle d'attaque original ce qui le rend assez superflu.
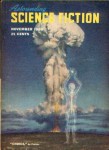
Note GHOR : 1 étoile
07:42 | 07:42 | Ouvrages thématiques | Ouvrages thématiques | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : anglais, 1 étoile | Tags : anglais, 1 étoile
11/12/2009
_Le feu aux étoiles_
Le feu aux étoiles : Gilles DUMAY : 1996 (?) : Destination Crépuscule (by Bifrost ?) : pas d'ISBN : 171 pages (pas d'index) : coûtait 55 Francs pour un TP illustré en N&B à l'encre rose de couverture assez baveuse.
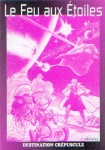
Voici un ouvrage dont le statut n'est pas clair. Visiblement coordonné par Gilles Dumay et lié à la revue Bifrost, il semble s'agir plus ou moins d'un titre réalisé en conjonction avec un festival (Space-Op 96) qui s'est déroulé à Sophia-Antipolis dont le thème est, comme son nom l'indique, le Space-Opéra (la précédente manifestation de ce type était sur les vampires). Il se présente comme s'inscrivant dans la série d'anthologies Destination crépuscule (qui a connu plusieurs éditeurs) et est illustré (en N&B) de dessins originaux (Patrick Larme et Jeam Tag), de photos et de reproductions de couvertures.
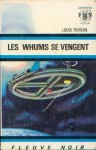
A l'intérieur, l'ouvrage est divisé en cinq parties. La première est un mélange de courtes introductions/préfaces/sommaires et d'un article de Joseph Altairac qui met en perspective ce sous-genre de la SF. Elle est suivie par l'essentiel de l'ouvrage (90 pages), la section intitulée "Littérature" qui rassemble des articles de fond (sur l'humour, sur Thirion, sur La plaie de Henneberg...), des interviews d'auteur francophones (Genefort, Ayerdahl, Deff/Wagner, Lehman, Bordage), des très courtes critiques d'ouvrages "en vrac" et une sélection de classiques. Une microscopique (7 pages) partie "Réalités" offre deux articles sur les éventuelles bases scientifiques du Space-Opéra. On trouve ensuite un article sur Star Trek par Ruaud (les restes de son ouvrage chez DLM) et enfin une nouvelle de Thiberge puis une novella de Lehman. A noter l'absence d'index et de légendes pour les images de couvertures (une habitude dans les ouvrages en VF).
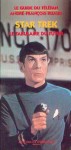
Il se dégage de ce livre au demeurant fort sympathique une impression de fouillis complet. Déjà, le mélange fiction et non-fiction est souvent (AMHA) un exercice difficile qui, pour réussir, nécessite une intégration des divers éléments nettement plus travaillée qu'ici. Alternant des articles de fond généralement intéressants et des choses plus courtes sur des sujets anecdotiques ou périphériques, l'ouvrage n'arrive jamais à trouver son rythme ni un certain équilibre. Certains textes (les notules de lecture par exemple) semblent d'ailleurs juste présents pour faire du remplissage.
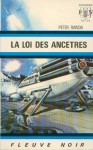
C'est dommage parce que outre des réflexions pertinentes et documentées sur le SO (dont certaines seront réutilisés telles quelles pour le livre de Colson & Ruaud), les interviews présentent une plus value indéniable (avec des photos des auteurs jeunes nous plongent dans le passé). Par contre la qualité technique de l'ouvrage est assez mauvaise avec des pages floues, une maquette abracadabrante et surtout des reproductions de couvertures faites sur une photocopieuse proche de rendre l'âme (les dessins originaux et les photos sont par contre correctement reproduits).

Au final un ouvrage plutôt mal foutu ou mal pensé qui recèle pourtant de bonnes choses. Un beau potentiel gâché par une exécution indigne (sous la pression des délais ?), dommage.
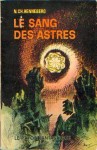
Note GHOR : 2 étoiles
12:05 | 12:05 | Ouvrages thématiques | Ouvrages thématiques | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : français, 2 étoiles, space-opéra | Tags : français, 2 étoiles, space-opéra
10/12/2009
_The feminine eye : Science Fiction and the women who write it_
The feminine eye : Science Fiction and the women who write it : Tom STAICAR (éditeur) : Ungar (série "Recognitions") : 1982 : ISBN-10 0-8044-6878-8 : 148 pages (pas d'index) : coûtait 7 USD pour un TP, existe aussi en HC (-2838-7).

Cet ouvrage est paru dans la collection Recognitions de Ungar, un ensemble de recueils d'essais sur des thèmes ou des auteurs liés soit au Policier soit à la SF. Sous la direction de Tom Staicar (comme Critical encounters II), il fait appel à l'écurie habituelle des auteurs travaillant pour Ungar, des gens assez connus dans le domaine des études sur le genre dans les années 70-80 (Arbur, Brizzi, Yoke, Barr). A la différence de la série des Critical encouters, on a ici un thème limpide : les auteurs féminins de SF.
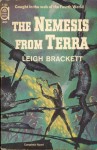
Ce court livre contient neuf essais d'une quinzaine de pages. Chacun d'entre eux est donc consacré à un auteur de SF de sexe féminin, avec, par ordre d'apparition : Brackett, Moore, Norton, Cherryh, Tiptree, Charnas, Bradley, Elgin et enfin Vinge (Joan D.). Dans la plupart des analyses la problématique de l'identité sexuelle est centrale et l'orientation féministe généralement marquée. Certains textes (celui sur Brackett par exemple) utilisent une approche plus biographique. On remarquera l'absence d'index et le report des notes en fin d'ouvrage (et non en fin d'article ou en bas de page) avec parfois l'inclusion d'une bibliographie.
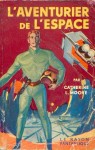
Comme souvent avec ce type d'ouvrage à plusieurs mains, le niveau général est assez variable, à la fois en fonctions des auteurs étudiés et des auteurs qui font l'étude. Il est toutefois plutôt bon grâce à des intervenants qui maîtrisent leur sujet. Même si certaines approches sont un peu trop classiques ("Toward sexual identities" pour Tiptree) ou se concentrent sur des auteurs "prévisibles" (et encore, il n'y a pas d'essai sur Le Guin ni sur Russ), on pourra louer l'attention portée à des auteurs plus rarement étudiés comme Norton ou Vinge.
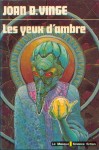
Un livre peut-être un peu moins militant que d'autres, ce qui lui permet de se concentrer plus sur les écrits que sur l'idéologie. Ceci le rend assez intéressant et génère un regret : la trop faible longueur des essais sur certains auteurs habituellement peu mis en valeur.

Note GHOR : 2 étoiles
09:03 | 09:03 | Ouvrages thématiques | Ouvrages thématiques | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : anglais, 2 étoiles | Tags : anglais, 2 étoiles


