10/12/2009
_The feminine eye : Science Fiction and the women who write it_
The feminine eye : Science Fiction and the women who write it : Tom STAICAR (éditeur) : Ungar (série "Recognitions") : 1982 : ISBN-10 0-8044-6878-8 : 148 pages (pas d'index) : coûtait 7 USD pour un TP, existe aussi en HC (-2838-7).

Cet ouvrage est paru dans la collection Recognitions de Ungar, un ensemble de recueils d'essais sur des thèmes ou des auteurs liés soit au Policier soit à la SF. Sous la direction de Tom Staicar (comme Critical encounters II), il fait appel à l'écurie habituelle des auteurs travaillant pour Ungar, des gens assez connus dans le domaine des études sur le genre dans les années 70-80 (Arbur, Brizzi, Yoke, Barr). A la différence de la série des Critical encouters, on a ici un thème limpide : les auteurs féminins de SF.
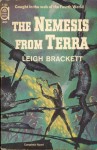
Ce court livre contient neuf essais d'une quinzaine de pages. Chacun d'entre eux est donc consacré à un auteur de SF de sexe féminin, avec, par ordre d'apparition : Brackett, Moore, Norton, Cherryh, Tiptree, Charnas, Bradley, Elgin et enfin Vinge (Joan D.). Dans la plupart des analyses la problématique de l'identité sexuelle est centrale et l'orientation féministe généralement marquée. Certains textes (celui sur Brackett par exemple) utilisent une approche plus biographique. On remarquera l'absence d'index et le report des notes en fin d'ouvrage (et non en fin d'article ou en bas de page) avec parfois l'inclusion d'une bibliographie.
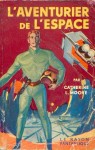
Comme souvent avec ce type d'ouvrage à plusieurs mains, le niveau général est assez variable, à la fois en fonctions des auteurs étudiés et des auteurs qui font l'étude. Il est toutefois plutôt bon grâce à des intervenants qui maîtrisent leur sujet. Même si certaines approches sont un peu trop classiques ("Toward sexual identities" pour Tiptree) ou se concentrent sur des auteurs "prévisibles" (et encore, il n'y a pas d'essai sur Le Guin ni sur Russ), on pourra louer l'attention portée à des auteurs plus rarement étudiés comme Norton ou Vinge.
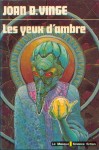
Un livre peut-être un peu moins militant que d'autres, ce qui lui permet de se concentrer plus sur les écrits que sur l'idéologie. Ceci le rend assez intéressant et génère un regret : la trop faible longueur des essais sur certains auteurs habituellement peu mis en valeur.

Note GHOR : 2 étoiles
09:03 | 09:03 | Ouvrages thématiques | Ouvrages thématiques | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : anglais, 2 étoiles | Tags : anglais, 2 étoiles
27/11/2009
_The entropy exhibition : Michael Moorcock and the British 'New wave' in science fiction_
The entropy exhibition : Michael Moorcock and the British 'New wave' in science fiction : Colin GREENLAND : 1983 : Routledge & Kegan Paul : ISBN-10 0-7100-9310-1 : 244 pages (y compris bibliographie et index) : coûtait 12 GBP à l'époque pour un HC avec jaquette.

Cet ouvrage est dû à Colin Greenland, un auteur de SF britannique surtout connu par sa série Tabitha Jute, un space opéra rétro. Basé sur sa dissertation de doctorat d'Anglais, il s'agit d'une sorte d'histoire de la New Wave au travers du magazine New Worlds et de trois de ses figures marquantes (Aldiss, Ballard et Moorcock). Ce mouvement typique des années 60 fut une tentative (principalement britannique) pour réformer la SF de l'époque, considérée comme sclérosée (particulièrement celle parue dans Analog) en y injectant à la fois des techniques littéraires novatrices et des thématiques plus dérangeantes (sexe, mort, entropie) et plus tournées vers le fameux 'inner space'.
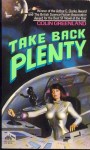
Le livre est découpé en onze chapitres d'une longueur inégale (de dix à quarante pages). Les cinq premiers forment une réflexion historique sur l'évolution des magazines de SF dans les années 60 en abordant plusieurs thèmes (le sexe, la fiction 'anti-spatiale' et l'espace intérieur). Ils sont suivis par trois chapitres consacrées chacun spécifiquement à un auteur (Aldiss, Ballard et Moorcock), le plus long étant celui sur le dernier cité. On trouve ensuite deux chapitres sur les problèmes de style, la touche finale étant donnée par une analyse de l'entropie et/ou la catastrophe (un terme cher à la New Wave). Une bibliographie (primaire et secondaire mélangée) ainsi qu'un index terminent l'ouvrage.
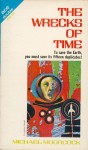
Il est toujours difficile et parfois injuste de critiquer un livre au motif de ce qu'il n'est pas. Il ne faut donc pas penser que l'on a affaire ici à une histoire de la New Wave ou même de New Worlds telle que peut la raconter Ashley par exemple. Il s'agit plutôt d'une ensemble de choses assez disparates, avec un premier groupe de réflexions allant de l'état des magazines de SF au début des années 60 (y compris le couplet habituel sur la dégénérescence d'Astounding/Analog que l'on a lu sous bien des plumes tant britanniques que françaises) à des considérations sur la série des Jerry Cornélius. On devine un deuxième ensemble constitué des trois études mono-auteurs, des textes intéressants mais qui sortent parfois nettement du cadre de l'ouvrage.
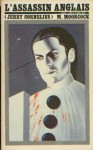
Au final c'est une impression de dispersion qui ressort de cet ouvrage. Au lieu de s'en tenir à un sujet (on peut d'ailleurs se demander lequel, Moorcock, New Worlds, la New Wave ?), on a un collage de diverses pièces dont le lien assez ténu est constitué par un vague rapport avec ces trois sujets. Ce manque de cohésion est d'autant plus regrettable que les théories de Greenland sont pertinentes et argumentées même si elles n'échappent pas à certains lieux communs de la critique SF, certains jugements hâtifs (sur l'imagerie utilisée par les magazines SF) ou des influences un peu trop pesantes (celle d'Aldiss en particulier).
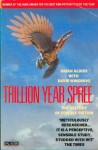
Il s'agit globalement d'un bon ouvrage qui est à décortiquer pour en extraire les éléments les intéressants. A mon avis, il aurait certainement gagné en force en étant traité d'une façon historiographique plus classique de façon a faire clairement ressortir l'histoire et l'impact de la New Wave sur la SF, un sujet important qui est trop souvent source de fantasmes.
Note GHOR : 2 étoiles
08:04 | 08:04 | Ouvrages thématiques | Ouvrages thématiques | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : anglais, new wave, 2 étoiles | Tags : anglais, new wave, 2 étoiles
14/10/2009
_Science fiction and the two cultures_
Science fiction and the two cultures : Essays on bridging the gap between the science and the humanities : Gary WESTFAHL & George SLUSSER : 2009 : McFarland (série "Critical explorations in Science Fiction and Fantasy" #16) : ISBN-13 978-0-7864-4297-3 : 282 pages (y compris index et bibliographie) : une grosse vingtaine d'Euros pour un TP, disponible chez l'éditeur : http://www.mcfarlandpub.com/book-2.php?id=978-0-7864-4297-3.

On peut dire que ce volume rassemble globalement les minutes de la 20ème "J. Lloyd Eaton conference on science fiction and fantasy literature" qui s'est tenue en 1999 aux USA (seul trois essais n'y ont pas été présentés). Il s'agit, à ma connaissance, du plus récent des nombreux ouvrages de ce type (qui sortaient avant chez SIUP) consacrés à ce symposium sur la SF qui rassemble autour d'un thème le gratin de la critique littéraire appliquée à la SF. Cette année-là, le thème était la fameuse controverse des "deux cultures" initiée par Snow et Leavis qui postulaient une sorte de schisme entre littéraires et scientifiques.

On trouve dans ce recueil, 16 essais assez courts, faisant chacun entre dix et vingt pages. Ils sont regroupés en deux grandes parties, la première consacrée au problème général des deux cultures et la seconde montrant des exemples de son traitement dans des oeuvres de SF (The first men in the moon, Against infinity, le cycle des Robots d'Asimov) ou utilisant des thématiques exportées du genre (Ratner's star de DeLillo). Les auteurs des papiers sont les éternels habitués : Slusser, Westfahl, Fredman, McConnell, Benford, Hendrix. L'ouvrage se termine par une postface de Westfahl qui est une réminiscence des conférences passés, une bibliographie des oeuvres citées (bizarrement divisée en plusieurs sections) ainsi qu'un index.
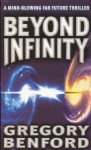
Cet ouvrage est, plus que d'autres de la même série, victime de l'effet fourre-tout. En gros on a deux types d'essais : ceux de la première partie qui se positionnent généralement dans les débat sur les deux cultures mais qui négligent de parler de SF (y compris McConnell comme à son habitude) et ceux de la seconde partie qui parlent de SF mais dont le rapport avec le sujet est au minimum peu évident.
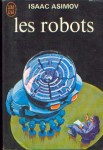
Outre ce manque d'unité, l'ensemble des textes m'a paru d'un niveau plutôt moins bons que d'habitude avec des essais complètement anecdotiques, comme cette recension des robots tueurs (et d'ailleurs quel rapport avec les deux cultures ?) ou celui sur deux ouvrages de SF roumains que personne n'a lu et ne lira jamais tellement l'auteur n'arrive pas à communiquer un quelconque intérêt pour ceux-ci. Même des intervenants généralement inspirés comme Westfahl sont à peine moyen avec sa démonstration statistique du fait que le PIB d'un pays (ici Taiwan) croît de la même façon que le nombre de livres de SF qui y sont publiés, une chose qui apparaît assez logique mais qui demande à être explicitée, chose que l'auteur évite soigneusement.
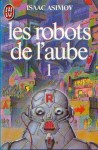
Un ouvrage trop fouillis et trop léger pour être intéressant.
Note GHOR : 1 étoile
07:37 | 07:37 | Ouvrages thématiques | Ouvrages thématiques | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : anglais, 1 étoile | Tags : anglais, 1 étoile
02/10/2009
_Le détroit de Behring : Introduction à l'uchronie_
Le détroit de Behring : Introduction à l'uchronie : Emmanuel CARRERE : P.O.L. : 1986 : ISBN-10 2-86744-070-X : 122 pages (pas d'index ni de bibliographie) : marqué 72 FRF pour un TP qui semble même pouvoir se trouver en neuf.

Membre d'une famille de l'intelligentsia française, prodige littéraire devenu cinéaste, Emmmanuel Carrère est un personnage plus associé à la littérature "blanche" qu'au petit monde de la SF. Pourtant, il a toujours affiché clairement un intérêt pour celui-ci, en particulier par cet ouvrage et par sa biographie (sic) de Dick Je suis vivant et vous êtes morts.
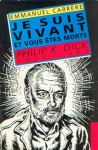
Cet ouvrage reprend le mémoire (de maîtrise ?) rédigé par Carrère au début des années 80. Il s'agit, comme son nom l'indique, d'une introduction à l'uchronie, un sous-genre de la SF qui, même si son nom et son existence sont fort anciens, restait assez peu connu en dehors du cercle des amateurs de SF. En plusieurs chapitres l'auteur nous convie à un tour de l'uchronie en détaillant un certain nombre d'oeuvres appartenant d'une façon plus ou moins centrale (il ne s'agit parfois que de quelques lignes uchroniques au sein d'un roman) à ce genre. Le tout est saupoudré de diverses considérations vaguement philosophiques de l'auteur. On notera la surprenante (pour un mémoire) absence d'index et de bibliographie.
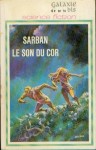
Comme le reconnaît aisément Carrère, cet ouvrage doit beaucoup à l'encyclopédie de Versins mais il est toutefois bien loin d'en posséder la rigueur. En effet, cet essai manque singulièrement d'une structure discernable (indice = les chapitres ne possèdent pas de titres) et la promenade proposée par l'auteur tourne rapidement au mouvement Brownien. Même si ce que dit Carrère est parfois pertinent, l'ouvrage est trop nébuleux pour donner une idée un tant soit peu nette de l'uchronie à un nouveau lecteur du genre.
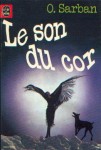
Un livre à réserver à ceux que les états d'âme ou les digressions de l'auteur peuvent intéresser (on remarquera une conclusion du style "laissons tomber l'uchronie pour vivre le réel" qui tue littéralement le projet du livre). Un essai qui, faute de mieux, faisait autorité sur le sujet mais qui est heureusement maintenant remplacé par les divers travaux d'Eric Henriet. Une curiosité bien dans l'esprit de ces livres sur la SF écrits par des gens extérieurs au genre où l'absence de connaissance du domaine est masquée par des artifices.

Note GHOR : 1 étoile
09:27 | 09:27 | Ouvrages thématiques | Ouvrages thématiques | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : français, 1 étoile, uchronie | Tags : français, 1 étoile, uchronie
29/09/2009
_Demand the impossible : Science fiction and the utopian imagination_
Demand the impossible : Science fiction and the utopian imagination : Tom MOYLAN : 1986 : Methuen (série "University Paperbacks" #943 : ISBN-10 0-416-00022-3 : 242 pages (y compris bibliographie et index) : coûtait 8 GBP pour un petit TP aisément trouvable, existe aussi en HC (-00012-6).

Ce livre est l'oeuvre de Tom Moylan, un critique plutôt connoté comme marxiste et féministe dans le monde académique anglo-saxon (le premier qualificatif est parfois considéré comme un défaut, le second comme une qualité). Son propos est de nous confronter à ce qu'il appelle les "utopies critiques" par le biais de quatre romans appartenant à ce courant. Pour Moylan, ce genre d'utopie constitue en quelque sorte la troisième génération de textes. Après les premières utopies plutôt statiques et presque trop parfaites est venu le temps des dystopies, sorte d'inverses des précédentes. Finalement, dans les années 60 et dans le sillage des divers mouvements d'émancipation, arrivent ces utopies critiques qui sont certes en réaction vis à vis des excès de la société (libérale) mais proposent aussi un "mode d'emploi" pour réaliser la transition.

L'ouvrage se divise en deux parties principales. La première ("Theory") expose donc en une cinquantaine de pages cette évolution des écrits utopiques suivant la progression définie par l'auteur. La seconde ("Texts") se consacre, comme son nom l'indique, en une étude détaillée (plus de trente pages) de quatre romans représentatifs de ces utopies critiques : The female man (Russ), The dispossessed (Le Guin), Woman on the edge of time (Piercy) et Triton (Delany). Chacun des romans fait l'objet d'un chapitre qui le situe d'abord dans le contexte général du genre et dans la carrière de l'auteur, puis qui le dissèque méticuleusement avec l'appui de nombreux extraits. Une bibliographie (primaire et secondaire mélangés) et un index complètent l'ouvrage.

Il n'y a pas grand chose à dire sur les démonstrations de Moylan qui bénéficient de la longueur suffisante pour se déployer, d'une lecture très fine et d'une contextualisation appréciable. On pourra parfois lui reprocher un certain dogmatisme lié à une idée parfois trop bien arrêtée de ce que devrait être une utopie pour ses semblables. On notera aussi certains passages (surtout dans la première partie) parfois un peu pesants. L'ensemble est toutefois abordable et parvient à rendre intéressant un sujet assez austère.
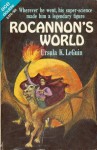
En fait, ce qui est un peu dommage est que, une fois de plus, ce livre fait la démonstration de l'étroitesse du canon acceptable pour les études sur le genre dès lors qu'elles sont issues du système universitaire. Les processus de formation du canon sont certes assez connus (voir Westfahl & Slusser), mais j'avoue que je suis victime d'une overdose massive de LeGuin/Delany/Russ (avec un zeste de Piercy ou Lem), des auteurs importants par la qualité de leur production mais dont l'influence sur la SF "réelle", celle qui est écrite, vendue, lue et par opposition au tout petit monde des "SF Studies" ne semble pas être proportionnelle à leur présence dans les ouvrages académiques.
Note GHOR : 2 étoiles
08:34 | 08:34 | Ouvrages thématiques | Ouvrages thématiques | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : anglais, 2 étoiles, utopie | Tags : anglais, 2 étoiles, utopie


