29/08/2021
_Les trains de grandes lignes_
Les trains de grandes lignes : Histoire des trains rapides et express de la SNCF de 1938 à nos jours : Jean-Marc DUPUY : 1995 : Loco-Revue : ISBN-10 2-903651-22-1 : 255 pages (pas d'index) : prix original inconnu pour un grand tp illustré en n&b, semble être disponible en neuf là.

Son sous-titre donne toutes les informations à savoir sur cet ouvrage, il s'agit donc d'une étude (en fait plutôt une longue liste) détaillée de tous les trains "Grandes Lignes" (express ou rapides) ayant circulé, de 1938 à 1995 (en incluant donc les TGV). Organisé par réseau (ou région) et divisé en cinq périodes chronologiques (+ diverses annexes), ce livre est certes un peu rébarbatif à lire mais présente un côté assez fascinant. Surprenant.
12:09 | 12:09 | Non SF - Divers | Non SF - Divers | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : trains | Tags : trains
25/08/2021
_Joanna Russ_
Joanna Russ : Gwyneth JONES : 2019 : University of Illinois Press (série "Modern masters of science fiction") : ISBN-13 978-0-252-08447-8 (la fiche ISFDB du titre) : 218 pages (y compris bibliographie et index) : coûte 22.00 USD pour un tp non illustré, disponible chez l'éditeur (là), existe aussi en hc (04263-8) et en ebook (05148-7).
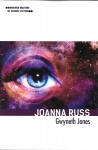
Je dois commencer ce court avis par un aveu, en tant que mâle, cis, blanc, CSP+ (et j'ai même une voiture diesel qui pollue) je fais partie du camp des méchants suivant la dichotomie simpliste de Russ et Jones. Il n'est donc vraiment surprenant que j'ai eu parfois envie de laisser tomber en cours de lecture cet ouvrage malgré le fait qu'il ne soit pas très épais (il contient à peu près 150 pages de texte par Jones).
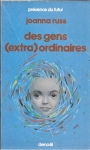
Tout d'abord, Russ ne me semble pas rentrer dans la catégorie des "Modern Masters of Science Fiction" (Mistresses ?) non du fait de ses qualités littéraires mais à cause d'une production que l'on peut qualifier de "limitée" (5 romans et encore moins de recueils) et à la diffusion que l'on peut considérer parfois comme confidentielle. En gros, Russ n'est ni Bujold ni Butler pour prendre deux autres de ces MMOSF, d'où un certain sentiment de "surclassement" pour cette autrice (auteure?).
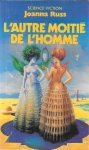
Ensuite, il y a ce côté parfois insultant (étonnant de la part de Jones qui est pourtant issue du sérail de la SF) pour ses lecteurs d'un ouvrage qui juge utile de nous expliquer par une note ce que veut dire "franchir le Rubicon" ou ce qu'est la Prime Directive de Star Trek et qui commence presque par la question "Why Joanna, with her formidable intellect choose science fiction (snip)?". Merci pour nous, pauvres idiots de lecteurs. L'expression "formidable intellect" résume d'ailleurs bien un livre où l'essentiel du discours de Jones consiste à louer le génie (littéraire, sociétal, militant) de Joanna Russ tout en peinant à nous en donner des preuves tangibles.
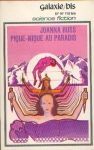
Il y a aussi un problème de contenu, à savoir que l'essentiel du livre est constitué des résumés (parfois chapitre par chapitre) des œuvres de Russ (par exemple 12 pages uniquement sur The Female Man, 7 pages pour Extra(Ordinary) People) qu'elles soient de fiction ou de non-fiction, ce qui est certes pratique pour qui veut éviter d'avoir à lire Russ mais n'est pas à mon sens, le but de cette collection (c'est plutôt celui des Cliffs Notes). Je passe volontairement sur tout le vernis féministe qui recouvre l'ouvrage avec ses interminables querelles intestines et tout son folklore (les traîtresses, les tièdes, la première vague, la deuxième vague...), ses raccourcis saisissants (tout mâle est un suppôt actif du patriarcat) et ses confusions soigneusement entretenues (être féministe est-ce être lesbienne ? et vice versa).
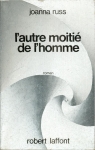
À noter la présence de deux interviews, une de Kathryn Cramer de 2017 et une autre de Russ elle-même qui date de presque cinquante ans (ce type de document à l'intérêt purement historique est d'ailleurs bizarrement fréquent dans les titres de la série, du remplissage ?). Au final, un livre parfaitement décevant, nettement en dessous des standards de cette collection et surtout qui ne nous apprendra pas grand chose sur Russ (d'ailleurs le livre s'arrête net au début des années 90), si ce n'est la vague impression d'une personne malheureuse, d'une femme sans doute brillante prise dans le retour de bâton anti-féminin des années 50 aux USA et impliquée dans un genre (seulement considéré comme) mineur. Mais pour mieux cerner Russ et ses positions sur le genre, il est sans doute infiniment préférable de la lire directement dans le texte comme ce recueil d'essais dont la plupart (il n'en existe pas tant que cela) sont évoqués par Jones.

Note GHOR : 1 étoile (et encore...)
17:11 | 17:11 | Etudes mono-auteur | Etudes mono-auteur | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : russ, anglais, 1 étoile | Tags : russ, anglais, 1 étoile
22/08/2021
_British Airliner Prototypes since 1945_
British Airliner Prototypes since 1945 : Stephen SKINNER : 2008 : Midland : ISBN-13 978-1-85780-299-3 : 224 pages (y compris index) : coûtait 35.00 GBP pour un grand hc avec jaquette illustré en n&b et couleurs, trouvable d'occase.
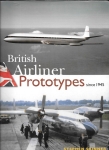
Comme son titre l'indique bien, cet ouvrage passe en revue les prototypes d'avions civils produits en Grande Bretagne après la 2GM (il ne traite donc pas, par exemple, du Shorts Belfast). De L'Avro Tudor (basé sur le bombardier Lincoln) au BAe 146 (à la production brutalement arrêtée en 2001), il évoque une trentaine d'appareils dont certains sont peu connus (le Concordia de Cunliffe-Owen ou le Hermes de Handley Page). De grandes et belles photos, une quantité de texte limitée (malgré quelques redites) font de cet ouvrage un excellent panorama des efforts (peu récompensés) de l'industrie aéronautique britannique pour renaître. Un ensemble très sympathique sur ces appareils au look si particulier.
09:37 | 09:37 | Non SF - Aviation | Non SF - Aviation | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0)
19/08/2021
_Roger Zelazny_ (Cox)
Roger Zelazny : F. Brett COX : 2021 : University of Illinois Press (série "Modern masters of science fiction") : ISBN-13 978-0-252-08575-8 (la fiche ISFDB du titre) : x+208 pages (y compris bibliographie et index) : coûte 27.95 USD pour un tp non illustré, disponible chez l'éditeur (là), existe aussi en hc (04376-5) et en ebook (05266-8).
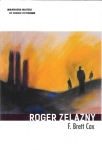
La carrière de Roger Zelazny (décédé brutalement en 1995 à à peine 58 ans) est assez "classique" pour un auteur de SF. Des débuts dans le fanzinat, une explosion grâce à des textes courts devenus classiques, une série concentrée de romans remarqués et, assez vite, le passage à un statut d'écrivain professionnel qui correspond à l'établissement d'une certaine routine avec des écrits, certes parfaitement compétents mais un peu plus "abordables" ("commerciaux" ?) et de fréquents retour dans des univers relativement balisés (Ambre, Dilvish, Francis Sandow). Du coup, la place de Zelazny dans le panthéon du genre est sans doute plus fragile que l'on aurait pu le croire, un état de fait que Cox déplore en pointant le peu d'intérêt du monde académique et une certaine désaffection des lecteurs malgré le travail remarquable de mise à disposition réalisé par NESFA avec cette intégrale.

Sous la plume d'un professeur d'anglais (et accessoirement auteur de SF lui-même), il s'agit du plus récent volume consacré à Zelazny, sachant qu'il en existe trois autres, Yoke, Krulik et Lindskold (sur lequel je n'ai pas encore mis la main), tous datant des années 90. Cet ouvrage fait partie de l'indispensable collection de monographies publiées par l'université de l'Illinois. On y retrouve le canevas standard de ce type d'ouvrage avec une brève partie biographique (le premier chapitre) suivi d'un parcours chronologique de la carrière de l'auteur en quatre longues parties. On notera l'étonnante présence de cette interview de Zelazny, un document court (8 pages) et assez ancien (il date de 1972). On trouve aussi à la fin de l'ouvrage une bibliographie (primaire et secondaire) ainsi qu'un index.
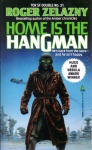
Comme j'aime bien Zelazny (peut-être parce que j'ai évité de lire ses fins de séries de pseudo fantasy), j'ai apprécié cet ouvrage qui est dans la bonne moyenne de la série d'UIP. Il est clair que Cox est un inconditionnel de l'auteur, ce qui explique sans doute la difficulté que l'on sent bien quand il s'agit pour lui d'aborder les dernières œuvres de Zelazny. Certains d'entre elles (comme les collaborations avec Lindskold ou d'autres -Saberhagen, Thomas, Sheckley, ) sont d'ailleurs discrètement et rapidement et heureusement passées à la trappe. Paradoxalement et malgré tous les efforts de Cox, la structure et le discours mêmes de l'ouvrage ne peuvent que confirmer que Zelazny est un auteur qui a cessé d'être central pour le genre dès la fin des années 70 pour devenir un professionnel fiable mais prévisible.

Comme souvent avec les titres de cette série, une fois le livre refermé, on a une vague impression de "pas assez". Une impression que l'on peut rationaliser en faisant le constat qu'il n'y a en fait que 150 pages de texte aéré dans le livre, ce qui fait un peu léger pour un auteur comme Zelazny, mais il s'agit sans doute d'une contrainte imposée par l'éditeur. Un dernier mot pour finir, pour l'avoir rencontré à la convention de 1988 à Paris, Zelazny était, comme le souligne bien Cox, un vrai Monsieur, fort agréable.

Note GHOR : 2 étoiles
17:51 | 17:51 | Etudes mono-auteur | Etudes mono-auteur | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0)
15/08/2021
_The Last Century of Sea Power_
The Last Century of Sea Power : Volume 1 : From Port Arthur to Chanak, 1894-1922 : H. Willmott : 2009 : Indiana University Press : ISBN-13 978-0-253-35214-9 : xviii+543 pages (y compris index et bibliographie) : coûte 53.00 USD pour un hc (sans jaquette) illustré de cartes, disponible chez l'éditeur.
The Last Century of Sea Power : Volume 2 : From Washington to Tokyo, 1922-1945 : H. Willmott : 2010 : Indiana University Press : ISBN-13 978-0-253-35359-7 : xx+679 pages (y compris index et bibliographie) : coûte 25.00 USD pour un hc (sans jaquette) illustré de cartes, disponible chez l'éditeur.

Voici un ensemble particulièrement massif, rempli à ras bord avec des cartes (avec le Nord en bas !), des tableaux de tous types, des listes interminables (35 pages sur la localisation de TOUS les navires britanniques le 15 Aout 1945), des notes foisonnantes et une bibliographie exhaustive. Tous cela pour nous "expliquer" (à la différence de "raconter", ce sont les mots de l'auteur) le dernier siècle d'histoire navale. C'est sans doute un ouvrage sur lequel s'appuyer pour tout ce qui est éléments factuels (les fameuses listes et tableaux) mais en ce qui concerne la partie "explications", j'avoue ne pas avoir été convaincu.
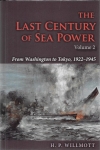
Outre un ton un peu décalé (avec ce qui doivent être des traits d'humour un peu déplacés et moyennement drôles) , la narration de Willmott est loin d'être fluide avec des listes littéralement intégrées au corps du texte (avec des phrases comme "les Japonais ont perdu pour les cinq raisons suivantes..." suivi d'un paragraphe où Willmott en rajoute deux pour le même prix). L'auteur peine à traiter de façon synthétique un si vaste sujet (et sans même "raconter" les batailles) sans doute à cause d'un bête problème d'espace. En effet, une fois enlevé le paratexte, il reste à l'auteur sans doute moins 300 pages pour couvrir un siècle avec deux guerres mondiales dans le lot. La mission était clairement impossible au vu des ambitions de Willmott. Le tout forme une source d'information indispensable (une fois localisé l'endroit où l'information recherchée se trouve) mais reste, en terme d'intérêt, un loupé magistral.
10:49 | 10:49 | Non SF - Marine | Non SF - Marine | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0)


