05/07/2010
_The pattern of expectation 1644-2001_
The pattern of expectation 1644-2001 : I. F. CLARKE : 1979 : Jonathan Cape : ISBN-10 0-224-01471-4 : xi+344 pages (y compris index) : coûtait 7.50 GBP pour un HC avec jaquette non illustré.

Cet ouvrage est un peu à la marge de ceux qui sont évoqués dans cet espace d'où la brièveté de cet avis. Ecrit par I. F. Clarke, un universitaire reconnu par son immense travail sur la proto-SF et particulièrement le sous-genre des guerres futures (son oeuvre maîtresse étant Voices prophesying war 1763-1984), ce livre se veut une étude de l'émergence de l'idée de prédiction (ou de futurologie) et du fait que l'on peut discuter du futur avant qu'il ne se produise. Débutant par l'utopie puis les conflits imaginaires et les dystopies, ce mode de pensée donnera naissance (sous une forme commerciale) à la science-fiction. Ce découpage est d'ailleurs utilisé par Clarke pour structurer son essai qui s'articule en trois parties plus ou moins chronologiques. Plusieurs pages de photographies N&B (en quatre cahiers) et un index (peu pratique) complètent l'ouvrage.
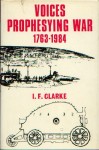
Fruit d'un gros travail et d'une grande maîtrise du sujet ce livre brosse une sorte d'histoire "périphérique" de la science-fiction (avant sa naissance et en parallèle à son développement aux USA) et s'appuie sur des textes importants mais relativement peu connus (et peu lus) comme Edison's conquest of Mars ou The world set free. C'est malgré tout presque plus une étude sociologique (ou socio-historique) qu'un ouvrage de référence sur le genre.

Note GHOR : 1 étoile
07:29 | 07:29 | Ouvrages thématiques | Ouvrages thématiques | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : anglais, 1 étoile | Tags : anglais, 1 étoile
10/06/2010
_Nuclear holocausts : Atomic war in fiction, 1895-1984_
Nuclear holocausts : Atomic war in fiction, 1895-1984 : Paul BRIANS : 1987 : Kent State University Press : ISBN-10 0-87338-335-4 : xi+398 pages (y compris plusieurs index) : coûtait 30 USD pour un solide HC avec jaquette non illustré.

Cet ouvrage fait chronologiquement partie d'une série de titres qui, hasard ou synchronicité, traitent du même thème et sont sortis à quelques mois d'intervalle comme le Yoke ou le Dowling (il y en a aussi eu plusieurs autres les années précédentes). En effet, en cette période de fin de guerre froide, plusieurs ouvrages sur la fin du monde via l'atome ont donc été publiés. Comme le post-apocalyptique était passé de mode après les grands textes des années 50 et sa transformation en simple décor dans les années 80, il était sans doute temps pour les théoriciens du genre (comme ici Paul Brians, un professeur d'Anglais et spécialiste du sujet) de se pencher sur ce sous-genre de la SF si particulier.
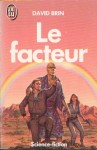
Ce volumineux ouvrage se divise en deux partis distinctes. La première est aussi la plus courte puisqu'elle atteint une centaine de pages. Il s'agit d'une étude du thème de l'holocauste nucléaire qui développe à la fois l'histoire du concept mais aussi ses causes ou conséquences (à court ou long terme) imaginaires. La seconde est la plus importante (250 pages), c'est une bibliographie largement commentée (une dizaine de lignes à chaque fois, parfois plus) des oeuvres littéraires de fiction (romans, nouvelles, pièces) sur ce sujet parues entre 1895 et 1984. Organisée par ordre alphabétique d'auteur, elle fournit outre un résumé et un avis, les éléments bibliographiques nécessaires pour localiser les textes indiqués. Plusieurs suppléments sont fournis : une chronologie des oeuvres, des listes d'oeuvres annexes, un index par titre et un index par sujet.
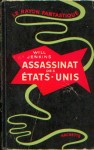
La première partie est relativement classique et dresse un historique fidèle de ce sujet qui a pendant un temps été assez central dans le genre, même s'il a été sur la fin plus traité par l'audiovisuel que par les textes. C'est un ensemble très détaillé et fait preuve d'une grande connaissance du sujet par l'auteur qui s'appuie sur une masse de textes importante et nous évite la concentration parfois rencontrée dans d'autres ouvrages moins fouillés sur un petit nombre d'oeuvres archi-connues.

La seconde partie est à la fois la plus originale et la plus remarquable. La quantité de travail fournie est effectivement impressionnante (on doit se rapprocher du millier de textes cités) et c'est elle qui apporte sa vraie plus-value à l'ouvrage. On n'est pas loin d'avoir là la bibliographie définitive de ce sous-genre (dont les occurrences post-1984 sont somme toute assez peu nombreuses) qui se révèle être exhaustive et indispensable pour toute étude de ce sujet. Une vraie réussite.
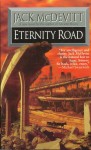
Note GHOR : 3 étoiles
07:52 | 07:52 | Ouvrages thématiques | Ouvrages thématiques | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : anglais, 3 étoiles | Tags : anglais, 3 étoiles
09/06/2010
_La nouvelle science-fiction américaine_ (Cordesse)
La nouvelle science-fiction américaine : Gérard CORDESSE : 1984 : Aubier (collection "USA") : ISBN-10 2-7007-0350-2 : 222 pages (y compris index et bibliographies) : coûtait 89 Francs pour un TP non illustré.

Ecrit par un universitaire français ayant aussi enseigné aux USA et paru dans une collection d'essai consacrés à ce pays, cet ouvrage est un passage en revue du paysage de la science fiction américaine dans les années 60 à 80. Présentée sous l'angle relativement trompeur (Cordesse l'évacue d'ailleurs dès sa préface) de la nouveauté, il s'agit en fait d'une histoire du genre depuis ses débuts qui ne se limite pas strictement aux USA mais englobe aussi la sphère britannique.

L'ouvrage est divisé en plusieurs grands ensembles mêlés. Le premier (correspondant au premier chapitre) et le plus court est une présentation des mécanismes de communication et de feedback qui se sont mis en place au sein du genre et sont une de ses spécificités (existence d'editors puissants, d'agents littéraires influents, d'un fandom impliqué et critique). Le deuxième (constitué du quatrième chapitre) est une réflexion théorique sur le genre avec ses oppositions à d'autres (Fantastique, Mainstream) et ses promesses (sense of wonder, extrapolation). Le dernier et le plus volumineux (trois chapitres sur cinq) est une histoire du genre divisée en trois époques : avant la new-wave, pendant new-wave et après la new-wave. Dans chacun de ces chapitres un certain nombre d'auteurs typiques sont évoqués. Plusieurs bibliographies ainsi qu'un index clôturent l'ouvrage.
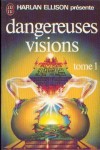
L'ensemble forme un tout qui est relativement intéressant pour le lecteur francophone en particulier grâce à une bonne explication des nombreux mécanismes spécifiques d'interaction entre les forces en présence (auteurs, editors, éditeurs, lecteurs, critiques, fans) qui ont de tout temps guidé l'évolution du genre (sous sa forme écrite) aux USA et, par effet d'imitation, l'évolution de la SF au niveau mondial. Cette sorte de co-pilotage de la SF par plusieurs groupes de personnes aux intérêts parfois divergents est en effet une chose assez propre à la SF que l'on ne retrouve pas forcément dans d'autres genres.
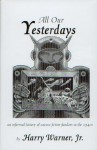
En fait le maître mot de cet essai pourrait être "synthétique". Sa partie historique est d'un grand classicisme et cite bien les auteurs attendus pour les périodes considérés (Dick, Bradbury, Moorcock, Ellison, Varley, Vinge). Dans cette partie historique, comme pour sa partie théorique, on ressent à la lecture de ce livre une curieuse impression de "déjà-vu" (ou ici de "déjà-lu") quand on tombe sur des éléments ou des réflexions qui sortent directement d'autres ouvrages de référence. Même si les emprunts sont clairement indiqués par Cordesse, on peut parfois être surpris (malgré une évidente proximité thématique) par l'intrusion de données ou d'idées toutes droit sorties du quasi homonyme La nouvelle Science Fiction Américaine de Rey & Thomas. Globalement ce livre est un bon récapitulatif sur son sujet (la SF depuis 1950 aux USA) mais il manque trop d'originalité pour être pleinement satisfaisant.

Note GHOR : 2 étoiles
07:51 | 07:51 | Ouvrages thématiques | Ouvrages thématiques | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : français, 2 étoiles | Tags : français, 2 étoiles
08/06/2010
_La nouvelle Science Fiction Américaine_ (Rey & Thomas)
La nouvelle Science Fiction Américaine : Pierre K. REY & Pascal J. THOMAS : 1981 : A&A (no 72 Bis de la revue et #12 de la collection "Documents SF") : pas d'ISBN ni ISSN : 64 pages (pas d'index) : coûtait 25 Francs pour un petit TP plus solide que le fanzine correspondant, illustré de photos en N&B.

Ce fascicule est un numéro spécial du fanzine A&A (Ailleurs & Autre). Cette revue à la vie longue et tourmentée (elle a connu plusieurs hiatus) est l'oeuvre majeure de Francis Valéry (pourtant un boulimique de l'édition) et probablement la revue amateur ayant eu la plus longue carrière (elle a dû maintenant dépasser les 150 numéros). Sous la double de signature de Pierre K. Rey (à qui l'on devra la série des Univers 19XX) et de Pascal J. Thomas (un vieux complice de Valéry), il s'agit donc d'un panorama de la SF US à l'orée des années 80, avec un focus particulier sur les "nouveaux" auteurs.

L'ouvrage se divise en trois parties principales. La première est une sorte d'état des lieux du genre aux USA qui comprend un premier chapitre ("Tendances") écrit par Rey qui donne le cadre général (état et évolutions de la société américaine et leurs impacts sur la SF) et un second ("Intendances") qui est surtout une description de l'évolution de l'édition (romans, anthologies, magazines, ouvrages de référence, prix) sur la période 75-80. La deuxième grande partie est un dictionnaire des nouveaux auteurs qui rassemble une cinquantaine d'entrées, allant de Greg Bear à George Zebrowski. Pour chacun on trouve (parfois) une photographie, les informations biographiques essentielles, un bref (rarement plus d'une demi page) aperçu de leur carrière et une liste des autres oeuvres (romans et nouvelles) non évoquées. La dernière partie est une bibliographie VF de ces auteurs dans un chronologique de parution US avec séparation entre textes et livres.
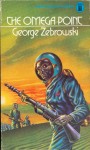
Même si, à l'évidence, une partie de cet ouvrage doit beaucoup à une revue comme Locus, celui-ci doit être replacé dans le contexte de l'époque. Dans cette optique c'est une réussite puisque la mission d'informer les amateurs francophones sur l'état réel de la SF US, par opposition à une vue parfois fantasmée et en tout cas nettement distordue par les divers prismes (choix éditoriaux, délais de traduction, etc.), est parfaitement accomplie par ce petit livre que l'on peut voir comme une sorte de parallèle des préfaces de Rey pour ses anthologies chez J'ai Lu.

La bibliographie est sérieuse malgré l'absence d'index qui la rend peu exploitable (même si elle n'est parfois guère volumineuse avec par exemple un seul texte traduit pour Sheffield, Shirley ou Sky). La série de portraits est plutôt synthétique mais convenable, le plus amusant étant soit de contempler l'apparence des auteurs à l'époque (avec une profusion de barbus à cheveux longs et lunettes) pour la comparer avec des photographies récentes, soit de s'amuser à recenser les écrivains présents dans ce dictionnaire (de Broxon à Yep en passant par Chilson) qui disparaîtront de la scène SF corps et biens. Finalement quelque chose de plutôt performant pour l'époque et le contexte mais dont l'utilité est très limitée de nos jours.
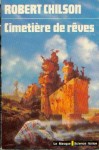
Note GHOR : 2 étoiles
07:52 | 07:52 | Ouvrages thématiques | Ouvrages thématiques | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : français, 2 étoiles | Tags : français, 2 étoiles
31/05/2010
_The mushroom jungle : A history of postwar paperback publishing_
The mushroom jungle : A history of postwar paperback publishing : Steve HOLLAND : 1993 : Zeon Books : ISBN-10 1-8741213-01-7 : 204 pages (y compris index) : coûtait 15 GBP pour un TP largement illustré (en N&B généralement) assez peu facile à trouver.
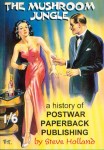
Bien que ne rentrant pas stricto sensu dans les critères du GHOR, il me parait intéressant d'évoquer cet ouvrage. Il s'agit en effet d'une histoire des éditeurs de poche britanniques après la seconde guerre mondiale. Dans un pays qui sortait du cauchemar du conflit mondial, une demande forte de littérature de distraction s'est manifestée. N'ayant pas une aussi importante tradition des pulps qu'aux USA, les éditeurs britanniques ont répondu en industrialisant la production de livres de poche de piètre qualité mais rapides à fabriquer et surtout rapides à écrire. Ces "romans de gare" appartiendront essentiellement à quatre genres principaux : le polar, l'érotisme, le western et, point qui nous concerne, la SF.
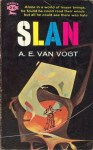
Sous la plume de Holland, un spécialiste de ces questions (on lui doit Vultures of the void en collaboration avec Harbottle), ce livre parcourt l'histoire de ces petits éditeurs, parfois aux marges de la légalité ou des bonnes moeurs, qui proposeront au public sous des couvertures souvent suggestives (ou alors simplement atroces) et des pseudonymes délirants des textes généralement atroces et parfois écrits en une soirée. Il va de l'immédiate après-guerre au milieu des années 50 où, comme aux USA, une réaction puritaine (entre autres facteurs) entraînera leur fin ou leur transformation (pour certains chanceux comme Panther) en firmes "respectables". Organisé en une dizaine de chapitres, ce livre est illustré de nombreuses reproductions de couvertures en N&B (+ 4 pages en couleur) et possède un index.
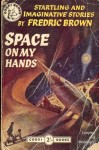
Ce livre est un régal à lire tellement l'atmosphère fiévreuse et louche de ce milieu des forçats de la machine à écrire et des éditeurs rapaces est bien rendue par Holland. Même si la SF ne constitue qu'une faible partie de l'ensemble (un tout petit quart à vue de nez), on y retrouve des noms qui feront les premières heures du FNA ou d'autres éditeurs français (Vargo Statten, S. Fowler Wright, E. C. Tubb, Francis G. Rayer, etc.) et l'on voit bien que les réponses éditoriales seront assez similaires de part le monde.
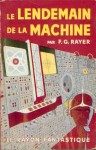
Un livre d'une grande érudition et soutenu par une excellente iconographie (et parfaitement reproduite), qui retrace une partie importante de l'histoire de la SF (ici britannique mais qui aura des répercussions ailleurs). On pourra juste lui reprocher de ne faire que survoler la partie relative à la SF et de ne proposer qu'un index très rudimentaire (il ne liste que les éditeurs) qui rend difficile la pleine exploitation de cet excellent ouvrage.
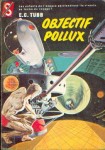
Note GHOR : 3 étoiles
07:14 | 07:14 | Ouvrages thématiques | Ouvrages thématiques | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : anglais, 3 étoiles | Tags : anglais, 3 étoiles


