10/03/2009
_Human visions : The Talebones interviews_
Human visions : The Talebones interviews : Ken RAND : Fairwood Press : 2006 : ISBN-10 0-9746573-9-5 : 240 pages : une quinzaine d'Euros pour un TP.

Cet ouvrage fait partie de la catégorie spécifique des recueils d'interviews, un type de livre qui est régulièrement (il doit en sortir à peu près un par an) publié dans le monde de la SF anglo-saxonne. Ici, ce sont des textes précédemment parus dans le magazine Talebones, ce magazine étant une revue plutôt éclectique dans ses choix, d'un esprit un peu "transgenre" proche de celui de The third alternative.
Il contient 31 interviews assez courtes (6 pages en moyenne) d'auteurs de littératures de l'imaginaire (comme on dit maintenant) allant de Bear à Piccirilli en passant par Straub.
Il s'agit d'interviews travaillées, c'est à dire un résultat différent d'une suite brute de couples questions-réponses. Pour donner une idée, c'est assez proche de celles que fait depuis une certain temps le newszine Locus, un mélange d'éléments bibliographiques, de questions sur les méthodes de travail et sur les projets en cours ou l'actualité des auteurs.
Les auteurs choisis sont à la fois des habitués de l'exercice (Haldeman, Zelazny) mais aussi des gens que l'on a rarement l'occasion de voir s'exprimer (Hogan, les Gear). Il y en a vraiment pour tous les goûts : pour les amateurs de SF libérale (Bova), d'humour (Willis) ou d'uchronie (Turtledove).
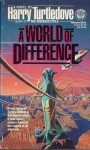
Au final, un livre assez court mais fort sympathique, intéressant par le fait qu'il donne la parole à des auteurs parfois peu entendus ou d'une visibilité faible. Mon seul bémol est le fait que certaines des premières interviews ont désomais plus de 10 ans (elles datent de 1997) et logiquement d'une actualité plus très fraîche.
A rajouter à la longue liste des ouvrages de ce type, très utiles pour approfondir un auteur autrement que par ses fictions.

Note GHOR : 2 étoiles
08:23 | 08:23 | Ouvrages de référence divers | Ouvrages de référence divers | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : anglais, 2 étoiles, interviews | Tags : anglais, 2 étoiles, interviews
09/03/2009
_J. G. Ballard_
J. G. Ballard : Jeannette BAXTER (editor) : Continuum : 2008 : ISBN-13 978-0-8264-9726-0 : 151 pages (y compris diverses bibliographies et index) : une vingtaine d'Euros pour un TP neuf (existe aussi en HC).
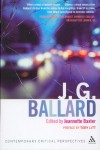
Au vu du nombre de livres et d'articles qui lui sont consacrés on peut penser que, depuis quelque temps, James Graham Ballard est devenu le PKD des universitaires britanniques quand ils s'intéressent à la SF. C'est probablement pour les mêmes raisons, que l'on voudrait liés à la qualité de leurs textes mais qui tiennent peut-être plus au fait d'une plus grande visibilité auprès du public, visibilité renforcée par plusieurs adaptations cinématographiques. Pour Ballard, cet attrait est sûrement multiplié par le fait qu'il a publiquement renié le genre et que ses livres ne sont pas encombrés de tout le bric-à-brac adolescent de la SF (fusées, robots, calmars...).

Cet ouvrage est un receuil de huit essais sur l'auteur avec divers suppléments (préface, postface, longue interview, biographie sommaire, bibliographie secondaire). Les contributeurs sont des gens hors de la sphère du genre et oeuvrant plutôt dans la litgen ou le post-modernisme.
Les huit essais abordent divers thémes ou oeuvres précises, à savoir :
- La relation de l'auteur avec SF au début de sa carrière.
- The atrocity exhibition
- Crash
- Les adaptations au cinéma.
- La "life trilogy" comme littérature de guerre.
- Les images de Londres chez l'auteur.
- Visons de l'Europe dans Cocaine nights et Super Cannes.
- La violence chez Ballard.
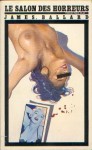
Suivent donc une interview avec Ballard au sujet de Kingdom come et une vaste bibliographie.
N'étant pas spécialiste de Ballard, auteur que je n'ai que peu lu, (sauf ses premières nouvelles et une partie de sa quadrilogie catastrophe), je n'ai pas forcément le bagage nécessaire pour émettre un avis motivé sur cet ouvrage.
On peut quand même constater que les essais restent toutefois très aux marges de la SF en évitant soigneusement de marcher dedans (sauf le premier qui est, par exemple, le seul à parler de Sécheresse et de ses compagnons thématiques) et semblent parfois plus s'intéresser aux films dont ils dérivent que par les écrits de Ballard.
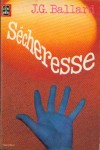
Hormis quelques accès de jargon post-moderniste, la lecture est plutôt agréable et le point de vue mesuré. C'est un ouvrage plutôt dense et pour lequel le faible nombre de pages est trompeur (au vrai seulement 120 pages de texte, mais elles sont écrites petit et serré).
Un recueil d'essais à conseiller aux amateurs de Ballard l'écrivain parfois autobiographique (ou l'adapté au cinéma) mais pas forcément à ceux de l'écivain de SF (pour autant que JGB en soit un).
Note GHOR : 1 étoile
11:00 | 11:00 | Etudes mono-auteur | Etudes mono-auteur | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : anglais, 1 étoile, ballard | Tags : anglais, 1 étoile, ballard
06/03/2009
_The classic era of American pulp magazines_
The classic era of American pulp magazines : Peter HAINING : Prion : 2000 : 1-85375-388-2 : 224 pages (y compris index) : 17.99 Livres Sterling pour un HC avec jaquette.
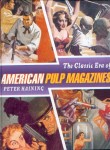
Même si la SF n'est pas le seul genre traité dans cet ouvrage, il m'a semblé intéressant de le présenter.
Il s'agit donc d'un "coffee-table book", c'est à dire un beau livre que l'on laisse négligemment traîner sur sa table de salon pour montrer sa branchitude ou ses principaux centres d'intérêt. Abondamment et superbement illlustré, c'est un panorama des pulps US (et un peu GB) entre leur véritable décollage dans les années 20 et leur triste fin dans les années 50.
Il couvre la plupart des catégories de pulps (Crime, Western , Weird, SF, Romance) avec un accent prononcé sur les illustrations et dans ce domaine sur les contenus érotiques ou titillants, dans la mesure où le lecteur actuel accepte des standards d'érotisme qui ne sont plus de notre époque (les images montrées paraîtraient bien innocentes à n'importe quel adolescent actuel, plus habitué à une pornographie disponible en un click).
On est donc loin de l'ouvrage historique fouillé comme les excellents Ashley ou le Holland (The mushroom jungle) pour la partie britannique malgré une approche historique titre par titre. On pourra aussi y trouver quelques affirmations pour le moins hâtives (Slan paru en serial dans Startling stories) et, en ce qui concerne la SF, une image peut-être déformée des pulps qui étaient (hormis quelques titres comme Marvel) nettement moins sexuellement orientés que Haining ne nous le montre.
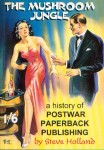
C'est toutefois un ouvrage agréable à lire et surtout à contempler, mais pas une base de travail.
Note GHOR : 2 étoiles
11:16 | 11:16 | Ouvrages généraux sur la SF | Ouvrages généraux sur la SF | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : anglais, 2 étoiles, pulps | Tags : anglais, 2 étoiles, pulps
05/03/2009
_Science Fiction, Fantasy, and weird fiction magazines_
Science Fiction, Fantasy, and weird fiction magazines : Marshall B. TYMN & Mike ASHLEY : Greenwood Press : 1985 : 0-313-21221-X : index structurel : HC trouvable (avec difficultés) en occase pour des sommes assez conséquentes (atteignant parfois la centaine d'Euros).

Il existe plusieurs façons d'aborder le domaine des magazines de SF (et des genres associés) : l'approche historique 'globale', avec Ashley (ses deux histoires successives en plusieurs volumes) ou Carter (The creation of tomorrow); l'approche historique par titre avec Rogers (sur Astounding), Rosheim (sur Galaxy) ou Metzger (sur Unknown) et enfin l'approche bibliographique pure et dure avec Murray, Strauss ou les index NESFA annuels.

Tymn & Ashley, deux pointures dans ce domaine, nous proposent ici un livre qui est en fait un hybride de ces trois approches. En effet, ce livre recense tous les magazines de SF (et autres genres plus ou moins proches) ayant jamais existé. Il couvre aussi les anthologies originales régulières (type Orbit ou Stellar) et les magazines des pays non anglo-saxons (par exemple, pour la France 20 magazines sont traités).

En ce qui concerne les anglo-saxons (là où il y a le plus d'éléments), outre les informations purement techniques (numérotation, éditeur, format, rédacteur en chef, localisations, citations...) l'histoire de chaque titre est largement développée dans de véritables essais (qui comportent jusqu'à une cinquantaine de pages) qui détaillent l'histoire et l'évolution de la revue (orientations, vicissitudes, fictions notables, illustrations...).
Du coup le livre est un monstre, à la fois sur le plan purement physique (il fait 950 pages) et sur le plan de la somme de travail fournie par les auteurs. Les détails bibliographiques sont abondants, les récits sur chaque magazine vifs, amusants et agréables à lire, les opinions clairement exprimées et le travail de recherche impeccable et largement documenté et donc vérifiable (par un système de notes renvoyant aux sources utilisées).
Seules critiques possibles :
- L'absence d'index des textes de fiction cités (mais une telle entreprise ferait au moins doubler de taille le livre).
- La date de parution (1985) qui rend les analyses sur les titres encore existants incomplètes.
La seule chose approchante (en dix fois plus légère puisqu'elle ne fait que 80 pages) est la partie 'magazines' du 3ème tome du Tuck.

Il n'y a pas grand chose de plus à dire, si ce n'est que c'est un des dix meilleurs ouvrages de reference toutes catégories confondues.
Note GHOR : 4 étoiles
10:44 | 10:44 | Index, dictionnaires & bibliographies | Index, dictionnaires & bibliographies | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : anglais, 4 étoiles | Tags : anglais, 4 étoiles
04/03/2009
_Space, time, and infinity_
Space, time, and infinity : Brian STABLEFORD : Borgo Press (éditeur récemment repris par le conglomérat Wildside Press) : 2007 : 0-8095-0911-3 en HC (-1911-9 en pbk) : 208 pages (dont index) pour une quinzaine d'Euros en neuf.
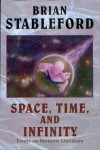
Il s'agit d'un recueil de textes de Stableford, parus entre 1988 et 1995.
Le sommaire permet d'aller tout de suite au coeur du problème, a savoir que ce livre ne possède strictement aucune unité et qu'il est constitué de beaucoup de réchauffé.
En effet, sont successivement abordés les sujets suivants :
- Une histoire des magazines SF britanniques : ce n'est pas un mauvais article, mais il se révèle très léger face à d'autres livres nettement plus fouillés (on pensera évidemment à l'oeuvre de Ashley).
- Des textes sur diverses créatures fantastiques : deux essais sur les vampires (un thème que Stableford affectionne), un sur les loup-garous et un sur les sirènes. Un des articles sans grande originalité.
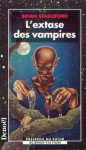
- Une étude sur la war-fiction avant la 1GM déjà parue dans Interzone et donc déjà connue, plutôt dans le survol surtout comparée aux travaux de I. F. Clarke sur le même sujet.
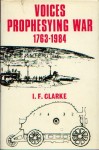
- Une étude sur Poe : bof, mais c'est peut être du au fait que je ne suis pas un amateur de cet auteur.
- Un parallèle entre "Science fiction" (USA) et "Scientific romance" (GB) : pas très original et surtout trop court.
- Un essai sur l'alternate history (qui provient du C&N) : bien mais déjà lu.
- Quelques transcriptions de discours.
Globalement, on ne peut pas dire que le livre soit mauvais, mais il manque vraiment à la fois de matière (c'est écrit GROS avec des pages blanches, ce qui fait des essais d'une grosse dizaine de pages en moyenne) et d'une direction précise ou au moins d'une thématique unificatrice. A la différence d'autres livres de Stableford, c'est plus une sorte de "sample" des écrits de l'auteur qu'un ouvrage formant un tout cohérent.
Un ouvrage à réserver aux afficionnados de l'auteur ou aux complétistes.
Note GHOR : 1 étoile
09:19 | 09:19 | Ouvrages de référence divers | Ouvrages de référence divers | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : anglais, 1 étoile | Tags : anglais, 1 étoile


