26/04/2010
_The many worlds of Larry Niven_
The many worlds of Larry Niven : Paul GUPTILL & Chris DRUMM : 1989 : Chris Drumm (série "Chris Drumm Booklet" #33) : ISBN-10 0-936055-44-8 : 63 pages (+ 1 page volante d'addenda non numérotée dans mon exemplaire) : Coûtait 4.50 USD pour un format plus petit que A5 agrafé au centre et avec couverture rigide qui se trouve parfois d'occasion.

Ce petit fascicule est une entrée tardive dans la série des bibliographies éditées par Chris Drumm dans les années 80 (et qui dureront jusqu'aux années 90). Il est consacré à Larry Niven, un auteur qui a longtemps représenté aux USA le courant "Hard Science" (ou du moins la partie de la SF "néo-classique") qui a émergé dans les années 65-75 en réaction aux positions prises par les participants à la New Wave. A ce titre (et probablement aussi pour des positions politiques assez conservatrices), il n'a jamais bénéficié dans notre pays du même intérêt que d'autres de ses contemporains.
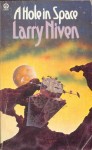
L'ouvrage commence par une préface (technique) et une introduction (biographique) d'une page chacune. La suite (la partie principale) est conforme aux habitudes de la maison Drumm, à savoir un listing par ordre chronologique (strict de première parution) des textes de l'auteur. On y trouve donc, regroupés par année (de 1964 à 1988) et numérotés séquentiellement, les oeuvres de l'auteur (quels que soient leur format ou leur type). Pour chaque item, un certain nombre d'informations bibliographiques sont données suivant le type, par exemple éditions existantes (mais pas délibérément les réimpressions) et prix pour les livres, parutions successives ou longueurs pour les textes courts, de même que des informations ponctuelles (appartenance à une série). La section suivante est dévolue aux traductions (y compris la VF), suivant un même format et une même numérotation. Un grand nombre de petites parties suivent cette bibliographie : non-fiction, prix reçus, séries, projets en cours, interviews, critiques détaillés et une grosse section fourre-tout. Un index par titre clôture l'ouvrage.
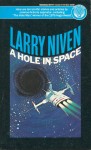
Il y a peu à redire sur le travail fourni qui est d'un très bon niveau sur les parutions en VO. On pourra regretter que la partie relative aux traductions de Niven soit assez nettement en retrait puisque, pour la VF, un rapide pointage montre qu'une bonne moitié des textes ne sont pas recensés (d'ailleurs sans logique apparente). De la même façon, le choix délibéré de ne pas lister toutes les réimpressions (faute de place) est un peu dommage sur un strict plan bibliographique.
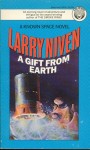
Même si le bémol habituel quand à la pertinence pour les textes récents (le fascicule a plus de vingt ans) doive bien sûr être exprimé, cet ouvrage est de toute façon indispensable au bibliographe utilisant (encore) le papier. En effet, il est le seul consacré à cet auteur qui a quand même eu une production conséquente (presque 190 items sont couverts) et parfois complexe à appréhender (comme ces changements de titres lors du passage de certains romans de la version magazine à la parution en livre). Ses qualités en font donc un incontournable.
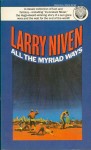
Note GHOR : 3 étoiles
07:19 | 07:19 | Index, dictionnaires & bibliographies | Index, dictionnaires & bibliographies | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : anglais, niven, 3 étoiles | Tags : anglais, niven, 3 étoiles
23/04/2010
_Many futures, many worlds : Themes and form in science fiction_
Many futures, many worlds : Themes and form in science fiction : Thomas D. CLARESON (editor) : 1977 : The Kent State University Press : ISBN-10 0-87338-200-5 : ix+303 pages (y compris index) : coûtait 5.50 USD pour un TP non illustré, existe aussi en HC (-199-8).

Rassemblé par Thomas Clareson, une des figures importantes du milieu universitaire s'intéressant au genre (il écrira ou dirigera de nombreux autres ouvrages sur la SF), ce livre est un recueil d'essais qui abordent des thématiques variées comme le précise l'introduction. En utilisant ces diverses perspectives, le but ultime de Clareson est de montrer que les thèmes et les préoccupations de la science fiction rejoignent en fait ceux du mainstream, ce lien entre littérature réaliste et SF étant un des chevaux de bataille de l'auteur comme le montre son précédent ouvrage, le précurseur SF : The other side of realism.

Ce recueil comporte quatorze essais d'une longueur allant de dix à quarante pages. Une partie (six) sont déjà parus dans divers supports (la revue Extrapolation dirigée par Clareson par exemple) ou sont des retranscriptions de conférences. En matière d'auteurs, c'est potentiellement du beau linge, des gens qui se feront un nom dans l'analyse du genre : Clareson, Schmidt (qui sera rédacteur en chef d'Analog), Wolfe (avec un brouillon de son The known and the unknown), Warrick ou encore Delany. Les sujets abordés sont donc très variés, avec plusieurs textes sur les robots/ordinateurs, sur la réutilisation des anciennes mythologies, sur la place de femmes dans la SF (déjà), sur les liens du genre avec l'Histoire, la Théologie ou la Philosophie. L'ouvrage ne comporte pas de bibliographie mais propose un index.

L'ensemble des textes est de qualité avec des intervenants qui maîtrisent leur sujet et qui arrivent à faire partager leur intérêt avec aisance. A cela s'ajoute la possibilité de pouvoir déterminer l'évolution des réflexions sur le genre. Les essais sur les dangers des ordinateurs tels qu'évoqués par la SF sont par exemple des documents historiques sur des fictions dont l'existence est maintenant oubliée (This perfect day/Un bonheur insoutenable). Ils peuvent étonner de nos jours par le côté rudimentaire de l'informatique déployée, mais leur message reste parfois d'une actualité brûlante.
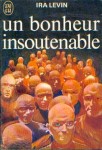
Outre ce décalage temporel qui commence à être important (les textes présentés vont maintenant sur leur quarante ans), on pourra aussi regretter le manque très net de ligne directrice de l'ensemble, assez bien révélé dans l'introduction où le projet du livre est pieusement passé sous silence. Malgré tout, cela nous permet de nous livrer à une promenade au sein de la SF, en allant successivement rencontrer des personnages allant de Tarzan à Univac en passant par L'homme qui tua Mahommet, un parcours qui ne s'effectue pas sans un certain plaisir.
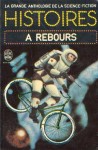
Note GHOR : 2 étoiles
07:58 | 07:58 | Ouvrages de référence divers | Ouvrages de référence divers | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : anglais, 2 étoiles | Tags : anglais, 2 étoiles
22/04/2010
_The mammoth encyclopedia of science fiction_
The mammoth encyclopedia of science fiction : George MANN : 2001 : Robinson : ISBN-10 1-84119-177-9 : 612 pages (y compris index) : coûtait 10 GBP pour un TP épais mais non illustré.

Il nous faut d'abord commencer par un mystère pour cet ouvrage au titre si typique de l'éditeur Robinson, qui appelle tous ses livres The mammoth book of X, avec X valant tout ce que l'on peut imaginer (de Ancient Wisdom à World's Greatest Chess Games). En effet, il est mentionné sur la page de garde que ce livre a été publié en 1999 par St Martin's (un éditeur américain), et ce malgré un copyright 2001 pour l'auteur et une préface datée d'Octobre 2000. Après de nombreuses recherches, il n'existe strictement aucune trace de cet ouvrage (seule une édition US chez Carroll & Graf de 2001 est attestée), ce qui laisse penser que cette ligne a été "oubliée" lors de la recopie d'une page de garde existante d'un autre livre de chez Robinson, ce qui est cohérent avec le fait que cet éditeur reprenne tous les ans le Year's best de Dozois (en changeant son titre) qui lui est bien publié par St Martin's.
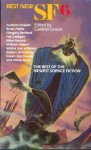
Ecrit par George Mann, un personnage multi-casquettes (comme souvent dans le genre) auteur, directeur de collection, anthologiste, ce livre est une encyclopédie du genre comme il en paraît assez régulièrement avec des niveaux d'ambition différents. Ici la cible n'est pas le C&N mais plutôt ces guides encyclopédiques de "second niveau" dirais-je, c'est à dire des livres un peu plus ambitieux que des ouvrages de stricte introduction au genre mais qui restent réalisables par un seul auteur, comme par exemple le Murail (en VF), le D'ammassa ou le Stableford (en VO).

Ce livre est divisé en plusieurs parties de taille assez variable. La première est une histoire du genre qui court sur une trentaine de pages. La deuxième (la principale) est une liste alphabétique d'une grosse centaine d'entrées sur les principaux auteurs (ainsi que quelques illustrateurs) et magazines (US & UK). Pour les auteurs on a une bibliographie sélectionnée, les thèmes abordés par cet auteur et des suggestions de lecture proches. Suit une partie sur les films et séries télévisées classiques comportant aussi une grosse centaine d'entrées (plus courtes que dans la section précédente). On a ensuite une partie sur les thèmes et concepts du genre (de Alien à Wormhole) et une sur les acteurs institutionnels de la SF et les prix décernés. Deux index, l'un des titres apparaissant dans les entrées par auteur et l'autre du reste terminent l'ouvrage.
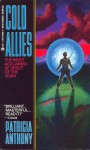
Formellement, on ne peut pas reprocher grand chose à cet ouvrage qui en offre largement pour son argent avec un niveau de connaissance du genre suffisant. Bien sûr, Mann n'évite pas toutes les erreurs ou approximations que seule une patiente relecture peut déceler (dates inexactes, titres transformés, attributions erronées, reprises de lieux communs) mais cela reste largement supportable. Plus dommage sur un plan structurel est le choix d'avoir éclaté les entrées en plusieurs parties à la logique parfois floue (pourquoi les magazines avec les auteurs ?), une fusion de tout cela par ordre alphabétique aurait été plus simple à appréhender, ce point valant aussi pour les deux index qui auraient pu être regroupés.

Plus problématique est pour moi la stratégie d'inclusion des auteurs suivie par Mann. Elle est en effet nettement biaisée en faveur des "nouveaux" (à l'époque) écrivains britanniques puisque l'on y trouve des gens comme Keith Brooke, Eric Brown, Eugene Byrne (pour rester dans les B). Ce courageux pari sur l'avenir peut apparaître comme séduisant et peut permettre à des néophytes de s'intéresser à des auteurs qui montent. Le souci est qu'il n'est pas clairement énoncé (la 4ème de couverture parle de "major SF figures") et surtout qu'il induit de gros loupés. On trouve par exemple dans ce livre une entrée pour des auteurs comme Roger Levy ou Lars Jensen (un seul roman à leur actif lors de la parution de ce livre), ce qui est quand même un choix malheureux quand on voit qu'ils "prennent la place" d'écrivains aussi importants (ou simplement aussi titrés) que Bisson, Kelly, Sheffield, Swanwick, Simmons, ou Willis qui n'ont pas droit de cité. Il est dommage que cet accent mis sur certains nouveaux venus (sur des critères quand même très opaques) se paye par un appauvrissement de la pertinence de l'ensemble, d'où une certaine déception.

Note GHOR 2 étoiles
07:57 | 07:57 | Index, dictionnaires & bibliographies | Index, dictionnaires & bibliographies | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : anglais, 2 étoiles | Tags : anglais, 2 étoiles
20/04/2010
_A Mack Reynolds Checklist_
A Mack Reynolds Checklist : Chris DRUMM & George FLYNN : 1983 (?) : Chris Drumm (série "Drumm Booklet" #4) : Pas d'ISBN : Non paginé (24 pages + 1 feuille volante) : Coûtait 1 USD pour un format plus petit que A5 agrafé au centre et sans couverture rigide qui se trouve pour assez cher d'occasion.

Cet ouvrage est l'une des bibliographies éditées par Drumm dans les années 80 dont d'autres exemples sont évoqués par ailleurs. A noter que cet exemplaire pose un problème de datation précise (pas de date sur le fascicule lui-même) compliqué par le fait qu'il est muni d'une feuille servant d'addenda (donc postérieure à la première édition supposée) et qu'il est tout simplement corrigé à la main en de nombreux endroits (y compris l'annonce du No7 de la série). Il s'agit donc d'une version intermédiaire sans doute tirée d'un travail en constante amélioration.

Son sujet est donc Mack Reynolds un auteur à la carrière assez particulière. Il fut en effet un des nouvellistes phares des années 60 où il donna de très nombreux textes à la revue Analog (et d'autres aussi prestigieuses) avant de devenir un romancier prolifique dans les années 70 (plusieurs livres par an, dont une partie de fix-ups). Après sa mort en 1983, il disparaîtra presque complètement de la scène SF malgré des tentatives de collaborations posthumes (avec Ing ou Banks par exemple). En ce qui concerne la VF, c'est un quasi-inconnu puisque seul un de ses romans a été traduit (Of Godlike Power/Earth Unaware/La puissance d'un dieu) ainsi qu'une grosse vingtaine de ses nouvelles. Pourtant c'est un auteur atypique, de sensibilité socialiste nettement marquée (il donnera une suite au fameux texte de Bellamy) et d'une orientation progressiste qui aurait dû plaire au public français (on pensera à sa série "Homer Crawford," une des premières à aborder la problématique du développement de l'Afrique). C'est aussi un des rares écrivains qui ait pris en compte l'aspect économique dans ses textes (c'est d'ailleurs un peu devenu une de ses marques de fabrique).
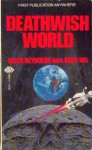
En matière d'organisation, on trouve le format habituel chez Drumm, à savoir un listing par ordre chronologique des textes de l'auteur. On y trouve donc, regroupés par année (de 1949 à 1983) et numérotés séquentiellement, les oeuvres de l'auteur (quels que soient leur format, leur genre ou leur type). Pour chaque item, un certain nombre d'informations bibliographiques sont données suivant le type, par exemple pagination et prix pour les livres, parutions successives pour les textes courts, de même que des informations ponctuelles. A noter que les réimpressions (dans la même collection) sont indiquées mais que seul les VO sont listées. Outre de nombreux gribouillis (parfois peu lisibles) qui complètent certaines entrées, il y a aussi une page supplémentaire d'addenda.
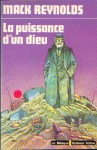
Malgré ses défauts (essentiellement un problème de lisibilité) et une présentation franchement "amateur", cette bibliographie est tout simplement indispensable pour pouvoir avancer dans l'étude d'un auteur dont l'importance réelle dans le genre n'est pas forcément clairement perçue malgré la parution en 1995 d'une étude qui lui est consacrée (Welcome to the revolution de Curtis C. Smith chez Borgo). Il était par exemple dans la pratique l'auteur No 1 d'Analog (il sera même contraint de prendre des pseudonymes pour éviter la saturation) et le plus apprécié des lecteurs (du moins selon l'Analytical Laboratory de Campbell dont on sait maintenant qu'il était parfois légèrement "arrangé" par le rédacteur en chef).

Ce petit fascicule est d'autant plus important que Reynolds présente un condensé de tous les écueils bibliographiques possibles : séries multiples et s'interpénétrant parfois (comme les "United Planets"), changements de titres fréquents (Frigid Fracas/The Earth War), expansions de nouvelles en romans sous des titres identiques ou différents (Mercenary en magazine devenant Mercenary from Tomorrow en livre), fabrication de fix-ups (The space Barbarians qui inclut même des textes parus sous le pseudonyme de Guy McCord), pseudonymes à foison. Il faut remercier Drumm et Flynn pour ce travail titanesque, sur lequel des gens comme moi peuvent bâtir.

Note GHOR : 3 étoiles
07:57 | 07:57 | Index, dictionnaires & bibliographies | Index, dictionnaires & bibliographies | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : anglais, reynolds, 3 étoiles | Tags : anglais, reynolds, 3 étoiles
19/04/2010
_Lost in space : Geographies of science fiction_
Lost in space : Geographies of science fiction : Rob KITCHIN & James KNEALE (editors) : 2002 : Continuum : ISBN-10 0-8264-5731-2 : xii+211 pages (y compris bibliographie et index) : coûtait 30 USD pour un TP avec quelques illustrations, existe aussi en HC (-5730-4).

Cet ouvrage est un recueil d'essais placé sous le double patronage de la Géographie et de la Science-Fiction. Son pitch est que la SF ouvre un nouvel espace qui rend le réel malléable (et dont le cyberspace est l'exemple type), un espace qu'il est donc possible de cartographier. Qui dit cartographie dit géographes et c'est sûrement cela qui explique que la quasi-totalité des textes soient écrits par des professeurs (on est étonné par la diversité des titres) ou des thésards anglo-saxons de ce domaine universitaire.
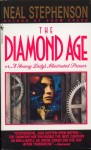
Après une préface de Michael Marshall Smith, ce recueil rassemble douze essais de taille variable (entre dix et vingt pages) dont une partie sont écrits à quatre mains. Ils abordent une grande variété de sujets (les uchronies, l'espace urbain, la nourriture et les OGM) en se focalisant sur un auteur précis (Ballard, Stephenson), une oeuvre (The diamond age, la trilogie Mars, He, she and it, Frankenstein) ou un domaine précis (le cinéma de SF, le cinéma de SF d'horreur). Une certain nombre d'illustration N&B (essentiellement des cartes) agrémentent le livre. Une copieuse bibliographie (dix pages) ainsi qu'un index sont fournis à la fin de l'ouvrage.
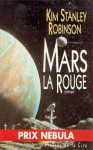
Je dois avouer que c'est un livre dont je n'ai gardé strictement aucun souvenir. Après une rapide re-lecture, je suis en mesure de comprendre pourquoi. Il y a tout d'abord le fait que l'immense majorité des intervenants est loin d'être constituée par des spécialistes de la SF, ce qui produit un effet assez fréquent dans cette configuration, à savoir que chacune des contributions n'est pas "centrée" sur la genre mais dérive très rapidement vers les domaines de compétence ou d'intérêt des auteurs, ce qui nous vaut par exemple de longues digressions sur les débuts du cinématographe sur le plan technique. Ce n'est, dans l'absolu, pas inintéressant mais est simplement "hors sujet", une erreur que ces professeurs doivent pourtant rencontrer à longueur de copies.
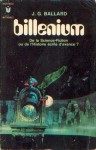
Dans ces conditions, l'ensemble du livre donne une impression de fourre-tout généralisé qui mêle tout ce qui peut être rattaché à la SF d'une façon plus ou moins lâche. Il n'y a d'ailleurs pas grand lien avec la géographie dans certains essais comme le montre la présence d'un texte sur les OGM ou d'une lecture féministe du roman de Piercy (et en plus c'est d'une originalité folle). Cette absence complète d'unité peut amener à se poser la question du pourquoi d'un tel livre dont le foisonnement et l'impression d'amateurisme qu'il dégage ont tendance à masquer les textes les plus pertinents, ce qui est dommage.
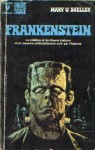
Note GHOR : 1 étoile
07:56 | 07:56 | Ouvrages thématiques | Ouvrages thématiques | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : anglais, 1 étoile | Tags : anglais, 1 étoile


