23/12/2020
_Speaking of the Fantastic III_
Speaking of the Fantastic III : Darrell SCHWEITZER : 2012 (pour l'édition originale) : Borgo Press (série "I.O. Evans Studies in the Philosophy and Criticism of Literature" #57) : ISBN-13 978-0-4344-3594-1 (la fiche ISFDB du titre) : 286 pages (y compris index) : semble coûter initialement 15.99 USD pour un tp non illustré sans jaquette, disponible en neuf en ligne (à 14.99 USD là).

Même si les mentions portées sur le livre indiquent une date de publication en 2012, mon exemplaire est visiblement une impression récente en POD (via Amazon Italie !). Faisant partie de l'immense galaxie de titres édités par Wildside (voir sur leur site), titres issus d'un certain nombre d'éditeurs plus ou moins absorbés comme justement Borgo Press, cet ouvrage est un recueil d'interviews menées par Schweitzer dans les années 2005-2010 et initialement publiées dans diverses revues du genre (principalement OSCIMS & TNYRoSF).
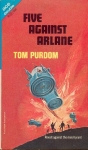
L'ensemble est composé de 16 interviews (pour 17 auteurs à cause du duo formé par Brian Herbert & Kevin J. Anderson ) de dix à trente pages de long, réalisées soit en face à face, par courrier (ou mail) ou durant des conventions. Le panel des interviewés est assez varié, allant de célébrités comme GRR Martin ou Joe Haldeman à des auteurs nettement moins connus (en tout cas ici) comme Tom Purdom ou Gregory Frost en passant par le "milieu du tableau" avec des gens comme Charles Stross ou Harry Turtledove. On notera, chose rare, la présence d'un index fort utile dans ce type d'ouvrage mais habituellement négligé.
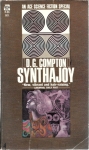
Comme souvent avec ce type d'ouvrage, l'intérêt est fonction de la qualité de l'intervieweur (bonne), de celle de l'interviewé (variable, certains étant plus ou moins pertinents) et surtout de ce que recherche le lecteur et des écrivain(e)s sur lesquels il souhaite avoir un peu plus d'information. On ne trouvera pas dans ce livre de grandes révélations mais parfois apportera-t-il un éclairage sur certaines carrières et leur déroulement (on pensera à Purdom), certaines motivations pour le genre (ou pas, voir Compton) et sur les traits de caractère de certains auteurs (Sawyer, par exemple, en ressort comme quelqu'un de passablement prétentieux à la Asimov ou Resnick). Au final une autre façon de découvrir ses auteurs favoris.
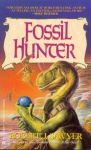
Note GHOR : 2 étoiles
17:32 | 17:32 | Ouvrages de référence divers | Ouvrages de référence divers | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : anglais, 2 étoiles | Tags : anglais, 2 étoiles
14/12/2020
_Death and the Serpent_
Death and the Serpent : Immortality in Science Fiction and Fantasy : Carl B. YOKE & Donald M. HASSLER (editors) : 1985 (pour l'édition originale) : Greenwood Press (série "Contributions to the Study of Science Fiction and Fantasy" #13) : ISBN-13 978-0-313-23279-4 (la fiche ISFDB du titre) : ix+236 pages (y compris bibliographie et index) : coûtait plusieurs dizaines d'USD pour un hc non illustré sans jaquette, disponible en neuf en ligne.

Même si les mentions portées sur le livre indiquent une date de publication en 1995, mon exemplaire est visiblement une photo reproduction en POD (via Lightning Source) postérieure comme l'atteste la présence d'un ISBN-13 en 4ème de couverture (à noter aussi un revêtement de couverture brillant et lisse à la différence de l'habitude chez Greenwood). Rassemblé par Yoke et Hassler, deux vieux routiers des ouvrages de référence, ce volume est un recueil d'essais (tous originaux me semble-t-il) autour du thème de l'immortalité tant dans la SF que dans la Fantasy.
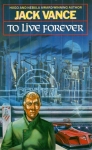
Outre une introduction, une bibliographie thématique et un index, l'ouvrage est composé d'une vingtaine d'essais de taille homogène (une dizaine de pages). Sous des plumes parfois connues (les editors eux-mêmes, Barr, Krulik, Siegel) ou venant de novices, les essais proposent divers niveaux d'analyse, allant de la vulgarisation à l'étude d'une oeuvre précise (The Immortals, To Live Forever, Childhood's End) ou d'un cycle (LOTR, Dune) en passant par l'étude d'un auteur (approche qui sous-tend la majorité des textes avec Heinlein, Tiptree, Eddison, Stapledon, Niven, Zelazny) ou d'un thème (Merlin, les elfes, les zombies, les vampires, les communautés féministes).
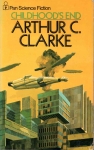
Comme souvent avec ce type de recueil d'essais par plusieurs auteurs qui est hétérogène par définition, la qualité dépend fortement de l'auteur. L'ensemble est ici de bon niveau avec peu de scories même si certains textes sont parfois datés pour cause d'avancées de la science ou sont plus "énumératifs" qu'analytiques. Mentions spéciales au texte sur To Live Forever de Vance, à l'amusante comparaison entre les elfes de Tolkien et ceux de Warner ainsi qu'à l'analyse de l'immortalité chez Niven un auteur habituellement peu étudié.
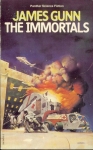
On regrettera quand même l'habituelle intrusion du politiquement correct au sein de cet ensemble avec deux textes en particulier, celui de Barr sur les "Immortal Feminist Communities of Women" (on pourra ironiser sur le fait qu'une Feminist Community a de grandes chances d'être composées de Women) qui est un nième rabâchage au sujet de toujours les mêmes textes de Russ, Piercy et Tiptree (avec Merril pour changer) ou celui sur Tiptree dont le rapport avec le thème de ce recueil est particulièrement ténu. Au final un bon ensemble assez varié.
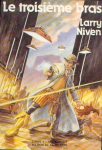
Note GHOR : 2 étoiles
17:02 | 17:02 | Ouvrages thématiques | Ouvrages thématiques | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : anglais, 2 étoiles | Tags : anglais, 2 étoiles
10/12/2020
_Odd Genre_
Odd Genre : A Study in Imagination and Evolution : John J. PIERCE : 1994 : Greenwood Press (série Contributions to the Study of Science Fiction and Fantasy #60) : ISBN-10 0-313-26897-5 (la fiche ISFDB du titre) : x+222 pages (y compris bibliographie et index) : coûtait plusieurs dizaines d'USD pour un hc non illustré sans jaquette, rarement disponible sauf désherbage de bibliothèques universitaires (mon exemplaire vient d'une université de Virginie).
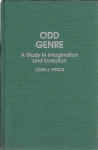
Paru dans la célèbre et longue (plus de 100 volumes) collection d'ouvrages de référence publiée par Greenwood Press, cet ouvrage fait partie d'un projet d'histoire de la science-fiction qui aurait dû s'intituler Imagination and Evolution. Ecrit par John J. Pierce (un temps rédacteur en chef de Galaxy), le résultat s'est avéré si volumineux que l'auteur s'est initialement retrouvé forcé de le scinder en quatre parties, toutes parues chez Greenwood dont ce volume est la dernière, après Foundations of Science Fiction, Great Themes of Science fiction et When World Views Collide.
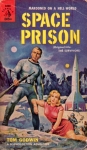
Organisé en cinq parties de taille variable et une vingtaine de chapitres, cet ultime volume essaie de "sortir" du cadre du genre. Que cela soit à propos de la définition même de celui-ci, des hybridations avec d'autres (Romance, Horreur), des trajectoires d'écrivains comme Vonnegut (hors du genre) ou Lessing (vers le genre) ou des protocoles spécifiques, Pierce explore toutes ces frontières parfois poreuses en s'appuyant sur sa connaissance fort détaillée du champ de la SF, y compris hors du monde anglo-saxon (on y croisera Barjavel ou Lem). Une copieuse bibliographie (25 pages) et un index clôturent l'ouvrage.

Une fois cet ouvrage refermé, il m'est resté un paradoxal sentiment de frustration. Comme déjà indiqué, il se trouve que je suis très souvent d'accord avec les analyses et les opinions de Pierce sur une large gamme de sujets (L'auteur est un amateur de Cordwainer Smith, c'est tout dire). Du coup ma frustration (si l'on peut dire) vient plutôt du fait qu'il y a tellement de matière dans ce livre et tellement de pierres soulevées par Pierce que l'ensemble est bien trop court (160 pages de texte à peine) pour que se développe un dialogue satisfaisant entre le lecteur et l'auteur. Ce dialogue est potentiellement d'autant plus riche que Pierce connaît particulièrement bien le genre et qu'il s'appuie sur un choix d'œuvres très original. Dans quel autre ouvrage de référence que celui-ci peut-on trouver une discussion de Space Prison de Tom Godwin, de Rogue Powers de Roger McBride Allen ou de Firefox de Craig Thomas.
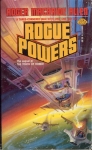
Au final, ce volume est dans doute le meilleur de la série, sans doute parce qu'il est à la fois celui qui ratisse le plus large, celui qui est le plus tranchant dans ses analyses mais aussi celui qui montre le mieux la richesse d'un genre qui ne cesse de repousser ses frontières. On peut ne pas être d'accord avec les positions de Pierce mais son discours mérite d'être entendu, d'autant plus qu'il est solidement étayé.
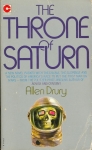
Note GHOR : 2 étoiles (presque 3)
18:55 | 18:55 | Ouvrages généraux sur la SF | Ouvrages généraux sur la SF | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : anglais, 2 étoiles | Tags : anglais, 2 étoiles
30/11/2020
_Roger Zelazny_
Roger Zelazny : Theodore KRULIK : 1986 : Ungar (série "Recognitions") : ISBN-10 0-8044-2490-X (la fiche ISFDB du titre) : xiv+178 pages (y compris index et bibliographie) : coûtait une quinzaine d'USD pour un petit hc avec jaquette non illustré, uniquement trouvable d'occase (et encore).
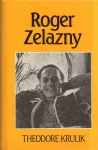
Paru dans la collection "Recognitions" de chez Ungar qui rassemble une grosse dizaine d'ouvrages de référence (essentiellement des études mono-auteurs), cet opus est donc consacré à Roger Zelazny. Ce dernier a conservé une image largement positive au sein du lectorat SF et Fantasy, sans doute parce que son décès précoce (en 1995 à même pas 60 ans) lui a peut-être permis d'écrire le "bouquin de trop" (comme tant d'autres). Il restera donc l'auteur de la trilogie d'Ambre, de romans de SF inspirés de diverses mythologies et un nouvelliste accompli, maître de la novella. Il existe un certains nombre de titres qui lui sont consacrés, 3 études au format livre (dont celui-ci) et plusieurs bibliographies (comme celle-là).
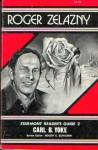
Après une préface et une chronologie de la vie de Zelazny, l'ouvrage est ensuite divisé en 9 chapitres d'une petite vingtaine de pages chacun. Si le premier est une biographie sommaire de l'auteur, les suivants abordent dans un ordre vaguement chronologique les grands ensembles (qu'ils soient thématiques comme l'immortalité ou romanesques comme la série Dilvish) qui structurent l'œuvre de Zelazny avec une plus grande attention portée aux romans même si les premières nouvelles sont détaillées. A noter la courte conclusion (qui forme le neuvième chapitre) et la présence d'une bibliographie (assez sommaire pour la partie primaire, plus riche pour la partie secondaire) et d'un index.
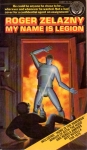
Comme souvent avec ce type d'ouvrage, l'impression générale est de "trop peu". Sur un format aussi court (il y a en fait dans le livre moins de 150 pages de texte, qui plus est assez aéré), il est difficile à Krulik de faire fondamentalement mieux que Yoke chez Starmont (qui disposait d'un nombre de mots assez proche). Cet ouvrage est donc plus une introduction aux thématiques "Zelzaniennes" et à la carrière de l'auteur qu'une étude en profondeur. Il n'en reste pas moins que l'enthousiasme de Kulik pour son sujet d'étude est plutôt communicatif et que certains des angles d'analyse qu'il emploie sont pertinents, comme la thématique de l'immortalité ou celle de l'amour perdu (et parfois retrouvé).
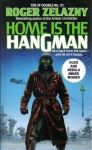
Comme Kurlik s'intéresse aussi pas mal aux textes qui composent My Name Is Legion qui est le roman (ou fix-up dans ce cas) de Zelazny que je préfère, l'ensemble m'est du coup plutôt sympathique et me paraît en tout cas une bonne base pour aborder cet auteur, d'autant plus que, par la force des choses, il garde toute son actualité (seule la deuxième pentalogie d'Ambre manque à l'appel). Le tout forme une bonne petite introduction assez réussie à un écrivain trop tôt disparu.
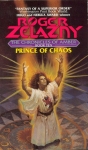
Note GHOR : 2 étoiles
18:21 | 18:21 | Etudes mono-auteur | Etudes mono-auteur | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : zelazny, anglais, 2 étoiles | Tags : zelazny, anglais, 2 étoiles
26/11/2020
_Lost Transmissions_
Lost Transmissions : The Secret History of Science Fiction and Fantasy : Desirina BOSKOVICH (editor et auteur "principal") : 2019 : Abrams Image : ISBN-13 978-1-4197-3456-6 (la fiche ISFDB du titre) : xi+276 pages (y compris index) : coûtait 29.99 USD pour un hc illustré sans jaquette, disponible chez l'éditeur (là).
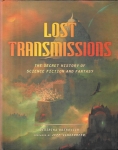
Depuis un certain temps, Jeff Vandermeer, qui a préfacé ce volume, mène une sorte de projet visant à exhumer ce que l'on pourrait appeler les trésors cachés de la SF (voir par exemple sa massive anthologie The Big Book of Science Fiction: The Ultimate Collection chez Viking). Cet ouvrage, sous la plume de Desirina Boskovich (à qui l'on doit un certain nombre de textes de fiction), semble s'inscrire dans cette démarche de relecture de l'histoire des genres jumeaux que sont la SF et la Fantasy. Pour ce faire, l'auteur et plusieurs autres dont les noms ne sont pas inconnus (Nisi Shawl, Paul Tremblay, Jeanette Ng, Charlie Jane Anders...) nous proposent une soixantaine d'essais (et quelques interviews) groupés par domaine artistique, de la littérature au fandom et la Pop Culture (quelle drôle d'association !) en passant par le cinéma, la mode ou l'architecture. Chaque texte fait quelques pages (au plus une petite dizaine) et comporte un certain nombre d'illustrations (affiches, couvertures, images de film...).
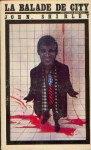
Parmi les "redécouvertes" de l'auteur, on peut citer des essais sur des auteurs (Johannes Kepler, Henry Dumas, David R. Bunch), sur des oeuvres individuelles (The Continuous Katherine Mortenhoe, Herland), sur des ensembles romanesques (Gormenghast, Viriconium), sur des films (Metropolis, THX 1138, Phase IV), des illustrateurs (Virgil Finlay, Paul Lehr, Michael Whelan), sur des artistes musicaux (Janelle Monàe, Deltron 3030), sur la mode, l'architecture ou sur des phénomènes aux marges du genre (le Raëlisme, la série Valérian). D'une façon assez incongrue, il y a donc aussi un certain nombre d'interviews (John Shirley, Hugh Howey, Karen Joy Fowler) ainsi qu'une préface de William Gibson à un roman de John Shirley et un index.

Il est difficile d'avoir un avis tranché sur cet ouvrage qui, malgré tout, ne me semble pas être à la hauteur de la promesse de son sous-titre (The Secret History of Science Fiction and Fantasy). Il n'y pas grand chose de particulièrement "secret" dans les sujets passés en revue (Verne, Mélies, PKD, Whelan, Cameron, Star Wars, Bowie, Warhammer, Howey...). On peut quand même y trouver dans les premières parties (SF écrite, dessinée et filmée) quelques perles (le film Phase IV en est l'exemple type) et quelques thèmes peu traités (la fiction "survivaliste" US). Logiquement, les articles les plus originaux se concentrent dans les parties Mode, Architecture et Musique, même si le résultat n'est parfois pas passionnant (mais comment "rendre" sur papier un morceau musical ?).
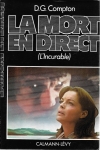
On pourra aussi trouver à ce livre un côté plutôt "propre sur lui" qui coche toutes les bonnes cases (féminisme, sensibilité aux questions raciales, queerdom) et qui, pour un ouvrage qui se veut original, ne l'est en fait pas tant que cela. Côté négatif, j'ai aussi ressenti un vague aspect "copinage" un peu insidieux (un effet de "bande" ?) et trouvé que, malgré la qualité physique du livre, les illustrations étaient un peu en décalage avec le texte et parfois aux limites du remplissage. Finalement le tout est plus à feuilleter qu'à dévorer, mais c'était sans doute là son objectif.

Note GHOR : 1 étoile
17:38 | 17:38 | Ouvrages généraux sur la SF | Ouvrages généraux sur la SF | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : anglais, 1 étoile | Tags : anglais, 1 étoile


