24/03/2012
_Formula fiction ?_
Formula fiction ? An anatomy of american science fiction, 1930-1940 : Frank L. CIOFFI : 1982 : Greenwood Press (série "Contributions to the study of SF&F" #3) : ISBN-10 0-313-23326-8 : xi+181 pages (y compris index et bibliographies) : coûtait 25 USD pour un HC sans jaquette, assez peu courant d'occasion.

Cet ouvrage est un des premiers de la longue série des textes de référence sur la SF publiés par Greenwood Press, une maison spécialisée dans l'étude universitaire. Sous la plume de Frank Cioffi, à l'époque professeur assistant d'anglais à l'université du Nouveau Mexique, il s'agit, comme son sous-titre l'indique assez clairement d'une étude quasiment taxonomique des textes courts (qui représentent la majorité de ceux publiés) parus durant les années 30 dans les principaux magazines clairement spécialisés en SF (le trio Amazing-Astounding-Wonder). Le but de l'auteur est d'en dégager un certain nombre de types de textes, de les discuter et de montrer leur pertinence en étudiant un ou plusieurs textes récents (dans l'ordre le film Alien, la nouvelle Persistence of Vision de Varley et plusieurs textes récents de divers auteurs -Disch, Bunch, Andrevon-) qui s'insèrent dans cette classification.
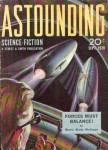
Après une courte introduction qui précise le projet du livre et sa méthodologie, l'auteur commence par un chapitre d'une trentaine de page qui lui permet de préciser le contexte dans lequel la SF des années 30 s'insérait. Le deuxième chapitre ("Status Quo Science Fiction") est consacré au premier "type" de texte déterminé par Cioffi. Il s'agit là des oeuvres qui sont bâties sur le principe de l'intrusion d'une anomalie dans le monde décrit, cette anomalie finissant par être repoussée ou annihilée, le récit se clôturant par un retour à l'ordre antérieur. Dans le chapitre suivant ("Subversive Science Fiction"), l'auteur étudie une variante de ce schéma où l'anomalie va venir modifier le monde décrit (par exemple une fin du monde). Le dernier type de récit distingué par Cioffi fait l'objet du quatrième chapitre ("Other World Science Fiction"), ce sont les oeuvres les moins fréquentes où le monde du récit est différent du nôtre et où le cadre de référence du lecteur ne sert que de point de comparaison. Un conclusion termine l'ouvrage qui offre plusieurs annexes : une liste des textes parus dans Astounding, une bibliographie générale et un index.
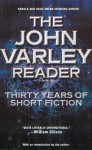
Même si l'étude menée par Cioffi porte dans la pratique sur un échantillon plutôt étroit puisque l'auteur s'est restreint à un seul magazine (Astounding) et à une seule décennie (les années 30), les enseignements qu'il en retire semblent pertinents. Certes, l'on va retrouver cette classification suivant le degré d'éloignement de monde du lecteur chez nombre d'analystes du genre (c'est particulièrement vrai pour les réflexions sur la SF des séries télévisées ou le premier type est majoritaire) comme Stableford, mais cet ouvrage est probablement l'un des premiers à avoir employé cette démarche d'une façon systématique.
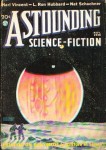
Le résultat final est globalement satisfaisant même s'il laisse un peu le lecteur sur sa faim. En effet, l'ouvrage se révèle finalement assez court vu la place importante prise par les annexes (une trentaine de pages). On pourra aussi regretter que la partie la plus importante en taille (cinquante pages) soit celle dévolue au type de SF où le statu quo ante est restauré à la fin par élimination de l'anomalie, un choix narratif qui est peut-être celui qui est le plus loin des aspirations du genre et de sa pratique actuelle (même s'il est sûrement pertinent pour la période étudiée). Le tout forme un ensemble relativement pionnier mais qui appelle une confrontation de l'anatomie inventée par Cioffi avec le corpus actuel de la SF.
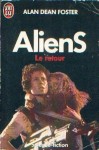
Note GHOR : 2 étoiles
13:26 | 13:26 | Ouvrages thématiques | Ouvrages thématiques | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : anglais, 2 étoiles | Tags : anglais, 2 étoiles
05/01/2012
_Vultures of the void : The legacy_
Vultures of the void : The legacy : Philip HARBOTTLE : 2011 : Cosmos Books : ISBN-13 978-1-60701-149-1 : 411 pages (y compris index) : coûte $19.95 pour un TP illustré en N&B disponible en neuf.

Ecrit par Philip Harbottle, une des figures de la SF britannique sous ses diverses casquettes (fanzineux, auteur, éditeur, rédacteur en chef, agent, etc.), cet ouvrage résulte de la fusion et de la forte expansion de deux ouvrages mythiques (introuvables ou accessibles seulement à des prix prohibitifs) : Vultures of the Void (Borgo 1992) et British Science Fiction Paperbacks and Magazines 1949-1956 (Borgo 1994). Son champ d'étude est donc le même, à savoir l'histoire de la SF en Grande Bretagne durant la période qui va de l'immédiate après-guerre jusqu'à l'orée des années 60. Une époque qui verra la naissance de plusieurs magazines aux ambitions diverses, l'explosion d'éditeurs aux pratiques douteuses et aux romans écrits à la chaîne (les fameux "Mushroom Publishers") et l'installation de la SF comme genre autonome et commercialement viable.

Divisé en une vingtaine de chapitres de taille inégales souvent constitués autour d'essais inédits ou parus dans divers supports, ce livre utilise une structure vaguement chronologique, en ce sens que Harbottle s'en écarte parfois pour brosser un tableau complet de tel ou tel point comme par exemple le chapitre 8 qui est entièrement consacré à l'histoire du magazine Authentic Science Fiction. On va donc retrouver au fil du livres des auteurs maintenant oubliés mais d'une production impressionnante (Fearn, Statten ou Tubb), rencontrer des personnages clés pour l'histoire britannique du genre (certains étant hyper connus comme Clarke ou Russell et d'autres méconnus comme Gillings, Carnell ou Peter Hamilton), croiser la route d'éditeurs sans scrupules et pouvoir suivre les multiples tentatives souvent vaines pour imposer un magazine de SF autochtone par opposition aux magazines (comme ceux édités par Atlas Publishing) qui n'étaient que des reprises de titres US (Astounding, Unknown, etc.). Chaque chapitre est suivi par quelques pages d'illustrations en N&B (majoritairement des reproductions de couvertures avec quelques photographies d'époque) et le livre est clôturé par un index.
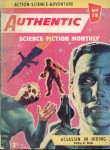
Malgré une organisation un peu brouillonne sans doute due à son mode de construction, cet ouvrage est tout d'abord un plaisir à lire grâce à un récit enlevé et vivant basé sur les témoignages directs des acteurs d'une époque haute en couleurs et aux pratiques parfois surprenantes. Mais il est aussi une vaste mine d'informations qu'elles soient du domaine de l'anecdote ou d'une portée bibliographique certaine (comme ces données précises sur les anonymes illustrateurs d'un grand nombre d'ouvrages ou les identités des auteurs réels des textes de l'EVSF). Cela se lit "comme un roman" avec ses héros, ses méchants et ses destins tragiques et est d'un intérêt indiscutable.
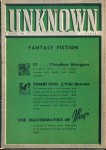
Seulement deux éléments pourraient tempérer le régal qu'est la lecture de ce volume. Tout d'abord, on discerne parfois un petit côté "règlement de comptes" dans certains passages écrits par Harbottle, ce qui est un peu dommage (même si inévitable) pour un ensemble qui a clairement vocation à devenir un standard du domaine. Ensuite, il faut bien intégrer que cet ouvrage n'est pas à mettre entre toutes les mains. Non pas qu'il soit obscène ou quoi que ce soit d'immoral, mais simplement que sa lecture demande un certain nombre de pré requis pour être complètement satisfaisante. En un mot, une familiarité tant avec la SF mais aussi avec le paysage éditorial britannique de l'époque est indispensable pour apprécier pleinement l'énorme travail de l'auteur. Cela réserve donc le plein potentiel de cet ouvrage à des amateurs plutôt éclairés. Quoi qu'il en soit, Harbottle confirme ici le statut de "culte" donnés aux précédentes versions de cet opus.

Note GHOR : 3 étoiles
15:41 | 15:41 | Ouvrages thématiques | Ouvrages thématiques | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : anglais, 3 étoiles | Tags : anglais, 3 étoiles
03/11/2011
_Science Fiction fandom_
Science Fiction fandom : Joe Sanders (editor) : 1994 : Greenwood Press (série "Contributions to the study of SF & F" #62) : ISBN-10 0-313-23380-2 : xii+293 pages (y compris index et bibliographie) : coûtait 55 USD pour un HC sans jaquette qui se trouve assez peu souvent en occase.

Une fois l'intérêt académique sur la SF éveillé et après un travail sur les textes eux-mêmes, il était normal que le sujet des acteurs du genre soit abordé. La communauté des fans formant un ensemble à la fois structuré et suffisamment "visible" (parfois aux limites du ridicule), elle fournissait un parfait sujet d'étude. Ceci conduira à des ouvrages comme ceux de Jenkins, Bacon-Smith ou Torres (ce dernier étant en VF). Ce recueil d'essais visant à cartographier le fandom est lui le fruit d'une démarche que l'on pourrait qualifier de plus "interne" puisque la majorité des intervenants sont issus du milieu. On y trouve des fans (Moskowitz, Warner, les Trimble, Thomas), des pros (Lupoff, Busby, Gaughan) et des enseignants associés depuis longtemps au genre (Letson, Sanders).

Ce livre comporte vingt-six essais de taille très variable (de trente à moins de dix pages) qui sont regroupé en six parties inégales. La première (2 essais) introduit brièvement le fandom. Elle est suivie par une longue section (presque 100 pages) logiquement consacrée au fandom US sous l'angle historique. La troisième traite des autres fandoms nationaux (britannique, français, européen, chinois et japonais). On trouve ensuite trois essais sociologiques sur les structures existantes (clubs, conventions). L'avant-dernière partie essaie de prendre un peu de hauteur en explorant l'influence du fandom sur le monde de la SF professionnelle. L'ouvrage se termine par une partie bibliographique commentée et l'inévitable glossaire des expressions faniques.

On regrettera tout d'abord que certains des essais soient proches de la caricature et mettent plus en exergue les travers du microcosme que ses qualités. Par exemple, le texte sur le fandom français est un condensé type des habituels reproches que l'on peut lui faire : manque de recul, personnalisation à outrance (on a droit à la liste des BNFF avec leur profession), vision partisane de la scène fanzinesque avec par exemple l'existence de Yellow Submarine complètement passée sous silence alors que les mentions relatives à A&A (fanzine auquel l'auteur était assez lié) pullulent, attaques gratuites sur des concurrents (SFère ou Vopaliec stigmatisés comme "benchmarks of awfulness") ou des manifestations organisées par les "ennemis" (la fameuse convention de Paris en 1988) [pour préciser les choses, j'ai collaboré à YS ET A&A et j'ai un peu aidé pour la convention évoquée]. Un texte tellement tendancieux que l'on comprend mieux la mauvaise image du fandom qui semble parfois plus occupé à régler des comptes ou à dominer le marigot qu'à agir pour le genre.

Malgré ces quelques fausses notes, l'amateur se trouvera en pays de connaissance et pourra dénicher quelques informations ou témoignages pertinents, voire trouver quelques pistes pratiques (comme l'article sur l'organisation d'une convention). Toutefois, il est clair que, pour un fan relativement informé, l'ensemble reste très classique (voire archi-connu) et s'apparente plus à une sorte de synthèse d'ouvrages existants (l'histoire du fandom de Warner ou d'autres, les guides pour collectionneurs, les études sociologiques évoquées plus haut, etc.) qu'à une oeuvre vraiment approfondie et novatrice.

Note GHOR : 2 étoiles
11:59 | 11:59 | Ouvrages thématiques | Ouvrages thématiques | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : anglais, 2 étoiles | Tags : anglais, 2 étoiles
31/10/2011
_Science Fiction culture_
Science Fiction culture : Camille Bacon-Smith : 2000 : University of Pennsylvania Press : ISBN-10 0-8122-1530-3 : 316 pages (y compris index et bibliographie) : coûtait 25 USD pour un TP non illustré, existe aussi en HC (3223-2).

Ce livre est écrit par Camille Bacon-Smith, une docteur es folklore de l'université de Pennsylvanie (qui est aussi l'éditeur de cet ouvrage) et aussi auteur de plusieurs livres de fiction tendance fantastique urbain. A ces divers titres elle a été amenée à s'intéresser au milieu des fans de SF et en a tirer deux ouvrages théoriques dont celui-ci est le plus récent. Son propos est d'y montrer quels sont les rapports entre le fandom et les structures qui produisent (auteurs), publient (éditeurs) ou exploitent le genre. Elle souhaite souligner l'ambivalence de ces interactions, entre les images d'Epinal d'une consommation passive et d'une rébellion contre le système.
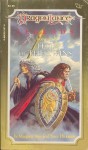
Le livre s'articule en trois parties principales de taille inégale. La première ("Creating the Landscape") explique comment s'est créé le paysage dans lequel évolue le fandom en détaillant sa hiérarchisation (de fan de base à SMOF), ses grands messes (les Worldcons) et ses réseaux de communication (avec l'arrivée d'Internet). La deuxième ("New groups changes the face of genre") montre comment ces structures ont permis à certains sous-groupes, qu'ils soient caractérisés par un genre, une orientation sexuelle ou un centre d'intérêt précis, de pouvoir "prendre la parole" et participer au dialogue général qui "guide" (ou tente de guider) l'évolution de la SFF. La dernière partie ("It all comes together in the fiction") analyse comment la production de SF est justement influencée par tous ces acteurs, leurs stratégies et leurs agendas. Le livre se termine par un ensemble de notes copieux (30 pages), une bibliographie et un index.
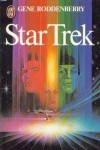
Un des paradoxes de ce livre est que son mode de construction qui fait une très large place à l'immersion et au contact direct avec les acteurs du genre (une partie importante de l'ensemble se présente sous forme d'interviews ou de dialogues) se révèle en fait préjudiciable à la qualité de l'analyse. On pourrait presque penser que Camille Bacon-Smith a tellement collecté d'information qu'elle ne peut résister au plaisir de nous les faire partager. Cela nous vaut par exemple des plongées dans la vie intime de certaines associations de SF (ici la NESFA) qui sont très riches et qui rappelleront bien des choses à qui a un jour participé à l'organisation d'une quelconque manifestation. De la même façon, certains chapitres de la troisième partie consacrés aux mécanismes du marché de la SF littéraire sont passionnants.
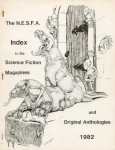
Toutefois cette telle densité d'information (avec en plus une police utilisée plutôt petite) donne parfois l'impression d'un manque de plan d'ensemble. A la différence d'un Jenkins (Textual poachers), il est clair que l'auteur nous montre bien la "culture" SF dans son fonctionnement et ses évolutions mais est moins prolixe sur les enseignements que l'on peut tirer de l'existence d'une telle structure qui est presque sans égale. Au final un livre fourmillant d'infos, presque journalistique dans sa description de certaines franges du genre (le fandom gay et lesbien, la fraction cyber, les féministes, etc.) mais qui peine à synthétiser tout cela.

Note GHOR : 2 étoiles
16:17 | 16:17 | Ouvrages thématiques | Ouvrages thématiques | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : anglais, 2 étoiles | Tags : anglais, 2 étoiles
26/10/2011
_Comic tones in Science Fiction_
Comic tones in Science Fiction : The art of compromise with nature : Donald M. HASSLER : 1982 : Greenwood Press (série "Contributions to the study of SF & F" #2) : ISBN-10 0-313-22814-0 : xiv+143 pages (y compris index) : coûtait 25 USD pour un HC sans jaquette qui se trouve parfois d'occasion à des prix variables.

Cet ouvrage est donc le deuxième paru dans la maintenant longue (plus d'une centaine de titres) série relative à la SFF ("Contributions to the study of SF & F") publiée par Greenwood. A noter que, de part leur qualité de fabrication (élevée) et leur prix (très élevé), ces livres sont visiblement destinés à une clientèle de bibliothèques. Ce volume a été écrit par Donald M. Hassler, un des premiers pratiquants du "mélange" entre l'Académie (il était professeur d'Anglais dans une université) et la SF (on lui doit divers guides de lectures). Son sujet d'étude est ici l'effet comique qui peut être induit par les dislocations propres au genre.

Après une courte préface, l'ouvrage est divisé en six chapitres de taille inégale. Le premier est une approche théorique de l'effet comique en littérature, les deux suivants sont des rappels historiques qui ne concernent que partiellement le genre (même si Le Guin apparaît des le troisième en compagnie de Jane Austen). Les trois derniers chapitres abordent divers auteurs, parfois exclusivement (Sturgeon pour le quatrième) ou parfois séquentiellement (Asimov & Goldin dans le cinquième, Clement & Pohl dans le dernier). Une postface, une bibliographie (primaire et secondaire) et un index clôturent l'ouvrage.
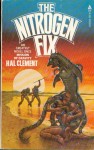
L'impression principale qui ressort de la lecture de ce livre est qu'il s'agit d'un projet qui semble relativement bâclé. On peut comprendre que pour le lancement de sa collection l'éditeur n'avait peut-être pas un grand choix d'ouvrages disponibles mais il faut bien avouer que voir un ensemble sur le comique traiter majoritairement d'auteurs comme Le Guin, Sturgeon, Golding ou Clement peut surprendre tant "Comique" n'est certes pas le premier qualificatif qui viendrait à l'esprit à leur propos. Il faut dire que, hormis une partie théorique qui m'a semblait surtout traiter uniquement de l'ironie, Hassler est assez à la peine de justifier les chapitres entiers qu'il leur consacre. Son propos est certes intéressant mais est plus dans l'analyse générale de certains de leurs écrits (The left hand of darkness ou More than Human) qui ne donnent pas vraiment dans la franche rigolade. Même pour Asimov qui a pu parfois donner dans le comique, l'étude de Hassler se concentre sur la trilogie Fondation qui ne peut qui difficilement se voir appliquer ce terme.
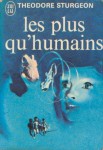
Un autre symptôme d'une certaine précipitation est la réutilisation assez importante par Hassler de ses précédents écrits. Des parties des chapitres 2 & 3 sont parues dans des revues littéraires, le chapitre 4 vient d'Extrapolation, un bout du chapitre 5 vient du livre de Olander sur Asimov et un autre du Magill. Le dernier chapitre quand à lui ressemble beaucoup au Starmont sur Clement. Tout cela donne au final un ouvrage qui, faute de préparation et/ou d'originalité, manque assez nettement son objectif et malgré la pertinence de ses analyses, n'en apprendra pas plus au lecteur sur les rapports entre la SF et l'effet comique.

Note GHOR : 1 étoile
11:49 | 11:49 | Ouvrages thématiques | Ouvrages thématiques | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : anglais, 1 étoile | Tags : anglais, 1 étoile


