01/09/2010
_Reading by starlight : Postmodern science fiction_
Reading by starlight : Postmodern science fiction : Damien BRODERICK : 1995 : Routledge : ISBN-10 0-415-09789-4 : 197 pages (y compris bibliographie et index) : coûtait 17 USD pour un TP non illustré.

Damien Broderick est un universitaire australien (même s'il réside aux Etats-Unis) qui a occupé de nombreuses fonctions dans le genre. Commençant par le fanzinat, il a été éditeur, anthologiste, essayiste, auteur de textes sur la science, écrivain de SF (il revient d'ailleurs sur le devant de la scène avec des nouvelles et sa duologie Godplayers & K-Machines) et bien sûr auteur d'ouvrages de référence (comme x, y, z, t: Dimensions of Science Fiction). Ce livre est une réflexion sur les rapports entre postmodernisme et SF qui s'appuie particulièrement sur l'oeuvre de Samuel Delany qui est pour Broderick l'exemple type de cette fusion.
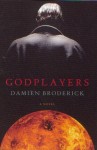
L'ouvrage est divisé en deux parties. La première ("Modern science fiction"), qui comporte sept chapitres, est une sorte d'histoire du genre qui commence dans les années 30 et s'arrête avec le cyberpunk. La seconde ("Postmodern science fiction" sur cinq chapitres) cherche au sein du genre des exemples de SF présentant une sensibilité postmoderne et la trouve dans plusieurs romans de Delany (The Einstein intersection et Stars in my pocket like grains of sand) qui sont analysés en détail. A noter qu'une partie non négligeable de ces chapitres ont été pré-publiées sous une forme modifiée dans diverses revues d'étude sur le genre. L'ouvrage se termine par plusieurs pages de notes, une volumineuse bibliographie générale et un index.
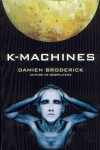
Pour être franc, j'avoue n'avoir que très moyennement apprécié ce livre malgré l'érudition dont il fait preuve. Sans doute parce que le concept même de postmodernisme, tel que développé (ou expliqué) par Briderick me paraît globalement assez fumeux ou en tout tellement imprécis qu'il peut s'appliquer de façon sélective à peu près n'importe quel texte de SF du fait qu'elle est un genre essentiellement référentiel et donc une littérature particulièrement consciente d'elle-même.

Relativement "léger" en volume (il y a au plus 150 pages de texte) mais paradoxalement plombé par un style particulièrement lourd et abusant du jargon à la mode à l'époque, ce livre est un peu un pensum à lire. Entre le "name-dropping" intense, les redites de Delany (sur les protocoles de lecture propres au genre) et encore et encore du Delany à toutes les sauces (en fiction cette fois), l'ambiance est un peu étouffante. Sans doute n'ai-je simplement pas le bagage nécessaire pour apprécier pleinement le travail de Broderick.
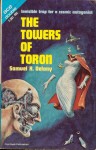
Note GHOR : 1 étoile
07:31 | 07:31 | Ouvrages généraux sur la SF | Ouvrages généraux sur la SF | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : anglais, 1 étoile, broderick | Tags : anglais, 1 étoile, broderick
11/08/2010
_Les pirates du paradis : Essai sur la science-fiction_
Les pirates du paradis : Essai sur la science-fiction : Alexis LECAYE : 1981 : Denoël Gonthier (série "Bibliothèque Médiations" #212) : ISBN-10 2-282-30212-5 : 249 pages (y compris index) : coûtait quelques francs pour un poche non illustré aisément trouvable.
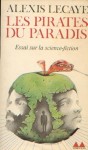
Paru hors des collections classiques et sous la plume d'un auteur qui sera par la suite connu pour son implication dans le roman policier, cet ouvrage est un essai de portée assez générale sur la SF. Un type de livre basé sur des parcours personnels dont sortiront un certain nombre d'exemples dans la décennie 70-80. On pensera par exemple au Gougaud (Démons et merveilles de la SF) dont ce titre est finalement assez proche.
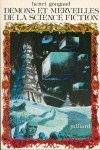
Le principe choisi par Lecaye pour évoquer le genre étant de nature thématique, l'ouvrage se divise donc en 16 chapitres d'une quinzaine de pages qui abordent chacun un thème de société ou un aspect du genre et l'illustrent en faisant référence à de nombreux textes (en VF et VO). On y retrouve donc le spectre habituel des sujets généralement abordés par cette catégorie d'ouvrage : le temps, l'espace, les robots, le sexe, l'autre, la divin, la violence, la télépathie, le jeu, etc. Un index (nom propres seulement) clôture ce livre qui ne propose pas de bibliographie.

Malgré une visiblement très bonne connaissance du genre par l'auteur qui multiplie les références à un vaste spectre de textes dont certains relativement obscurs ou non traduits, cet essai ne m'a pas vraiment satisfait. C'est sans doute le manque de réflexion globale sur le genre qui m'a gêné. On a en effet l'impression de lire une longue suite d'exemples relatifs à tel ou tel thème (Wyndham sur le matriarcat, Blish sur la religion) qui montre certes l'étendue des approches pratiquées par le genre mais qui ne va pas plus loin, sauf dans la courte conclusion où la SF est considérée comme une littérature millénariste, une idée pas très neuve.
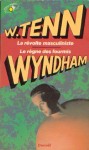
Il est à noter que la lecture de ce petit essai n'est pas facilitée par une pratique que l'on rencontre parfois chez certains auteurs VF à savoir une gestion des titres et des correspondances VO/VF pour le moins assez confuse. On trouve en effet de façon assez aléatoire : le TF, le TO, le TO même si le TF existe (le flemme de le chercher ?), le TF traduit du TO et qui ne correspond pas au "vrai" TF (un terrible Une peste de Pythons pour le roman A plague of Pythons aka L'ultime fléau). Cette véritable salade de titres n'est certes pas grave en soi mais peut laisser un doute sur la quantité de travail fourni et est parfois assez pénalisante lors de la lecture qui doit être arrêtée le temps de deviner de quoi parle l'auteur. De toute façon, la partie bibliographique n'est visiblement pas la tasse de thé de Lecaye vu le peu d'efforts et d'informations fournies dans ce domaine. Au final un ensemble qui n'est pas fondamentalement mauvais mais simplement sans grand relief et dont on peut se demander quel est le projet qui l'a impulsé.
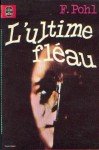
Note GHOR : 1 étoile
07:07 | 07:07 | Ouvrages généraux sur la SF | Ouvrages généraux sur la SF | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : français, 1 étoile | Tags : français, 1 étoile
09/08/2010
_Pilgrims through space and time_
Pilgrims through space and time : Trends in patterns in scientific and utopian fiction : J. O. BAILEY : 1972 (pour cette édition) : Greenwood Press : ISBN-10 0-8371-6323-4 : ix+341 pages (y compris bibliographie et index) : coûtait 3.50 USD pour un TP avec quelques illustrations en N&B.

Ce livre est une des légendes du monde des ouvrages de référence sur la SF. Historiquement, il s'agit en effet du tout premier d'entre eux puisqu'il a été originellement publié en 1947 chez Argus Book tout en ayant été écrit dans sa majorité encore avant. C'est donc un texte fondateur (le prix annuel décerné à un chercheur par la SFRA porte d'ailleurs son nom) ce qui explique pourquoi il a été réédité en 1972 par Greenwood dans cette édition qui y ajoute simplement une introduction de Thomas D. Clareson. L'ambition de Bailey était tout simplement de raconter l'histoire de la SF (ou de la proto-SF) essentiellement dans le monde anglo-saxon jusqu'à l'orée de la deuxième guerre mondiale.
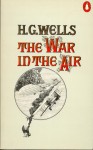
Ce livre est divisé en deux parties principales. La première suit un ordre à peu près chronologique et retrace l'histoire de la proto-SF en six chapitres et deux cents pages, allant d'un pamphlet de 1641 à une nouvelle de 1945 parue dans Astounding par George O. Smith (Identity). La seconde (5 chapitres et une centaine de pages) est une exploration du même ensemble de textes sous divers angles : structurel, thématiques, prospectif ou idéologique. Le tout est complété d'une bibliographie des oeuvres citées et d'un index complet (noms propres, titres et thèmes).
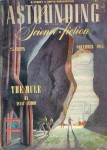
Au vu du climat peu propice au genre qui prévalait lors de la rédaction de cet ouvrage, on ne peut que louer le travail de Bailey et souligner encore une fois son côté précurseur qui ouvrira la voie à des centaines de travaux sur la SF. Vu la nouveauté de l'exercice, on comprendra aisément que la majorité du livre (en gros la première moitié) soit plus une suite de résumés d'intrigues de textes strictement inconnus qu'une histoire vraiment structurée des débuts du genre. En effet, avant de disserter sur la SF (ici la proto-SF) il convient tout d'abord de la cartographier, c'est là tout le travail accompli par l'auteur.

De la même façon que pour le Versins (qui fait montre parfois d'une certaine similitude), le revers de la médaille est que l'étude de Bailey fait l'impasse à peu près totalement sur la SF des pulps (à partir du moment où ils existent), ce qui handicape fortement la fidélité du portrait qu'il dresse en ce qui concerne les années 1926 à 1945. Il est frappant de voir que l'index ne comporte aucune mention de gens comme Asimov, Heinlein ou Van Vogt alors qu'ils sont déjà des géants du genre à l'époque de la parution initiale de cet ouvrage. On a donc une étude pionnière mais dont la pertinence et la justesse ne concernent vraiment que la proto-SF "littéraire", elle est donc à prendre comme telle et non comme une histoire globale du genre.

Note GHOR : 2 étoiles
06:48 | 06:48 | Ouvrages généraux sur la SF | Ouvrages généraux sur la SF | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : anglais, 2 étoiles | Tags : anglais, 2 étoiles
05/08/2010
_A pictorial history of Science Fiction_
A pictorial history of Science Fiction : David KYLE : 1986 (pour cette édition) : Tiger Books : ISBN-10 0-600-50294-5 : 173 pages (y compris bibliographie et index) : coûtait 25 USD pour un HC grand format illustré avec jaquette qui se trouve assez aisément d'occasion.
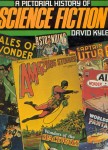
Tout d'abord, il convient de noter que cet ouvrage est en fait une nouvelle édition tardive d'un titre initialement sorti en 1976 chez Hamlyn sous une couverture différente mais avec (me semble t-il) un contenu identique. Du coup, cette véritable date de première parution le place fermement au milieu de la vague des ouvrages du même type du milieu des années 70. En effet, comme le Ash ou le Holdstock (traduits eux en VF), il s'agit d'un livre hybride qui mélange une étude sur le genre (historique dans ce cas) avec un "coffee-table book" caractérisé par son iconographie.
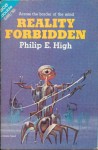
Sous la plume de David A. Kyle, une des légendes du fandom (c'est un membre du "first fandom" mais aussi un des fondateurs de Gnome Press), ce livre est donc une histoire illustrée du genre. Logiquement, elle s'organise donc sous une forme chronologique en une suite de chapitres couvrant peu ou prou une décennie chacun, allant de la proto-SF au milieu des années 70. Seul un chapitre sur le fandom s'intercale dans cette progression. Muni d'une courte (une demie page) bibliographie et d'un index, cet ouvrage est majoritairement illustré (plus de la moitié des pages) par des images abondamment légendées de tous les formats (de la vignette à la pleine page) et généralement en N&B, ce qui est logique vu la part belle faite aux dessins intérieurs des pulps.
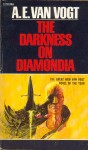
Comme souvent avec ce style d'ouvrage, la partie purement textuelle, même si elle est de qualité comme ici avec un tel conteur que Kyle qui connaît tous les recoins du genre, passe un peu au second plan au profit de la partie graphique. Dans ce domaine elle est de toute beauté avec des illustrations superbes et qui sortent souvent des sentiers battus même si l'on trouve parfois des choses déjà vues chez Sadoul ou Freewin.

Au total c'est un livre fort plaisant qui conte une histoire de la SF certes schématique et centrée sur les pays anglo-saxons mais toujours très érudite et riche d'anecdotes (particulièrement dans les longues légendes des illustrations). Avec un aspect visuel parfaitement exécuté et maîtrisé, ce livre peut parfaitement faire office d'introduction au genre, en prenant seulement garde au fait que l'histoire qu'il raconte s'est arrêtée depuis presque 40 ans.

Note GHOR : 2 étoiles
10:02 | 10:02 | Ouvrages généraux sur la SF | Ouvrages généraux sur la SF | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (0) | Commentaires (0) | Tags : anglais, 2 étoiles | Tags : anglais, 2 étoiles
30/06/2010
_Panorama de la science-fiction_
Panorama de la science-fiction : Les thèmes, les genres, les écoles, les problèmes : Jacques VAN HERP : 1975 : Marabout (Collection "Université" #270) : pas d'ISBN : 414 pages (y compris bibliographie mais pas d'index) : coûtait quelques francs pour un PB légèrement illustré en N&B, existe aussi en TP.

Cet ouvrage est le deuxième de son genre à être paru en VF. Après le Versins, il s'agit d'une autre tentative de cerner les contours du genre sur une longueur suffisamment importante pour tendre vers une certaine exhaustivité. Issu d'un projet initié avec Jacques Bridenne, ce livre est dû à la plume de Van Herp, un des grands spécialistes du genre à ses débuts et se veut donc un passage en revue historico thématique de la science-fiction au moment où celle-ci est en plein décollage.

L'ouvrage est divisé en quatre grandes parties très inégales. La première qui occupe plus de la moitié du livre est une sorte d'histoire de la SF vue au travers du prisme de ses thèmes. Ceux-ci sont assez classique même si les libellés employés par Van Herp peuvent dérouter, comme par exemple "Les machines qui pensent" (= les ordinateurs). La deuxième identifie et définit plusieurs (sous)-genres : le SO, l'HF, la SF mythologique (c'est à dire Merritt et Lovecraft) et les juveniles. La troisième revient sur l'histoire du genre décrite ici sous un angle géographique avec la mention de trois "écoles" (américaine, française et soviétique). La dernière grande partie est un recensement des problèmes qui se posent à la SF dans ses rapports avec diverses forces (Religion, Science, Morale, etc.). Il y a plusieurs annexes : un liste de définitions et de jugements sur le genre, une bibliographie mais on notera l'absence d'index. Le tout est illustré de quelques petites reproductions en N&B.
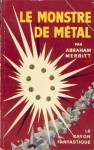
Même s'il s'agit d'un jalon important dans l'étude de la SF en langue française, ce livre a particulièrement mal vieilli. En effet cet ouvrage se concentre d'une façon prévisible (c'est d'ailleurs aussi le cas du Versins) sur la proto-SF européenne, sans doute faute de matériau anglo-saxon. Hors, comme son nom l'indique bien, la proto-SF n'est pas encore la SF et cet eurocentrisme forcené que l'on perçoit est un peu dommage pour l'analyse d'une littérature qui est, sous sa forme actuelle, extrêmement américanisée (que l'on le regrette ou pas). Du coup Van Herp tombe avec une incroyable facilité dans les clichés les plus éculés sur les américains incultes et violents comme il en fait l'étalage dans sa violente (et AMHA manquant de nuance) attaque de Poul Anderson qui donne parfois l'impression de lire une mauvaise critique du Fiction de la grande époque.

Au final un ouvrage qui est bien trop passéiste et qui présente une cartographie du genre dont l'adéquation avec le terrain semble pour le moins douteuse. On croirait parfois lire une uchronie où la SF se borne à Verne, Renard, Rosny et Robida. Un ouvrage acceptable dans les années 70 mais inexploitable quarante ans plus tard (inexploitabilité d'ailleurs renforcée par la regrettable absence d'index) tellement ses préjugés le disqualifient.

Note GHOR : 1 étoile
07:37 | 07:37 | Ouvrages généraux sur la SF | Ouvrages généraux sur la SF | Lien permanent | Lien permanent | Commentaires (1) | Commentaires (1) | Tags : français, van herp, 1 étoile | Tags : français, van herp, 1 étoile


